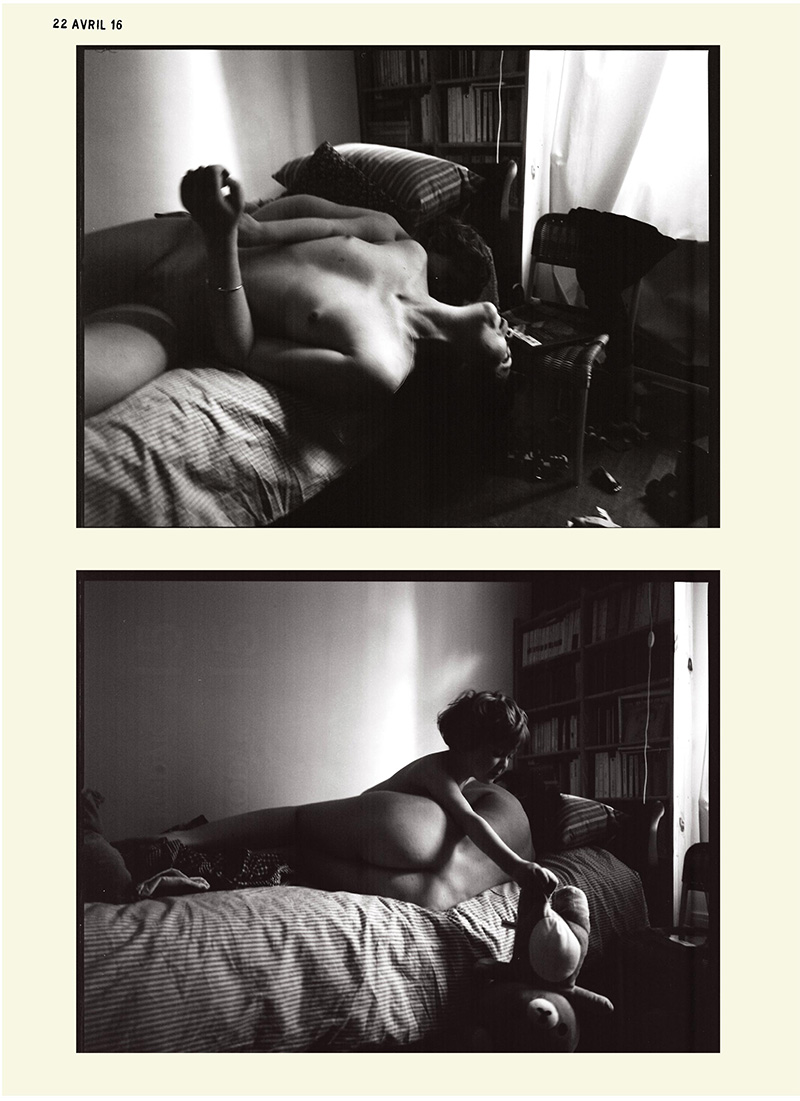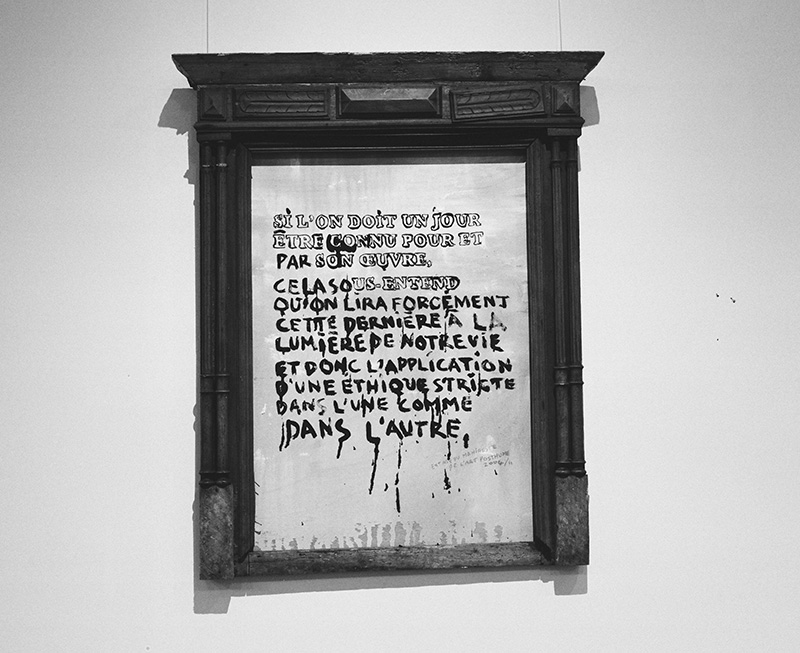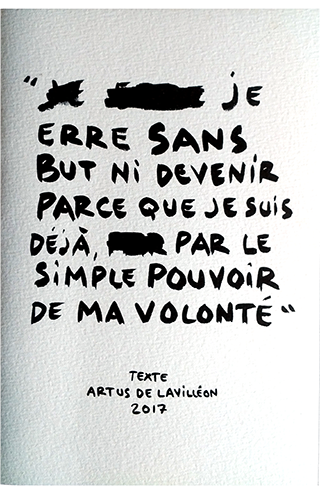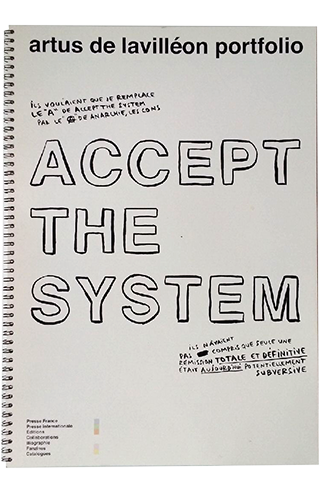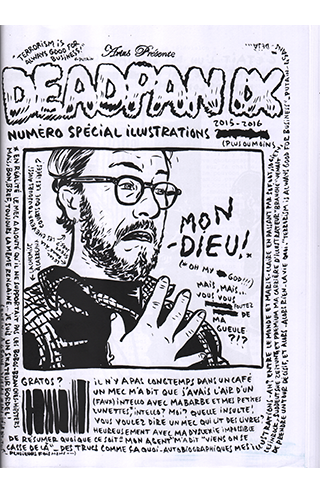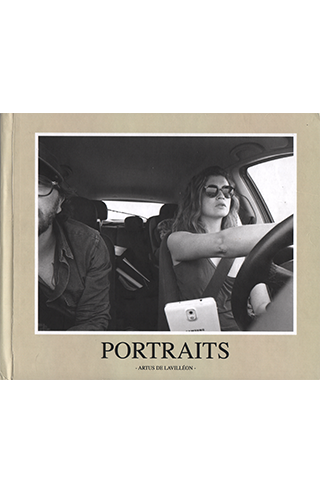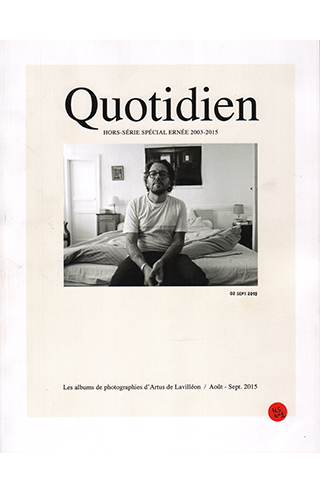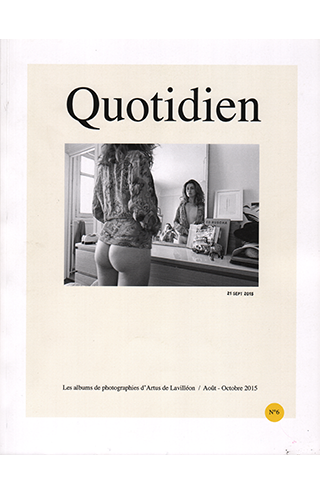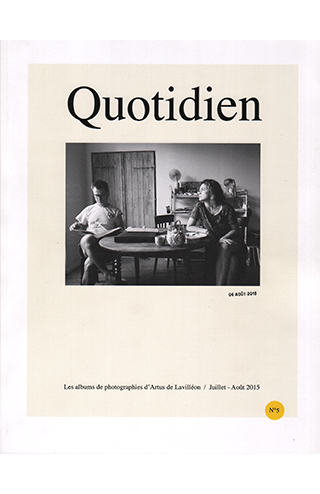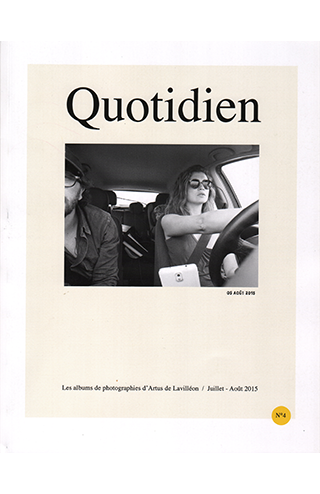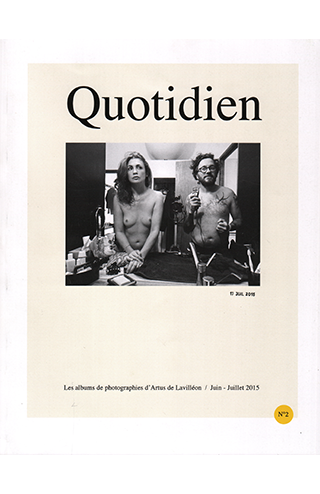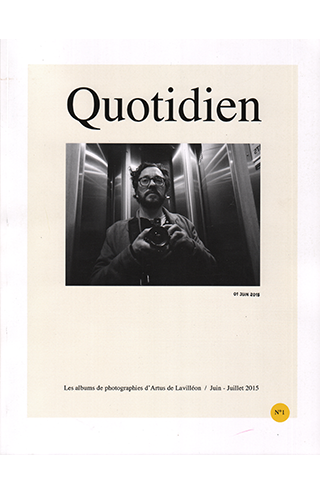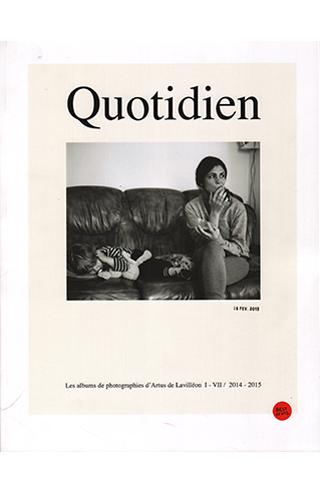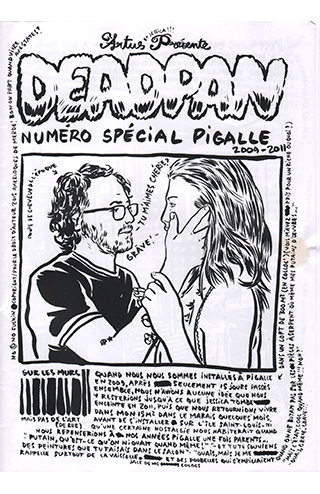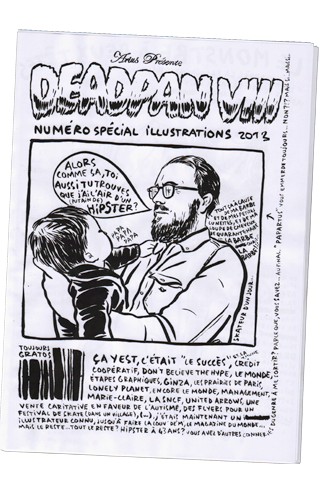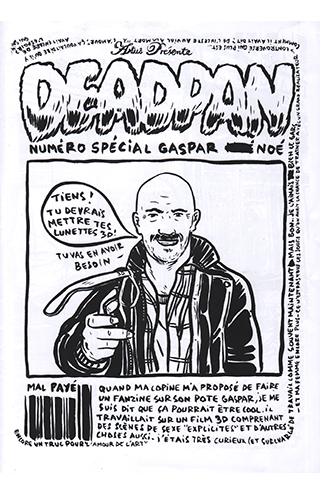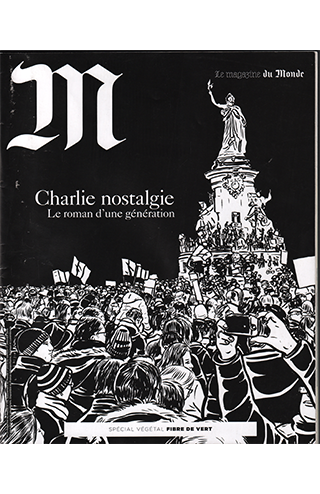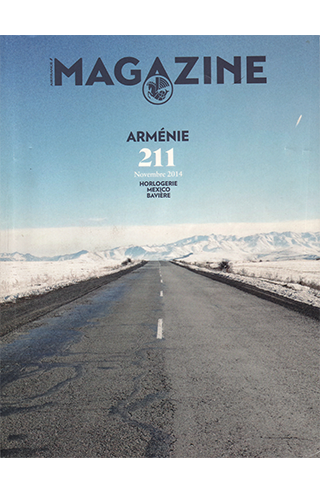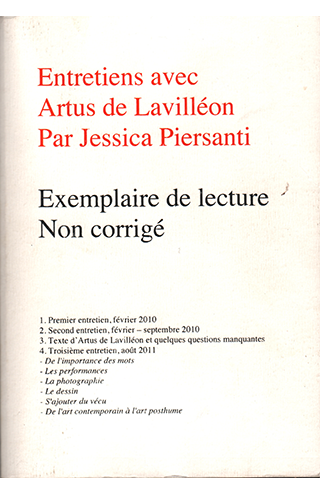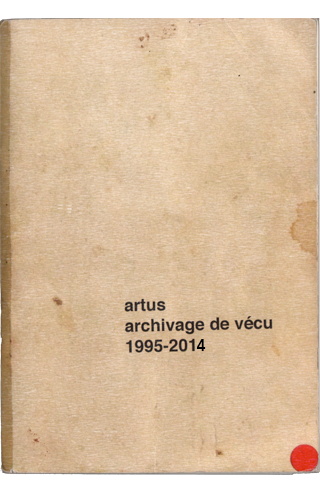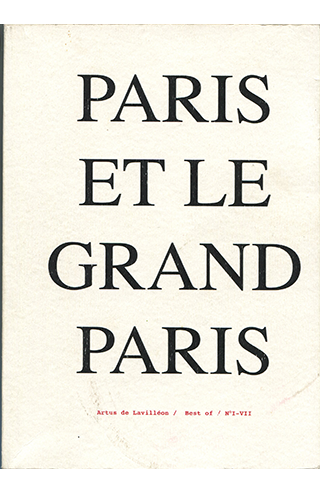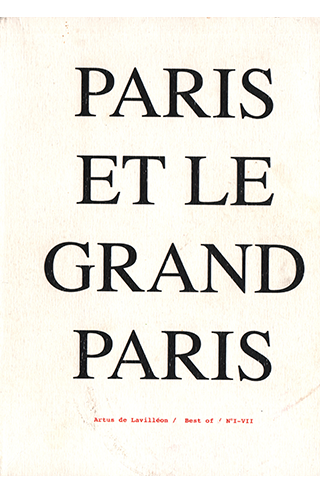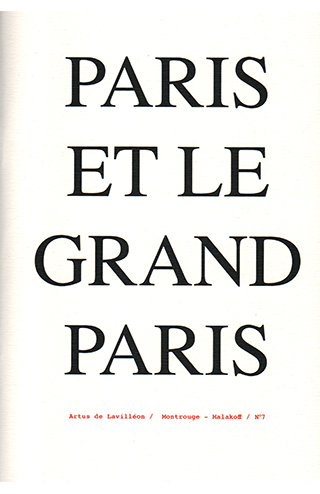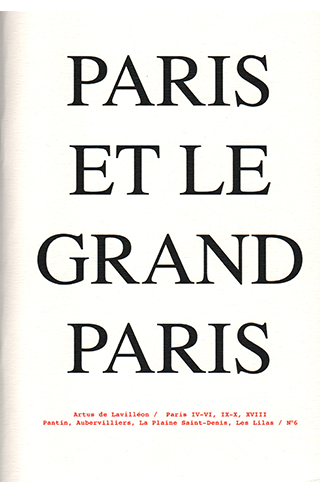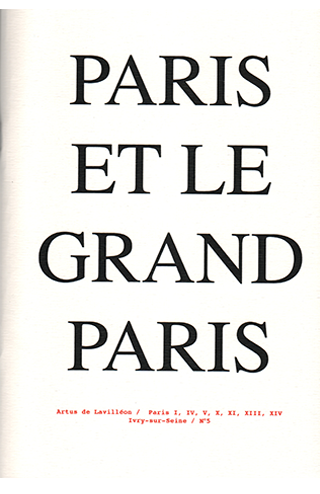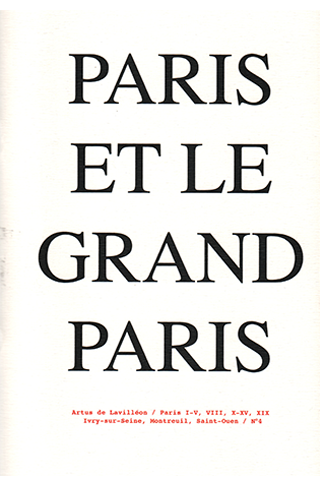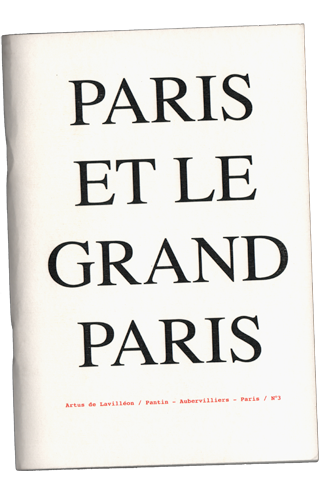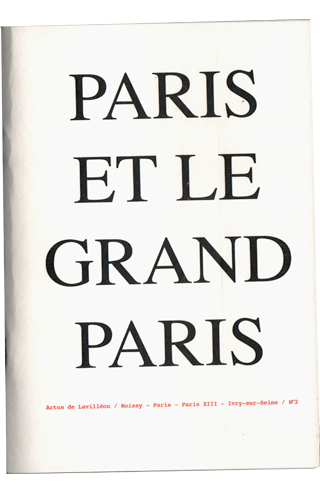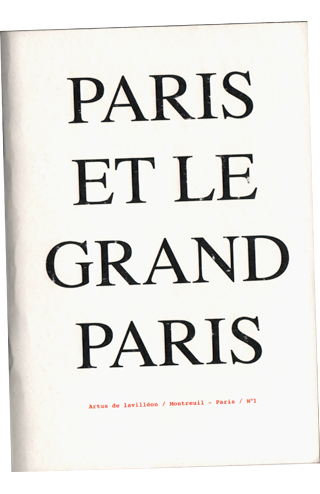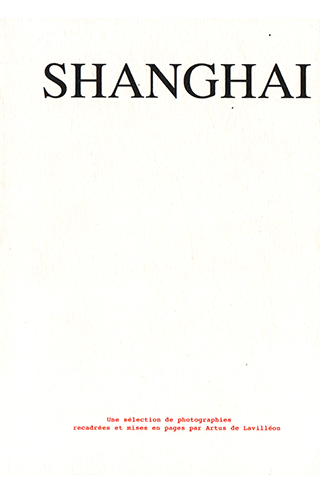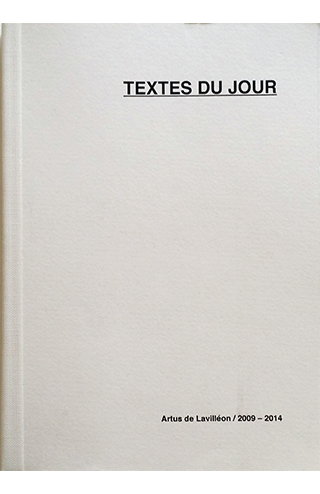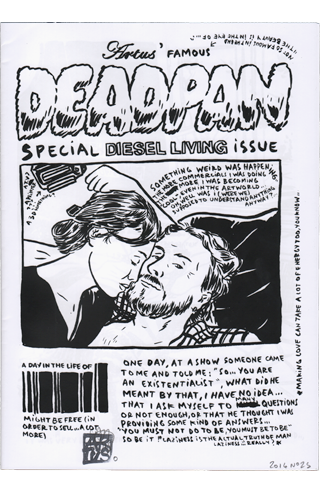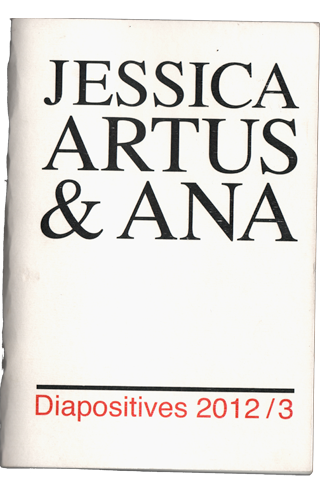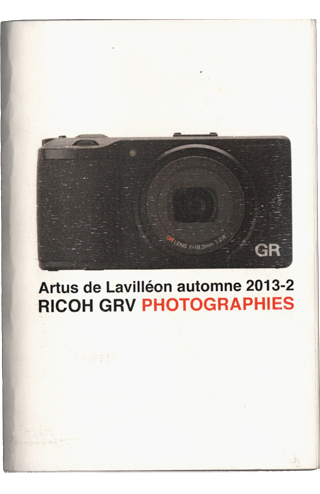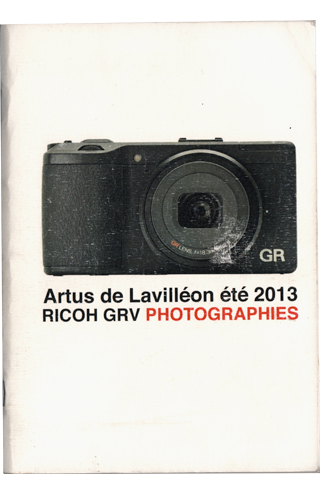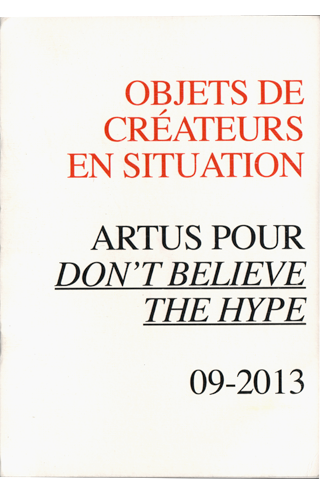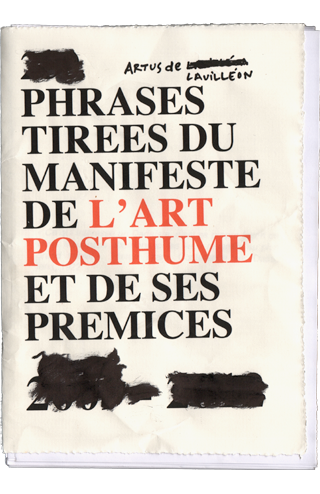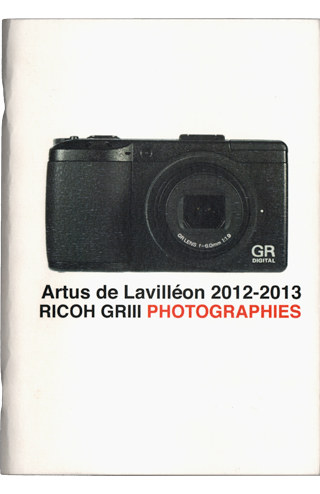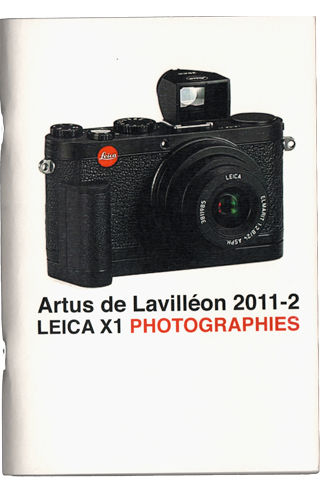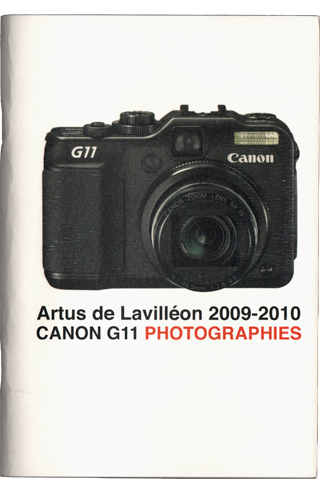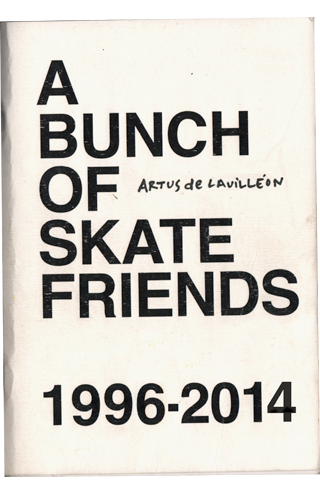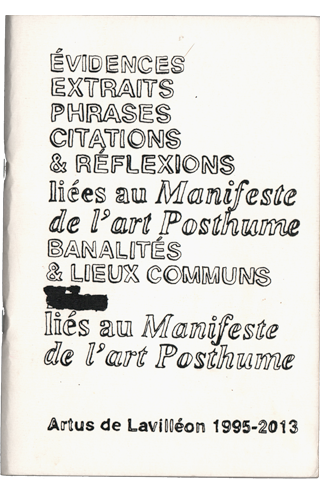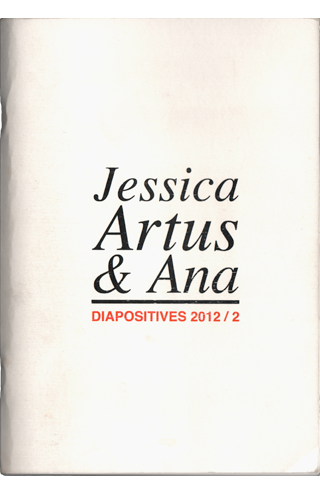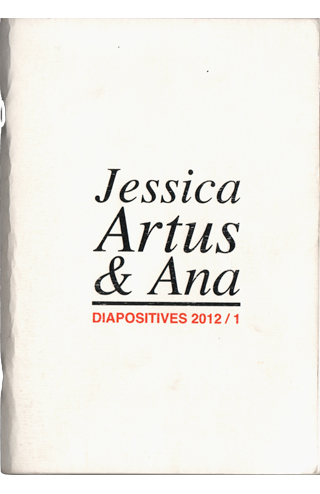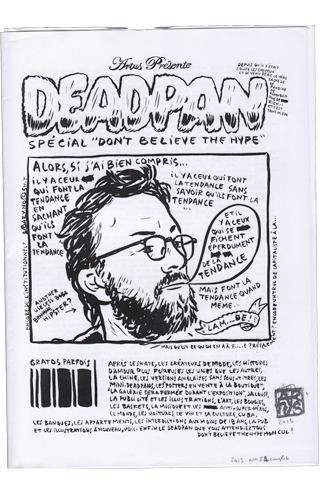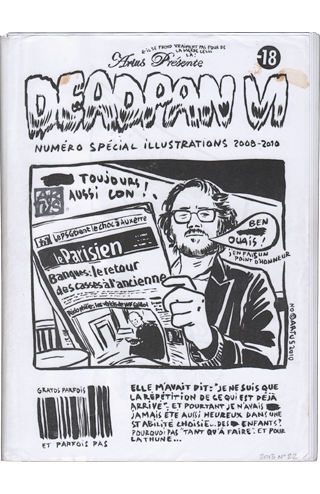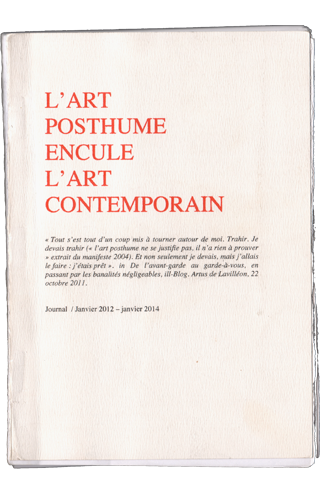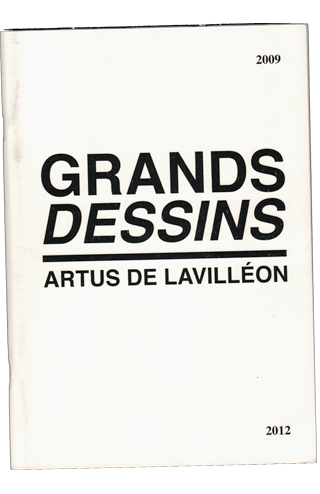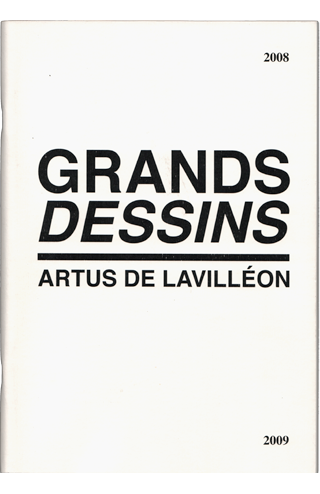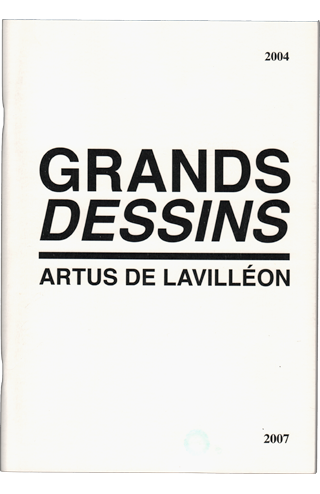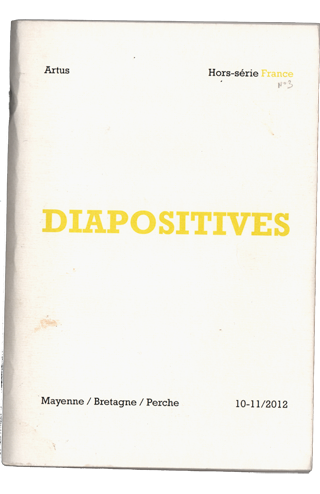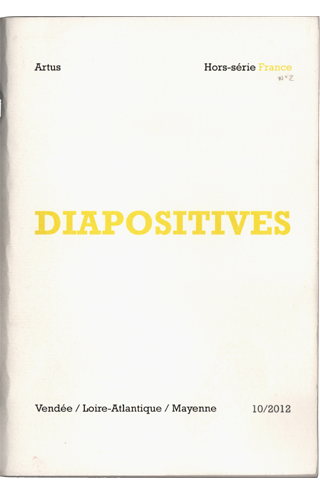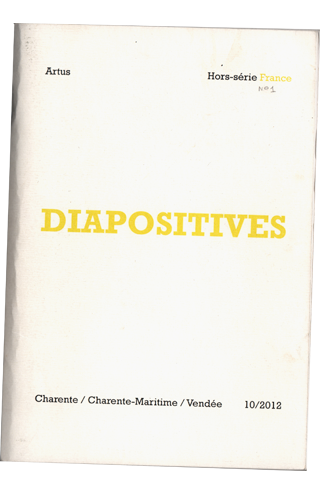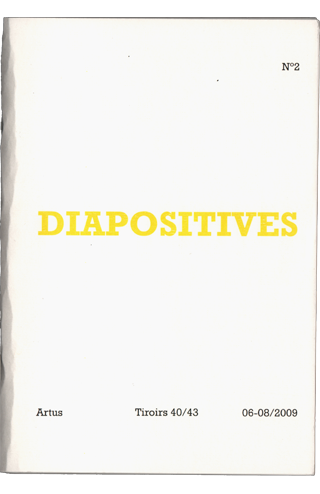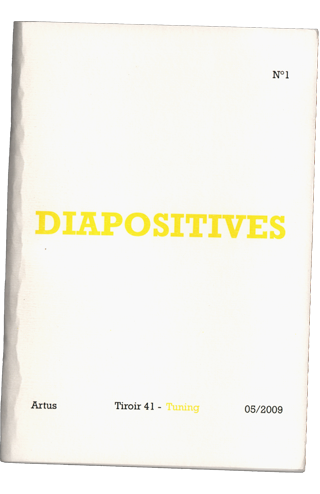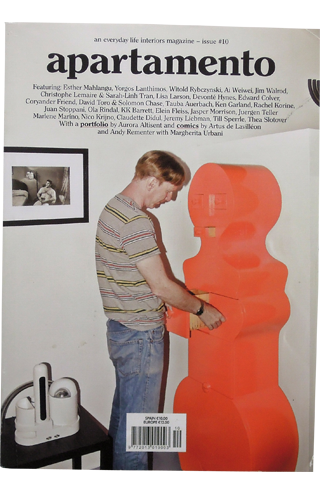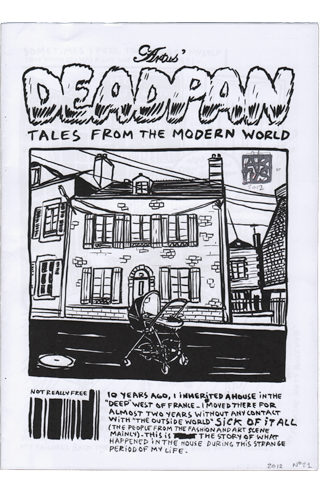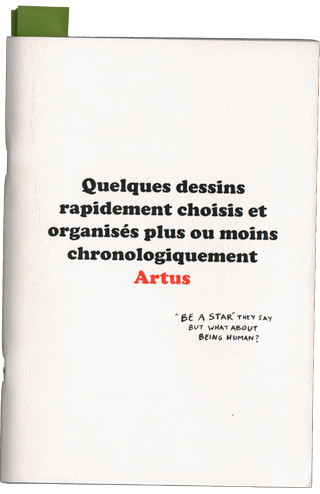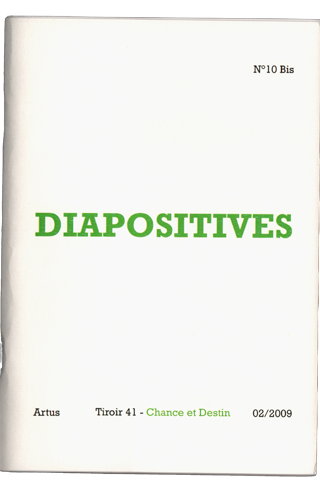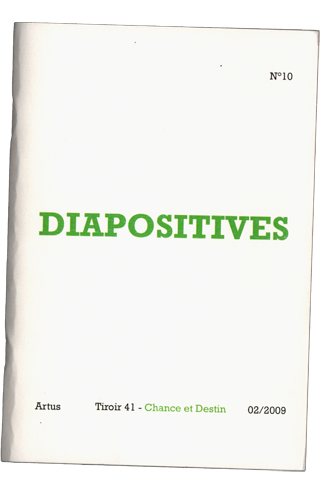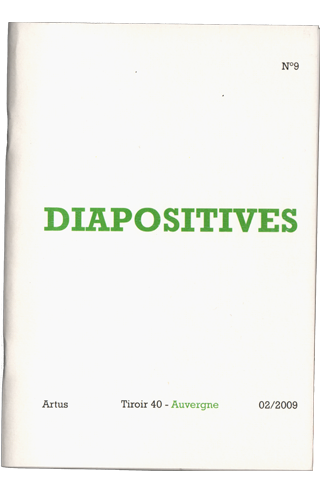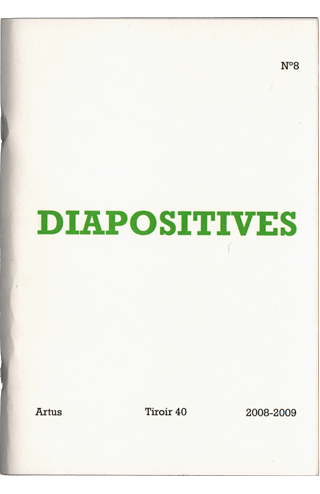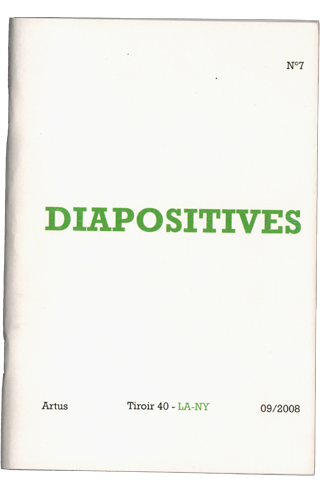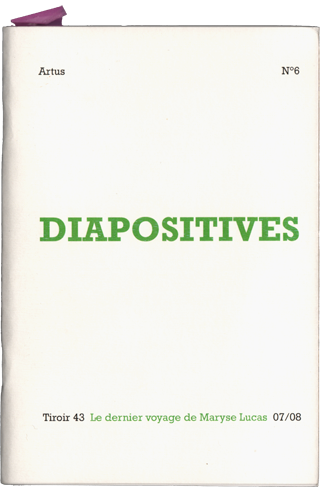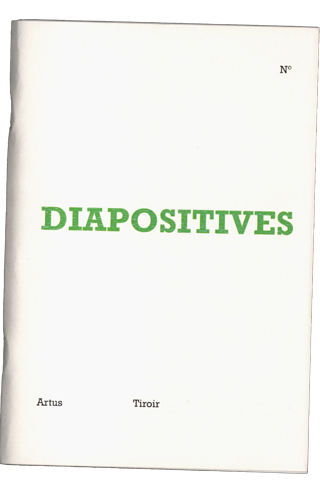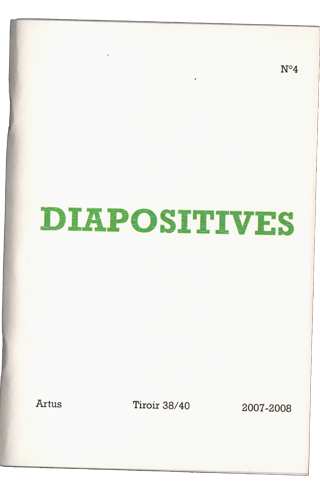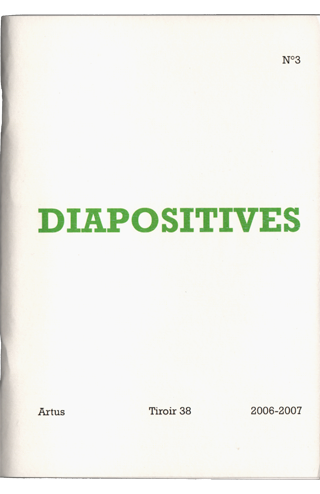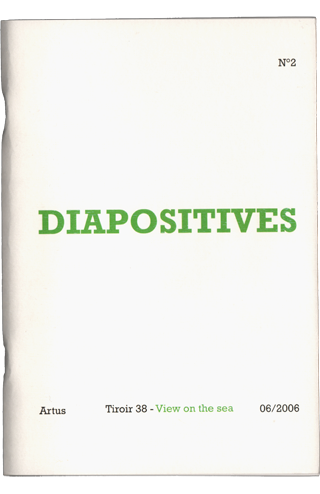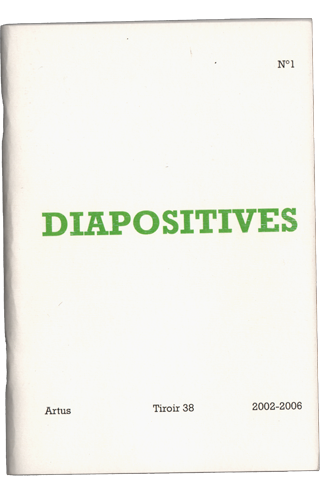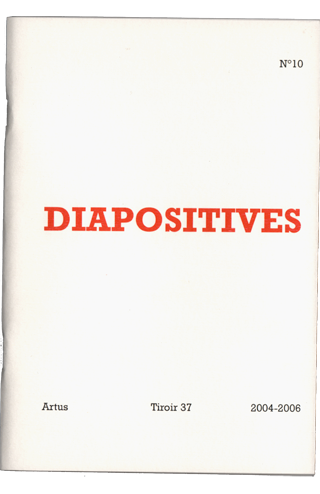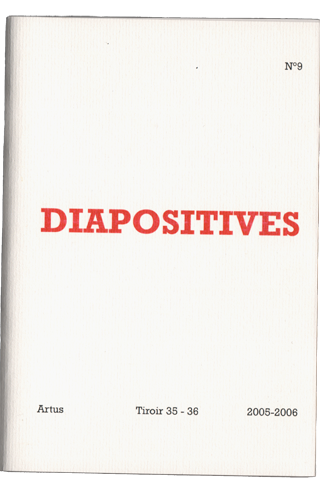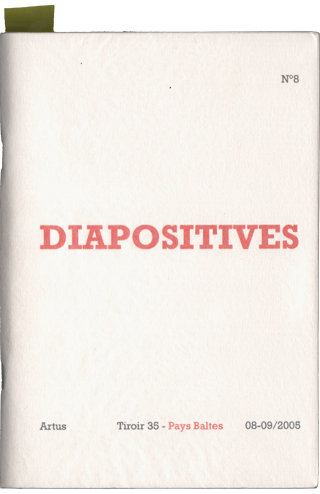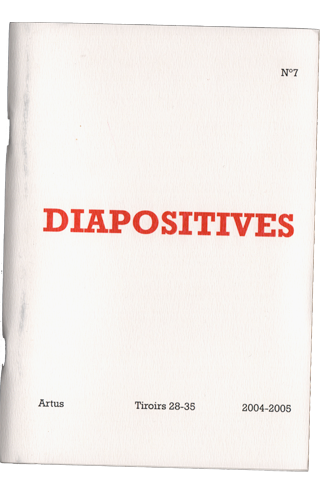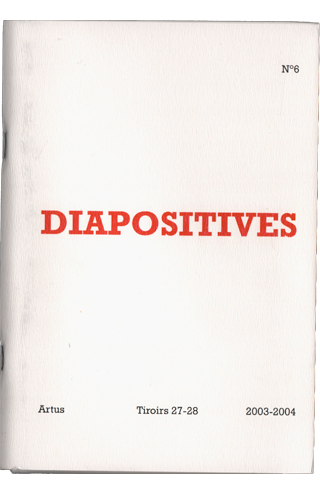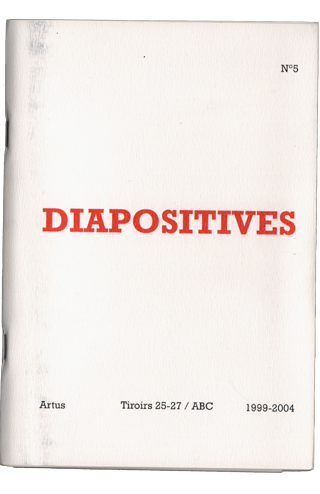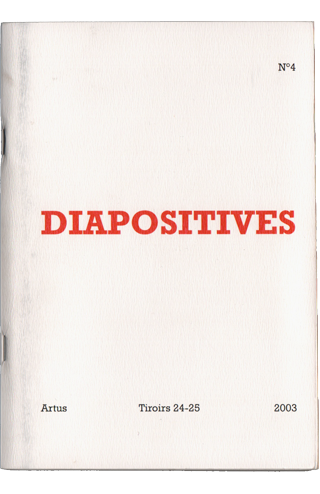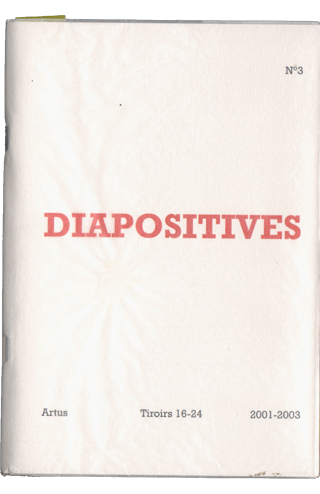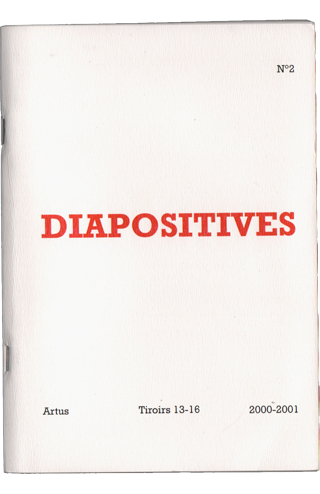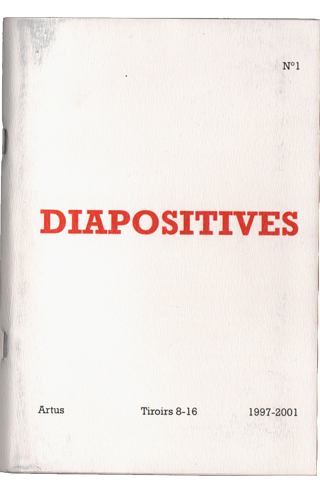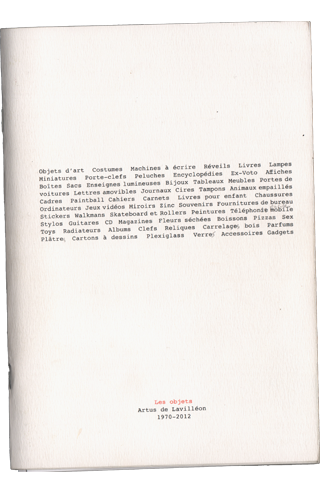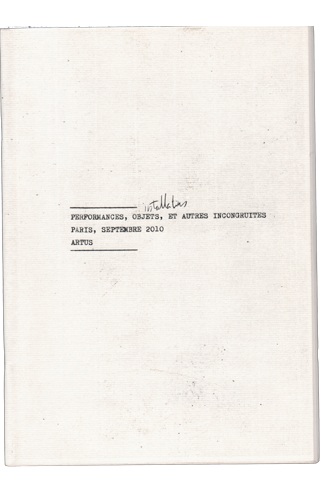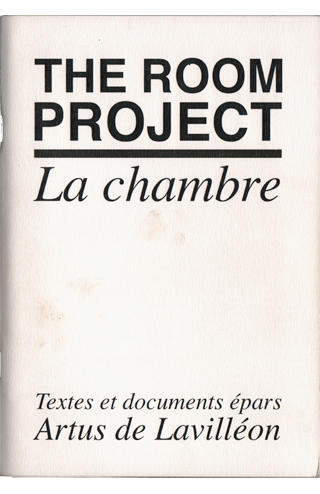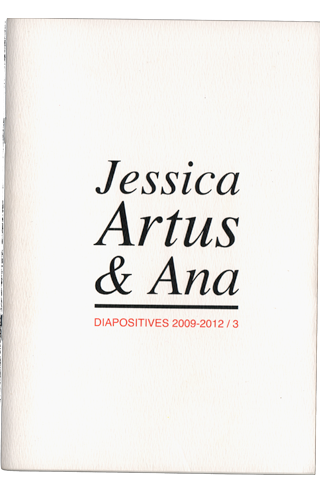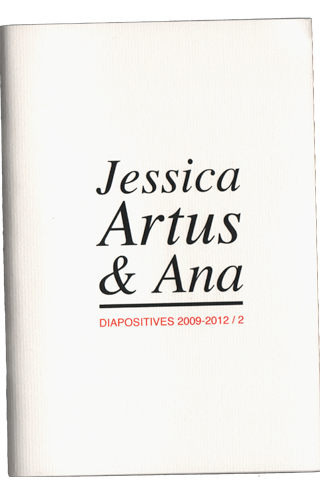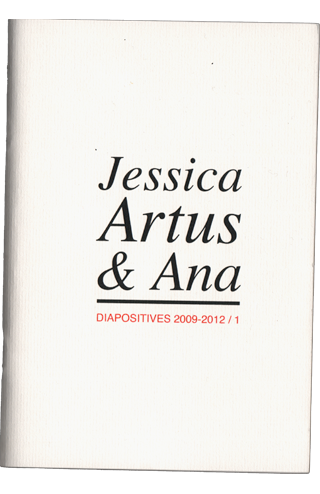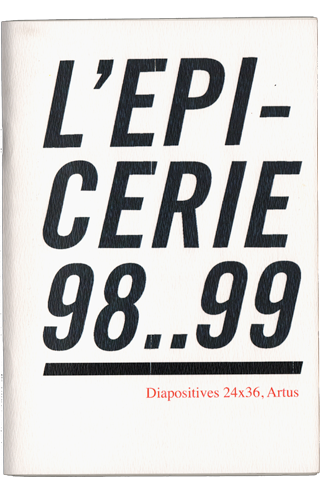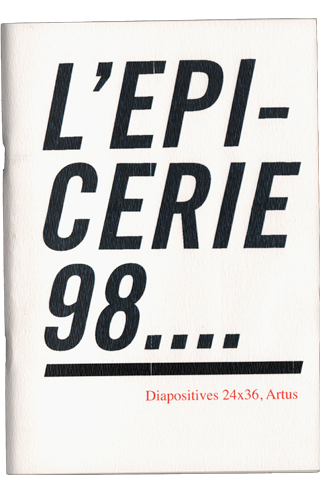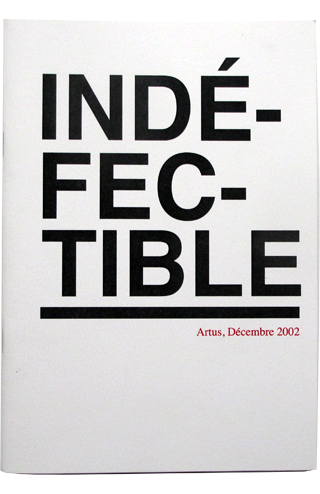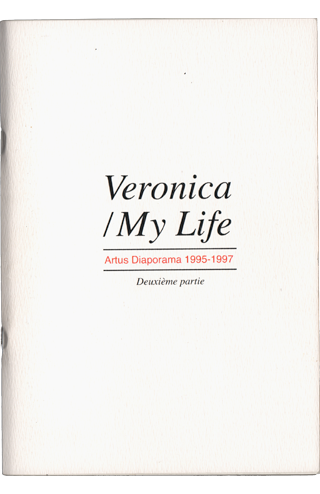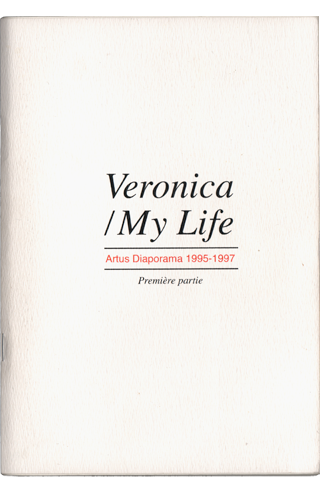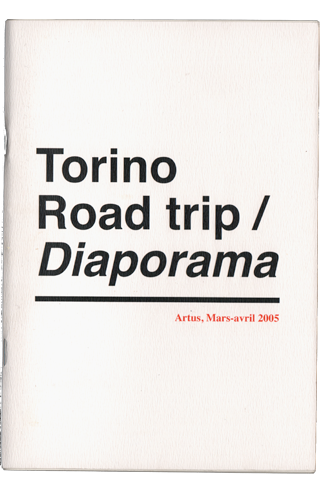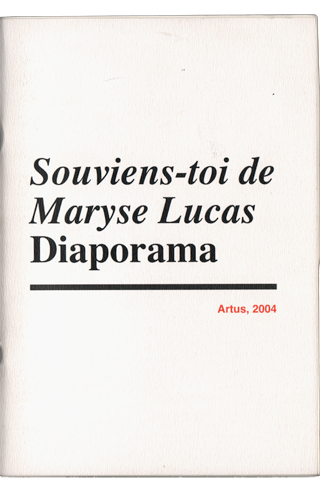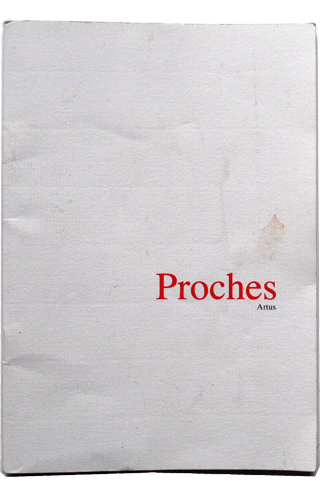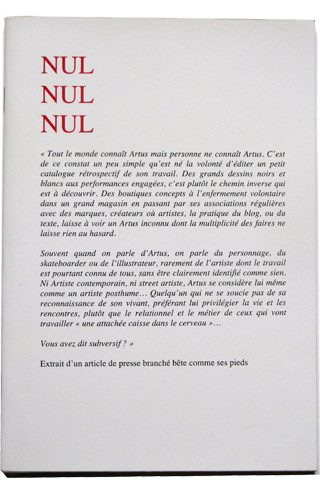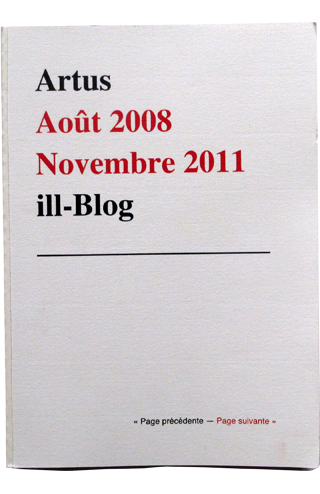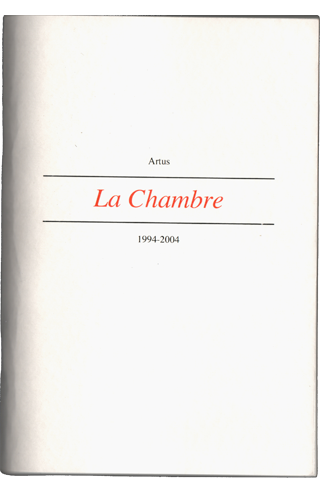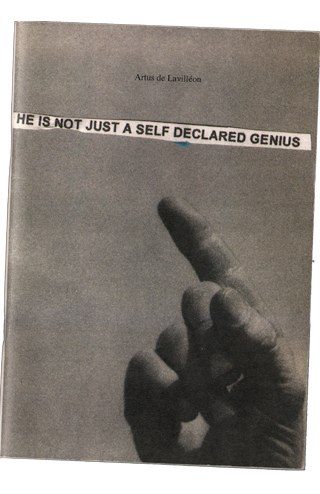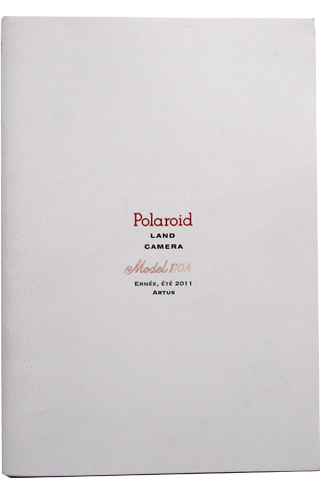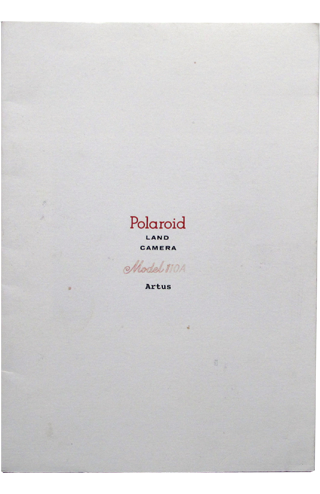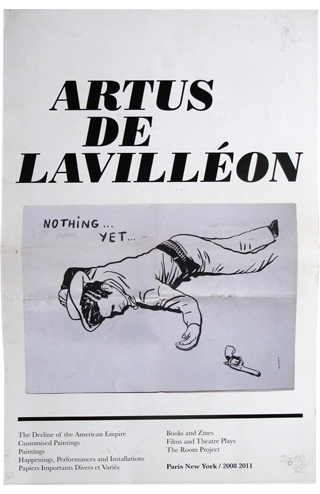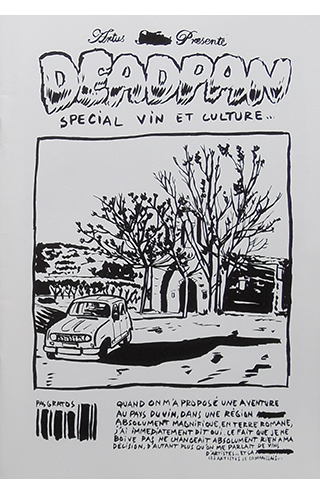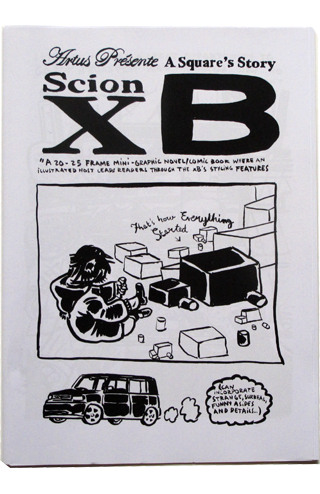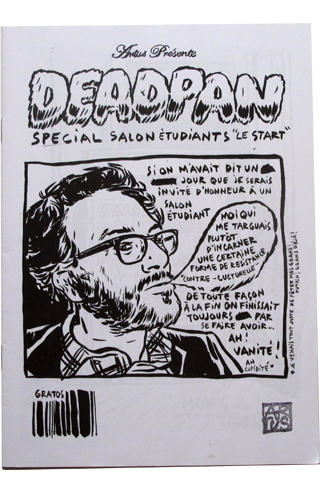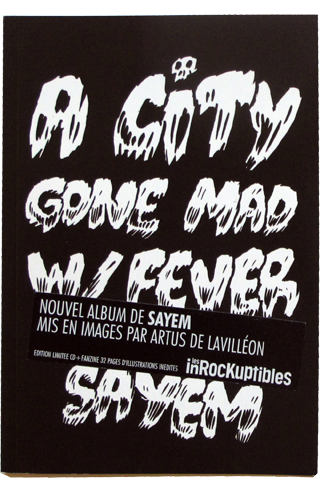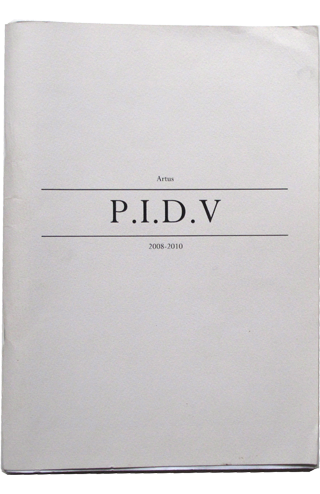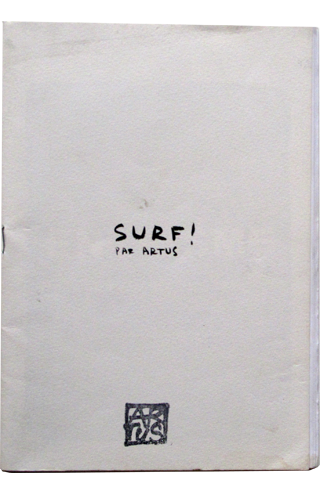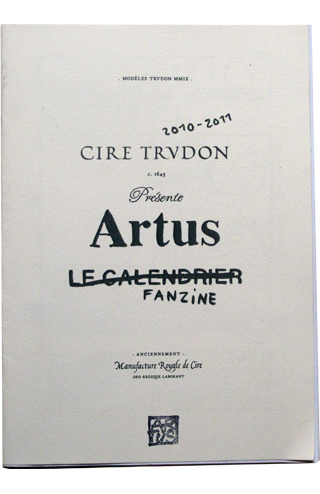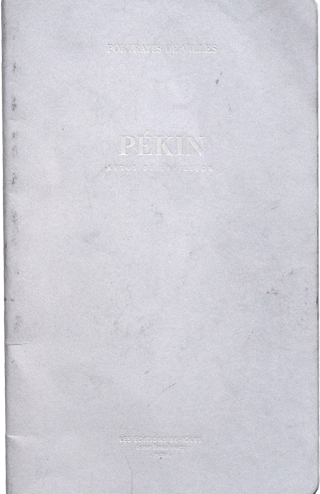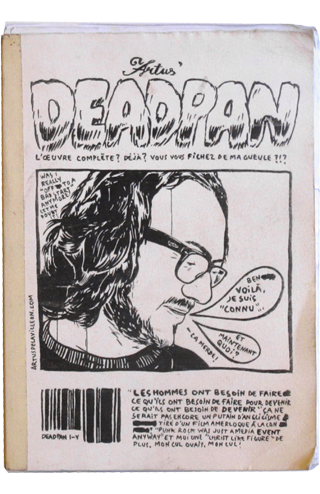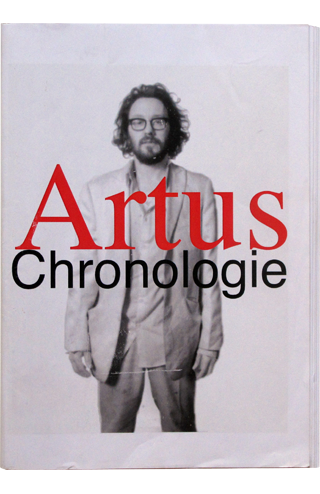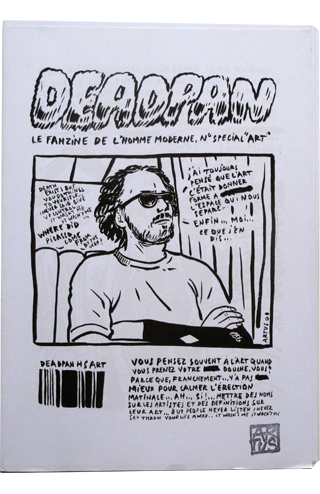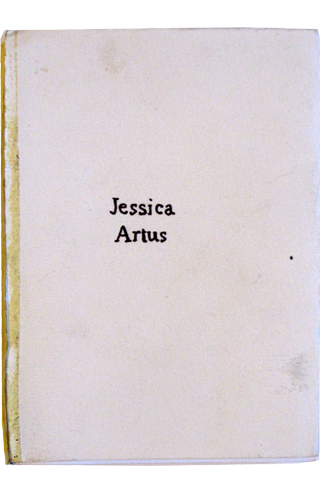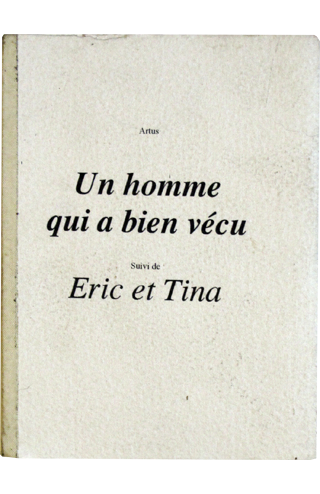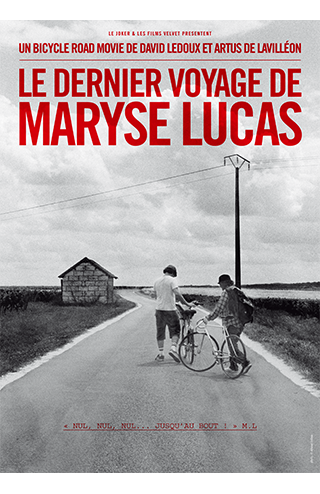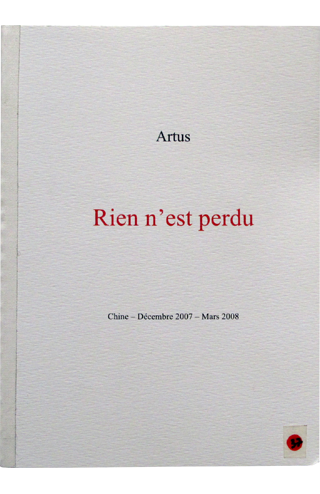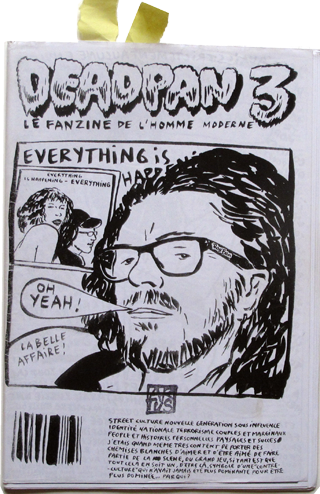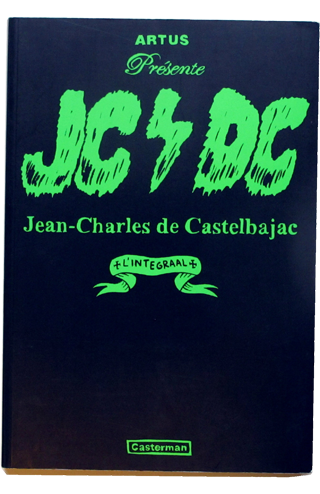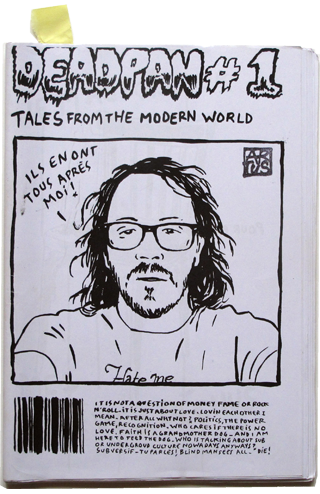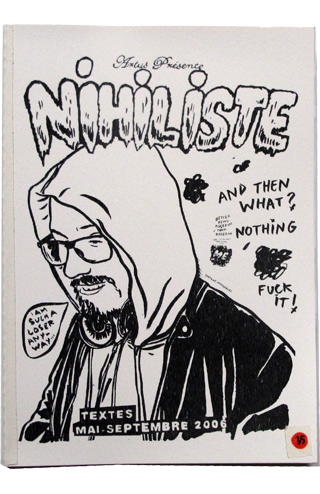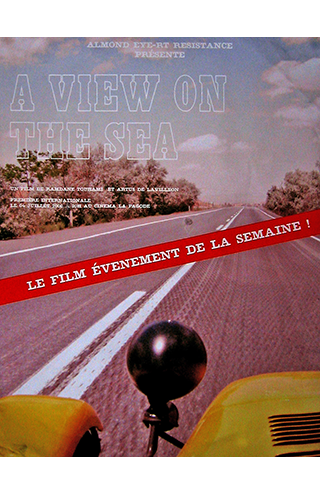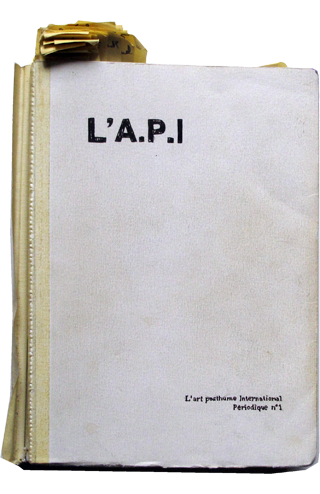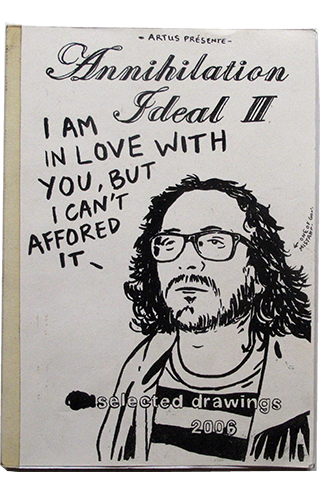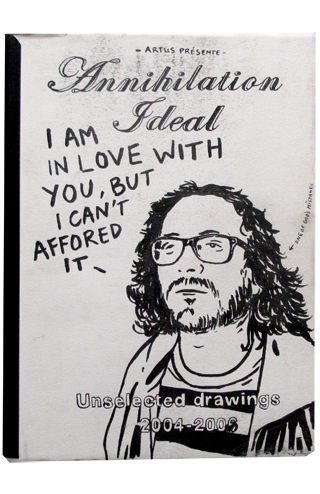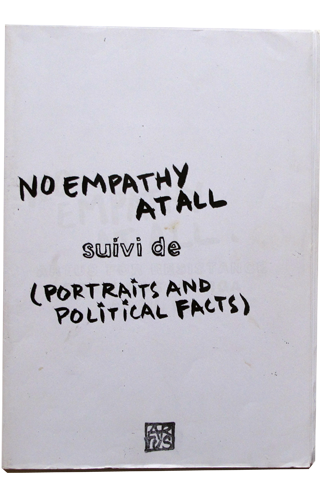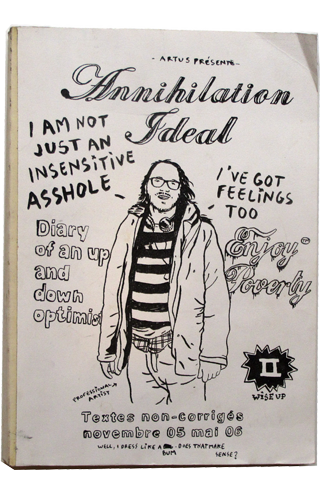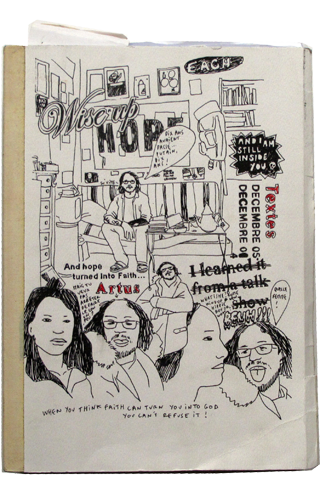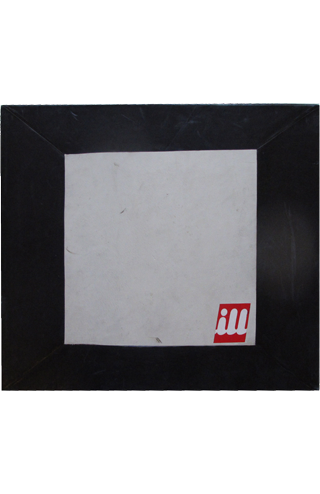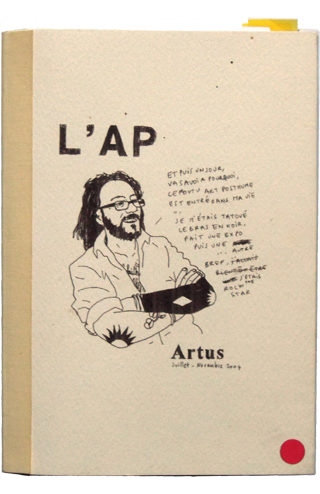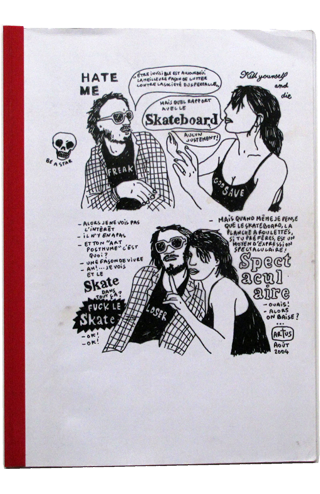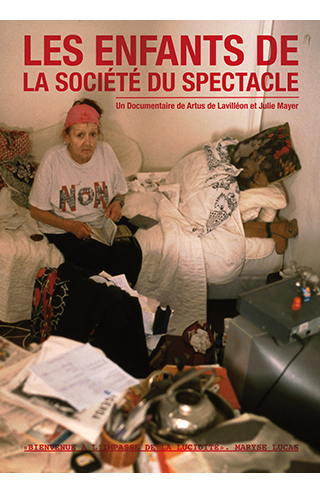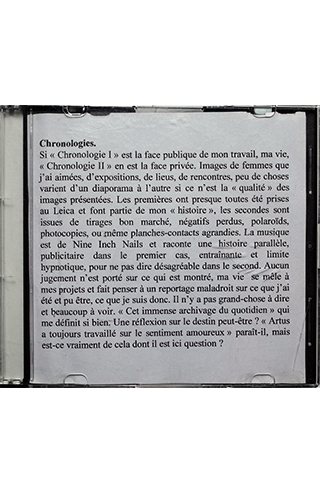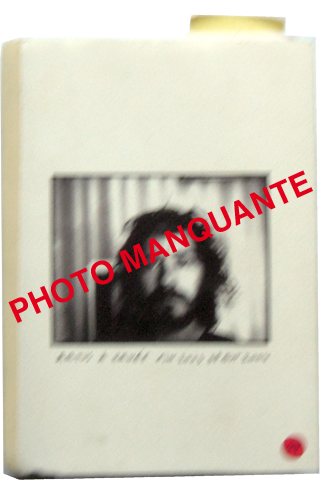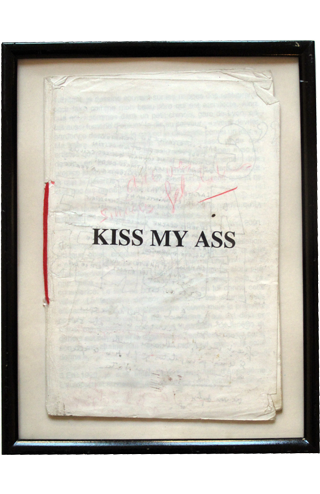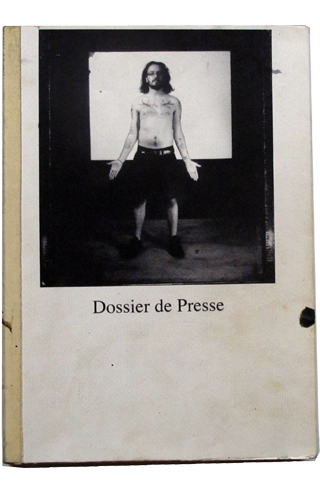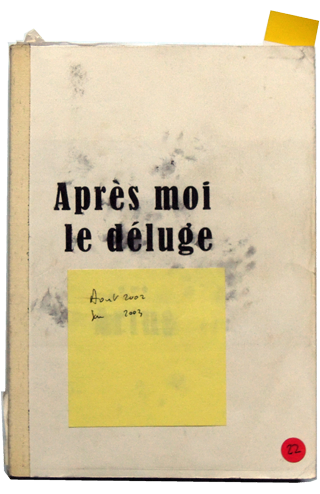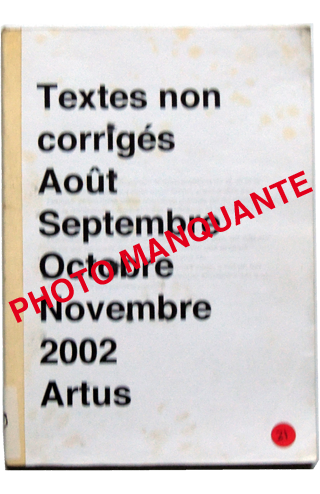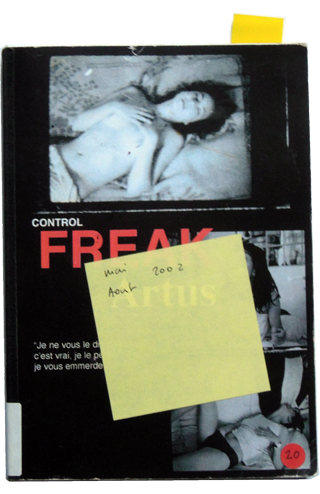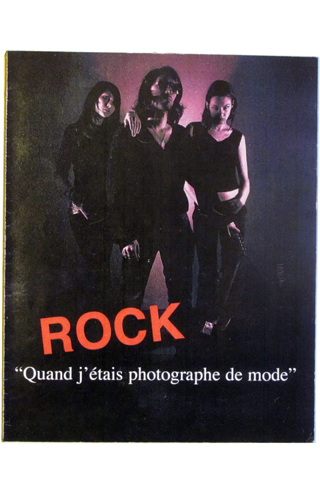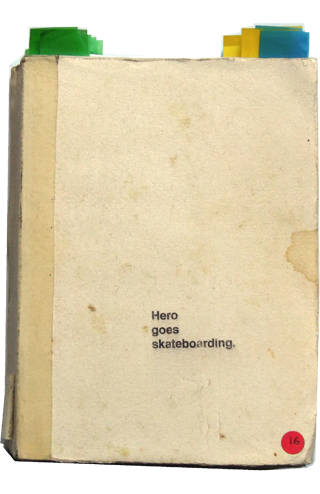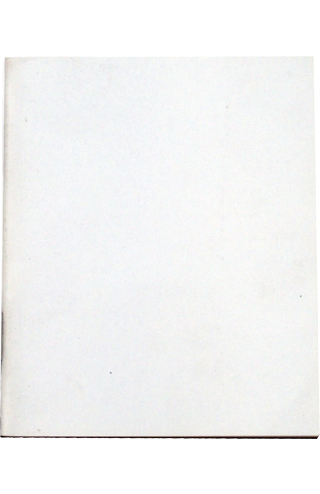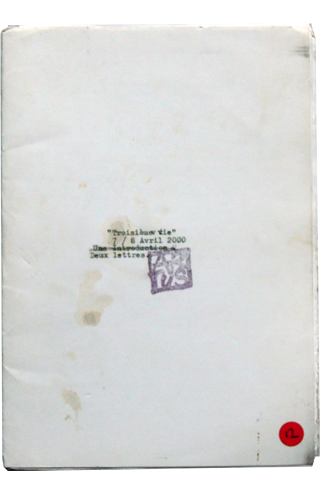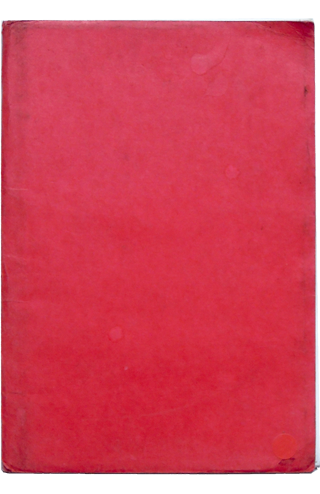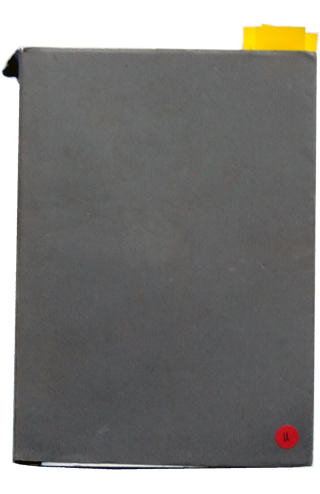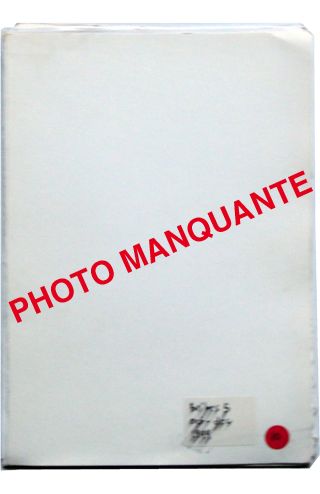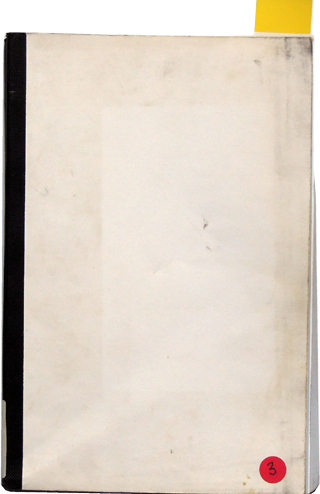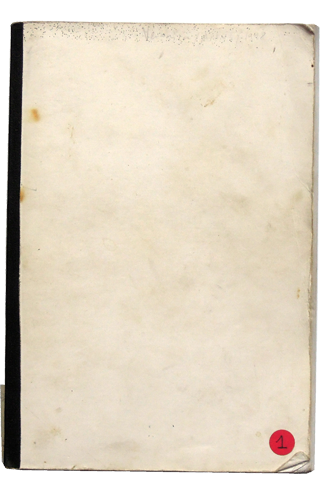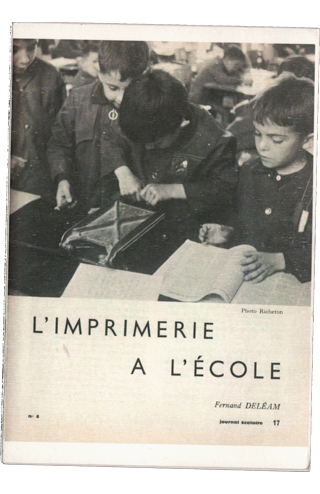Les textes qui suivent, illustrés par une image unique, figurent en introduction des photographies reproduites dans le Best of Quotidien #2
Et tout d’un coup, c’est sa vie que l’on voit s’écouler devant soi. Anti-chronologie inattendue, le projet des Best of dessine un paysage en marge de tout le reste : ce qui a été abandonné, ce qui a continué, ce qui s’est passé et ce qui n’est pas arrivé. Pourquoi cette parution rétroactive ? Pourquoi ne pas avoir commencé par le numéro 1, ou par la réédition de la première compilation de mes photos à la Plaubel ? Mes débuts au moyen format et ma prime volonté de donner à ces photographies le statut d’art ? Parce que j’avais besoin de lire à l’envers ma vie et, peut-être, ne plus commencer comme je le fais habituellement par le début. Les textes de Quotidien 1 à 14 font sans cesse référence aux textes situationnistes, à Malevitch, aux grands photographes dont j’ausculte le travail méticuleusement. L’utilisation du Hasselblad SWC/M quand à lui modifie mon rapport à la réalité. Hyper réalité du présent, volonté subie de changement. Vacances. Vie de Famille. Sortie du marché de l’art et professionnalisation de mon métier d’illustrateur, et Jessica au centre de cette nouvelle vie…
Quotidien #1
Juin – Juillet 2015
À chaque fois que je regarde les photos prises avec le Hasselblad SWC/M je suis fasciné.
En à peine un mois je réalise un nouveau tome de Quotidien pour essayer ce nouveau boîtier pour lequel j’ai un véritable coup de foudre, sans vraiment comprendre comment il marche. Les images me ressemblent sans me ressembler – comme si elles étaient habitées d’une forme d’hyperréalité. Alors que le négatif est plus petit que celui de la Plaubel, il est plus piqué, plus «métallique». Et je n’arrive pas à savoir si ces images me plaisent vraiment.
Je me balade tous les jours avec ce livre brut de scan photographié, maquetté et imprimé à la va-vite, sans réel choix dans la sélection des négatifs et positifs qui le constituent (comme souvent cela dit), constamment dans le sac à côté du Blad.
Tout y est mélangé. Photos de Jessica, d’Anatole, de skateboard, de lieux et lotissement, entre Paris, sa banlieue, et Angoulême, où je continue de tourner le film sur mon ami Batman avec un pote. Surchargé de travail comme souvent depuis que le dessin est devenu mon moyen de subsistance principal… Lutter pour ne pas me laisser enfermer par ce succès que je crois encore potentiellement éphémère.
Et puis les vacances arrivent vite. Il faut tout boucler avant de partir, mais avec quel boîtier ? Les deux Plaubel sont réparées et tout le monde me dit que le tome 1 de Quotidien me correspond mieux. Reste de mystère du fameux 38mm Biogon dont on ne sait parfois s’il est l’équivalent d’un 21, d’un 24, ou même d’un 50 mm en 23 x 36, quand on respecte scrupuleusement le niveau à bulles… l’optique préférée de Friedlander dont les livres Family in the Pictures et Stick and Stones me travaillent (un reste d’influence de Stephen Shore dans la tête).
Shooter en moyen format pour éviter le grain maintenant considéré comme « daté ». Régler son appareil manuellement pour retrouver une lenteur, un cadrage, et une réflexion qui me semble cruellement manquer en numérique… limiter le nombre de clichés aussi. Me confronter à une vision imposée par un objet intermédiaire dont l’angle de champ est si large que son empreinte sur la réalité modifiera forcément ma façon de voir les choses.
La veille du départ je suis encore au labo, puis à la photocopieuse, où j’imprime ce livre.
C’est décidé, je partirais avec le Blad, sans aucune certitude, sauf celle d’être, pour la première fois, étonné par mes propres images, si différentes et en même temps si proches de celles que j’ai toujours faites. Le tâtonnement expérimental prôné par Célestin Freinet dans sa Méthode, avec laquelle j’ai été élevé, s’oppose dans mon esprit à l’industrie du loisir artistique, et s’impose peut-être aussi comme l’embryon d’une réponse apporté à cette société du spectacle où tout semble si maîtrisé qu’on a l’impression d’y perdre tout ce qui fait notre humanité.
Quotidien #2
Juillet 2015
Parti en vacances avec le tome 1 des photos prises au Hasselblad SWC/M (qui ne me quitte plus) je me fais envoyer les scans de mes dernières pellicules par We Transfer, ainsi que mes premières photos de vacances que j’organise toujours sous le titre Quotidien. Le livre est ainsi photographié et édité en moins d’un mois.
Loin du « Best Of » des images faites à la chambre Plaubel Makina – qui étaient issues de cahiers où je collais mes tirages originaux – je suis ici dans une autre logique, proche de mes fanzines de dessins Deadpan où ce n’est pas la qualité de la photo que je cherche (alors que j’utilise l’une des meilleures optiques jamais produites), mais une forme d’accumulation qui témoigne d’un vécu réel.
Comment partager autrement la fascination qu’exerce sur moi les villes où villages pavillonnaires de la petite ou grande banlieue parisienne ou nous allons parfois voir parents ou amis, qu’en la mettant en vis-à-vis de photos de notre couple, ou d’endroits où nous passons nos vacances – ici en Provence dans les Alpilles, dont la beauté ne me paraît ni plus évidente ni plus forte, juste différente.
Je me souviens de l’immense émotion qu’avait généré en moi l’exposition The Place We Live au musée du Jeu de Paume que j’avais vue plusieurs fois. La simplicité des images, le regard critique de Robert Adams sur l’empreinte environnementale de l’homme, mais aussi son affection évidente pour les lieux photographiés. Puis la lecture de ses livres. Ses marches. La beauté des constructions humaines, quelles qu’elles soient, parfois en telle rupture avec ce qui nous entoure et notre vécu intime qu’on se demande souvent ce qui nous a amené là.
Avec la naissance d’Anatole, le temps à commencé à me manquer pour mes projets artistiques et mes propres marches se sont vite résumées à un tour du pâté de maison, ou de la résidence où nous allions passer vacances, quoi qu’il y ait aussi ici quelques photos d’Arles où Jessica s’est débrouillée pour m’emmener (sans notre fils) aux Rencontres de la Photographie que je n’avais jamais visités.
Dois-je avouer que j’ai détesté cette expérience (tout comme je déteste les foires d’art contemporain) alors que mon intérêt pour la photographie n’a jamais été aussi grand ?
Ayant découvert la culture photographique sur le tard, principalement à travers les livres, me retrouver face à Stephen Shore ou à sa rétrospective, ou à l’éditeur Xavier Barral, à qui j’aurais adoré montrer mon travail, m’a vite mis dans la position d’un jeune photographe cherchant à faire partie du milieu, ou à le comprendre.
Ajouter à cela la profusion d’images, de Walker Evans à Gusinde, en passant par d’autres expositions dont la qualité ne m’a pas paru évidente, je n’ai cessé de me questionner, durant ce cours séjour, sur ce qui me poussait à faire toutes ces photos… et sur la succession de choix qui peuvent amener à la création d’une image et à vouloir révéler un regard porté sur la réalité. Car qu’est-ce que la photo sinon cela ?
L’utilisation d’une technique qui modifie notre quotidien par le regard que l’on pose sur lui ?
Le nouvel intérêt maladif que je porte à mon nouvel appareil photo et à son grand angle soi-disant sans déformation reste incompréhensible car je me sens comme un peintre qui serait obsédé par un nouvel outil ou un nouveau format pour témoigner d’une vision en total décalage avec la technique utilisée.
Dans un SMS, que j’ai éprouvé le besoin de m’auto-envoyer, alors que je regardais l’une de ces mises en scène du spectacle artistique contemporain, j’ai noté : « – Ne rien lâcher », en me demandant pourquoi je me sentais toujours aussi mal à l’aise dans un environnement dans lequel je pourrais pourtant m’épanouir.
Et si le fait d’avoir toujours, dans mes projets comme dans ma « posture », quelque chose de raté, de trop ou de pas assez, indiquait une volonté de partager ma réalité dans ce sens ?
De montrer une forme d’humanité en dehors des apparences et des choix qu’implique la décision de vouloir devenir artiste ou photographe.
Avec toute l’acuité générée par un outil qui appuie cette volonté et permet de voir plus large « sans déformation ».
Septembre 2015.
Quotidien #3
Juillet – Août 2015
Henri Miller dirait peut-être que la meilleure façon d’être vrai c’est de mentir, ou plutôt que l’exactitude n’est pas son problème.
« Que peut-il y avoir de plus fictif que l’histoire de sa propre vie ? A force de polir ses souvenirs, on se perd, on devient un autre – soi, peut-être », écrit Béatrice Commengé dans sa biographie.
« Polir » la réalité pour faire passer notre « message » ou choisir de partager son quotidien tel qu’on l’a vécu « en tant réel », est-ce cela qui sépare les photographies de famille de grands photographes (telle que la pratique Lee Friedlander par exemple) de celles que nous collons dans nos albums personnels ? La sélection d’images opposée à la profusion des souvenirs dont elles ne se veulent pas forcément le meilleur témoignage ? L’affect qui sépare souvent la qualité d’un travail à l’empathie qu’il génère. Et le talent celui de réconcilier valeur et émotion.
En faisait de nombreux allers retours au laboratoire, mélangeant les pellicules couleur et noir & blanc, j’ai un peu perdu le fil de la chronologie. Ce fil qui est si important pour moi. Bouger les photos d’une ou deux pages, pour mieux raconter l’histoire, ou coller au plus prêt d’une réalité qui n’est pas celle de la prise de vue (mais de la mise en page) est-ce déjà tricher ?
Pour la première fois, je réalise plusieurs livres à la fois. Je jongle avec plusieurs dos argentiques Hasselblad et séries en même temps. Noir et blanc, couleur, paysages, portraits, photo d’architecture, d’intérieurs… avec la même exigence de spontanéité, sans jamais rien retoucher ou déplacer, à de rares exceptions prêt.
Léautaud, que je découvre dans la bibliothèque de mon père et de ma belle-mère (tous deux décédés), note dans son Journal Littéraire : « ce n’est pas la réalité qui m’intéresse mais ma réalité ». La seule objective finalement.
Les photos de vacances, dans leur banalité même, nous rapprochent d’un quotidien vécu au jour le jour que seule la photographie sort de son contexte, Mon fils, ma femme, quelques proches, la famille… Et puis régulièrement je fais le tour du pâté de maison du lotissement ou de la maison où nous restons quelques heures ou quelques jours.
Un ami me demande : « Pourquoi dépenses-tu autant d’argent sur tes photos alors que cela ne te rapporte rien? », et je lui lit une phrase de Baudelaire qui explique que confondre art et photographie est une erreur. Mais n’est-ce pas exactement ce que je fais ? « Pourquoi n’essaye tu pas de faire une sélection plus pointue », ajoute Jessica. « Tu devrais faire quelque chose de toutes ces images Artus » insiste une amie.
« Aujourd’hui on n’a plus le temps de prendre le temps » (Dans un livre sur Le moment robotique).
Comment expliquer sans avoir l’air prétentieux que j’essaye de mettre en place une œuvre qui se lise dans sa globalité plus que dans son détail. Comme un peintre pourrait peindre une série de toile pour rendre compréhensible une démarche qui sans cela resterait floue.
Pourtant mes photos n’ont rien de picturales, ni de réellement poétiques… Sont-elles d’ailleurs des photographies de famille ? Si je devais les définir je dirais que mes photos sont factuelles, évitant tout débat avec mes détracteurs. Elles sont issues d’un besoin constant de partager mon quotidien – mais pas seulement. Et c’est sans doute là que cela devient « compliqué ».
« Nous avons été ici ». « Nous avons fait ça ». « Nous avons vu et rencontré telle et telle personne ». « Photographié ci et ça »… Comme tout le monde, nous sommes partis en vacances, nous sommes revenus et repartis, et revenus à nouveau, années après années, parfois au même endroit, parfois pas, parfois avec les mêmes personnes, parfois avec de nouveaux amis, mais c’est la même réalité dans sa répétition et sa familiarité qui nous a entouré. .. à part que chaque réalité est unique, même dans sa plus grande banalité.
Jessica, à qui je lis ce texte ajoute : « En fait, ce que tu essaye de dire de façon assez compliquée, c’est que les gens sont toujours impressionnés par ce qui est semble inaccessible – comme la célébrité ou ce qui est montré dans les musées – en oubliant d’être émerveillés par leur quotidien ».
Je crois que deux minutes avant je lui parlais de ma lassitude des musées et des galeries, dans lesquelles je vais de plus en plus rarement. Sauf que, au milieu des vacances à Juan-les-Pins, j’ai quand-même éprouvé le besoin d’aller, seul, voir une exposition : « De Chagall à Malévitch, la révolution des avant-gardes en Russie entre 1904 et 1930 », au Grimaldi Forum, à Monaco.
Entre les Constructions de Rodchenko et Le monument à la troisième internationale de Tatline, j’ai repensé à l’émotion qu’avait généré en moi le Carré blanc sur fond blanc de Malévitch dont la seule idée avait changé ma vie. Jean-Louis Prat écrit à propos de cette exposition qu’il « parle de la liberté des artistes à exprimer leur vérité, leur temps et ainsi à imposer leurs idées ».
Je pense pour ma part qu’un grand artiste n’est pas forcément un grand révolutionnaire, ou en tout cas que c’est idée se perd dans la contemporanéité actuelle, mais celui qui sait s’approprier une évidence.
Et que ces évidences ont effectivement le pouvoir de changer le monde.
Quotidien #4
Juillet – Août 2015
Les photographies de vacances s’accumulent comme autant de preuves d’un quotidien d’une banalité exemplaire. Piscine, amis, parents, dans des paysages quelconques qui, dans ce contexte, malgré leur beauté, n’évoquent pas grand-chose.
La route défile nous amenant d’un point à un autre en traversant la Provence, le Lubéron, puis le Lot, avec un court arrêt à Nîmes pour couper le voyage en deux.
Jessica me dit : « Peut-être que ta force c’est la quantité après tout ».
Succession de moments partagés, soi-disant en marge de toute pratique artistique, alors que, peut-être, je n’ai jamais été aussi proche de ce que j’ai toujours voulu dire.
Pourtant je photographie peu. Presque toujours frontalement, sans vraiment réfléchir.
En re-regardant ces images, je trouve tout plus ou moins plat. Sauf les scènes de voiture, les plus intimes, celles où nous parlons de tout et de rien sans rien creuser en profondeur.
Anatole joue avec les enfants d’Aleksi et nous dînons avec ses parents juste à côté de la piscine.
Jessica allongée sur le lit regarde son téléphone portable tandis que j’installe mon mon pied photo.
Je lis dans les toilettes pour ne pas déranger ma petite famille.
Mais c’est vrai, pourquoi mets-je autant d’énergie dans ce projet ?
Plus les livres s’accumulent plus j’y vois une forme de résistance au « spectaculaire ».
Les bonheurs sont simples.
À travers la vitre à moitié sale je photographie les champs sans cadrer, à la vitesse de notre voyage.
Anatole fronce les sourcils pour comprendre un dessin animé.
Un camionneur regarde dans la direction d’une ligne haute tension.
Et puis les rires sur une aire d’autoroute.
Dans un livre sur le situationnisme je lis :
« Ils voulaient faire savoir à la postérité qu’ils avaient conscience de produire leur propre histoire ».
« Pour la première fois, la volonté de vivre se substituait à la volonté de puissance ».
Quotidien #5
Juillet – Août 2015
Dans la photo, il y a quelque chose de l’ordre de ce que j’ai toujours cherché en peinture.
Remettre l’œuvre dans son contexte, privilégier la vie du vivant de l’artiste, montrer sa prédominance (plus que son influence) sur sa pratique.
Il y a dans la photographie une « simplicité », qui permet une proximité plus « évidente ».
Trouver un chemin dans des images, c’est un peu comme trouver le sens d’une œuvre et par conséquent avouer chercher celui de la vie.
Pourquoi tel ou tel « sujet » s’impose-t-il à nous ? Quel est l’impact du quotidien, des rencontres, des endroits dans lesquels on va, de ce que l’on voit, sur le destin d’un homme, d’une œuvre. Comment partager ce questionnement de la façon la plus simple possible ? Pourquoi parle-t-on de moins en moins de destin ou de vies quand on parle d’une œuvre ? De l’homme qui se trouve derrière elle ? Quel est notre rôle dans la société ?
Témoigner, agir, créer. Se reculer d’un pas. Assister aux choses est-ce ne pas les vivre ?
De retour de vacances je dois attendre mes négatifs pendant plusieurs semaines, et je erre, sans vraiment savoir quoi faire, à la recherche d’un nouveau projet. Le film que je co-réalise sur mon ami Sylvain dit « Batman » est en stand by et les commandes commerciales de dessin sont rares.
Avec la vente de ma maison d’Ernée, je perds une forme de stabilité. Savoir que mes archives, peintures, documents, vont finir dans une cave, inaccessibles pour quelques années, me retourne littéralement le cerveau. Ce n’est pas qu’un accès que je perds, mais aussi une projection dans le futur et une ouverture sur le passé. Qu’est-ce qu’un artiste sans œuvre ?
Une fois les photos reçues, je réalise la masse de travail qui m’attend. Sélectionner (même à minima), organiser, classer, mettre en page, va me prendre un temps monstrueux, tandis que le projet de la chambre, que je poursuis seul, ne me permet pas de digérer toutes ces images qui sont aussi un vécu.
Me détacher des images pour mieux les voir. Comprendre leur potentiel et leur histoire propre.
Le décalage entre mes prétentions d’artiste et mon travail de photographe, ne me paraît pas incontournable, il a «l’admirable capacité de fixer les processus de la pensée vivante », comme dirait Malévitch à propos de ces textes en marge de son travail de peintre, que je relis avec avidité.
« Le temps des gifles est passé », ajoute-t-il, alors qu’il enjoint à être encore plus radical dans un texte de 1913 (Tiré du Premier congrès Pan-Russe des bardistes de l’avenir – Poètes futuristes), juste avant la réalisation du Carré.
« Il fallait une force énorme de volonté pour détruire toutes les règles et arracher la peau devenue grossière de l’âme de l’académisme et cracher au visage du bon sens »
K. Malévitch, Du cubisme au suprématisme, le nouveau réalisme pictural, 1915
« L’œuvre artistique suprême est écrite quand l’intellect est absent »
K. Malévitch, Les vices secrets des académiciens, 1916
« Mais nous forgerons notre visage dans notre temps et nos formes, nous formerons le temps, mettrons le sceau de notre visage et le laisserons dans le torrent des siècles, où il sera reconnu »
K. Malévitch, Pour une nouvelle face, 1918
Quotidien #6
Septembre – Octobre 2015
Le problème, c’est que j’arrive à un moment où je ne peux plus faire demi-tour.
Depuis que j’ai réalisé qu’exposer en galerie ne m’intéressait plus, aussi bonne la galerie soit-elle, et que je me suis progressivement retiré du marché, une sorte de lassitude m’a envahi. Mais c’est un cul-de-sac.
Je relis Malevitch, cherchant dans des textes qui sont à l’origine de ma vocation d’artiste une réponse à mon mal être présent, qui a tout à voir avec le « marché de l’art » et rien avec ma vie de famille qui est florissante et joyeuse. Je déteste devoir me justifier.
Alors j’archive compulsivement ma vie sous forme de livres et de photographies, croyant affirmer une forme de résistance par l’intime.
Quand il s’agirait de faire connaître ma position, et de la diffuser, je me noie dans un travail que je garde devers moi, ne diffusant plus rien et tenant une position en marge des réseaux sociaux soi-disant devenus incontournables, et pourtant responsables non pas de la croissance des possibles, mais de l’augmentation d’un mercantilisme policé appliqué à tous les domaines de la vie.
Ce qui ne demande aucun effort est aussi vite oublié que consommé. L’industrie du culturel, du loisir, du spectacle, de la technique, ou quelque soit le nom que l’on choisisse de lui donner, ne permet plus d’être respecté pour des positions souvent jugées obsolètes par une nouvelle génération qui ne cherche plus des nouvelles manière de contourner un système incontestable et tout puissant, mais plutôt des façons de « faire avec ».
Je cherche une issue qui ne soit pas qu’une nouvelle soumission déguisée.
Travailler seul est difficile car le besoin de partager qui m’habite est, lui, toujours aussi présent.
Comment montrer une œuvre sans passer par la phase de production qui attesterait de sa côte et la prouverait aux yeux de tous.
Comment dire que je ne crois plus au combat de l’intérieur ?
Sur France Inter, ou Culture – je ne sais plus – différents commissaires d’exposition parlent de la valeur du refus, de l’importance d’artistes qui se retirent du système, sans proposer aucune autre solution que celle, dans ce même système, de montrer leur retrait, de le monnayer, de lui donner une valeur muséale qui la justifie aux yeux de tous, faute d’avoir été comprise sans ce filtre.
Combien d’artistes travaillent aujourd’hui en marge de tout système et « produisent » « dans leur grenier », une forme d’art qu’ils ne savent pas – ou n’ont pas – envie de vendre, se méfiant des blogs et autres sites internet dont l’utilité, si elle ne leur semble pas contestable, leur apparaît comme ennemie d’une rareté qu’il défendent à la hauteur de leur investissement dans la construction d’une œuvre réelle, non d’une image.
C’est certainement dans la confusion entre les termes de vente et de partage, d’image et de réalité, que se niche le plus grand préjudice porté aux artistes aujourd’hui.
« Un bon artiste est un artiste qui vend, non un artiste qui travaille lentement et surement à établir une pratique dans le temps », dit-on. Alors que c’est justement ce décalage dans le temps qui est la seule manière de juger un artiste, et pas de décréter la viabilité de son œuvre à l’aune de son image sociale et financière, telle qu’elle est relayée dans les medias – réseaux sociaux compris, qui ne jurent que par l’immédiateté.
Cette « immédiateté » illusoire, aveugle sourde et amnésique, qui s’étend maintenant à l’infini, fait du temps présent un laboratoire en constante mutation, ignorant de son passé comme de son futur, aussi sûr du bon droit de ses laborantins (producteurs/diffuseurs) que nous sommes certains d’avoir abdiqué pour le meilleur notre pouvoir décisionnaire à la masse toute puissante. Celle qui ne se trompe jamais…
(…)
Alors que je me noie dans ces débats, je découvre la biographie de Walker Evans, où est décrite « la première exposition dédiée à un photographe jamais organisée par le Museum of modern art » de New York en 1938, où, contre la volonté du directeur il recadre, découpe, et séquence son travail afin d’imposer un sens de lecture et une « narration» à ses images, la veille du vernissage (sans se soucier de créer une séquence différente de celle du livre).
Ce geste, me fait réaliser à quel point le photographe est à la fois proche de l’artiste et de l’écrivain.
Comme l’artiste, il poursuit un but qui le dépasse souvent et suit une logique qui, même dans ses commandes commerciales, telles qu’elles seront plus tard réintégrées dans son œuvre, laisse transparaître son identité.
Comme l’écrivain, son œuvre se limite souvent à deux ou trois livres qui témoignent d’un regard sur le monde, d’une pensée, et d’une vision dans laquelle on se reconnaît parfois.
Comme l’artiste et l’écrivain l’exposition (médiatique ou muséale), ne résume jamais son regard.
Ce regard, qui peut glisser à la surface des choses ou être engagé, documentaire ou topographique, « objectif » ou subjectif, abstrait ou concret, factuel ou conceptuel, voir informel, ne change rien à la force d’identification que porte en soi tout travail abouti, quel que soit le filtre (magazine, expositions, médias divers et variés) qui nous a amené à lui.
Comme le peintre, et comme tout créateur, le photographe est à la recherche de quelque chose qui est à la fois en lui et hors lui, et auquel il doit donner forme.
- Mais le photographe doit faire avec la réalité telle qu’il la perçoit et la retransmet, ce qui ne veut pas forcément dire telle qu’elle est.
Comment entrer dans une photographie – et à plus forte raison dans une œuvre, en ignorant cela, à un moment de l’histoire où l’on cherche plus à gommer les différences qu’à les exacerber ?
Et surtout, qu’est-ce qui fait que certains photographes sont définitivement des artistes avec une écriture qui dépasse de loin tous ces débats, quand ne reste que cette « image » d’une réalité qui n’est pas simplement la leur et auquel il est impossible de les réduire, dans le temps présent, comme dans les temps futurs.
Quotidien #7
Octobre – Décembre 2015
Quelques jours après les attentats du 13 novembre, je reçois un texto d’un ami : « En fait, plus il y a d’attentats, plus tu te fais de pognon… ». Mes dessins sont publiés dans M le magazine du Monde, Les Inrocks (dont je fais la une), Elle… et je suis contacté par différents magazines étrangers pour illustrer ce qui se passe en France (finalement sans parutions à la clef). Malgré la tentation de prendre mon appareil photo pour faire le tour des lieux ou subsistent encore des traces de la violence terroriste, je me cantonne au média (le dessin) qui « me rapporte le plus », celui aussi ou je peux exprimer, par des courts textes, ce que je pense des évènements.
Bizarrement, j’éprouve peu d’empathie pour la France en tant que Nation, car je suis trop au courant (pour l’avoir traversée) de ce que peu représenter la destruction d’une partie de la Syrie, ou de la réalité de ce que l’on nomme les frappes chirurgicales sur des terroristes et leurs familles dans les pays « où ils se cachent ». Je sens déjà venir la dérive sécuritaire, et ne peux que hocher la tête quand un autre ami me forwarde la vidéo d’Alain Badiou « à partir des meurtres de masse du 13 novembre », diffusée sur Youtube, où il parle notamment de la création de zones de non-droit hautement profitables pour l’occident, et dont le terrorisme ne peut-être que la conséquence logique.
Bien que je trouve la vidéo très inégale, et proche du lieu commun par certains côtés, elle a le mérite de « mettre les pieds dans le plat ».
Les tensions après la vente de ma maison de campagne d’Ernée avec Jessica (que faire de toutes mes archives), sont à leur apogée, je dors peu ou mal, et suis très tendu. Mon dos se bloque régulièrement – ce que la pratique du dessin n’arrange pas, et mon projet de film sur le skate est plus ou moins en pause. C’est une période difficile à tous les points de vue. Mon ami Michel Vedette m’invite pour la première fois à l’un de ses shows (très impressionnant), et nous allons rendre visite à des amis en banlieue (Fontainebleau, L’Étang-la-ville) où je photographie ces maisons dans lesquelles je sais que je ne pourrais jamais vivre, fasciné par la tristesse de ces portes fermées, haies, et autres bâtisses préfabriquées (ou pas) que la présence proche de la forêt ne rend pas plus sympathiques à mes yeux. Qu’allons nous faire de l’argent de la vente d’Ernée, acheter un 50m2 à Paris, un 80 dans le Grand Paris, une petite maison en Ile de France, une grande en province ? Et toujours cette question de mes archives, mes peintures, le déménagement à organiser, juste au moment où je me sentais prêt à me lancer à corps perdu dans le projet de La Chambre (qu’il faut lui aussi stocker).
Jessica, qui est en train de monter sa boîte de production avec une amie, rompt tout dialogue avec moi, et c’est, peut-être pour la première fois de ma vie, qu’un horizon me paraît aussi bouché – mis à part le dessin que je commence à regarder d’un autre œil avec une petite évolution de « mon style », qui est de plus en plus détaillé, et me permet de continuer de témoigner de mon quotidien par magazine interposé. Particulièrement pour un mensuel japonais qui m’offre un chronique sur Paris, ou je raconte un peu ce que je veux. Du marché des Enfants Rouges à Château Rouge, en passant par la crise du logement que j’illustre avec un dessin de mon atelier d’artiste de 15m2, « où j’ai passé presque toute ma vie ».
Ici j’entends très bien Jessica me dire : «Toujours la même rengaine ».
De plus Anatole et Jessica ont des problèmes de santé alarmants qui nécessitent scanners et opérations potentielles (tout s’arrangera début 2016).
Les photos que je fais de Villerupt, dans l’est de la France, où habitent les grands-parents de Jessica sont tristes à souhait, la pluie, la pauvreté, les maisons à vendre, et Anatole, toujours souriant qui grandit au milieu de tout ça.
Le retour sur l’Île Saint Louis, où nous vivons, nous fait bien relativiser et comprendre à quel point nous vivons dans un petit paradis. La visites des amis, Natasha, Julien ; Titus et sa femme, le premier film auquel a participé Jessica au cinéma ; et le week-end à Trouville chez Vanessa avec Marie, permettent de prendre un peu de recul sur une situation pleine d’évolutions possibles.
Et puis il y a les attentats du 13 novembre. Juste au moment où les premiers tirs retentissent, le téléphone de Saskia, qui est venue manger chez nous, sonne. Sa sœur travaille dans un bar du côté de la rue de Charonne. Il est 9h20. Personne de notre entourage proche ne sera touché. Dès le lendemain nous décidons de nous éloigner de Paris. À notre retour, quelqu’un crie, « – Rentrez chez vous ! Rentrez chez vous ! Ça tire à Répu ! »… Fausse alerte.
Une semaine plus tard, le correspondant d’un magazine allemand me dit qu’il allait rejoindre des amis au petit Cambodge. Ils ont juste eu le temps de se cacher derrière une table et de lui envoyer un texto : « – Ne viens pas ».
Quand je regarde les photos que j’ai fait les semaines suivantes, à l’occasion de la visite d’un ami, et de quelques balades dans Paris, je réalise à quel point j’ai moi aussi été marqué par ces attentats (sans rentrer dans le détail de ce que je peux comprendre des motivations des terroristes et de l’orient contre l’occident).
Photos de vitrines avec des armes jouet, puis réelles, instruments de musique, grilles, gerbes de fleurs, une boutique de services funéraires, des drapeaux, un vétérinaire et une auto école (?).
Anatole regarde Le Roi et l’Oiseau :
Voix (Ton très monotone) : Premier étage, affaires courantes, contentieux, trésorerie, orfèvrerie, trésor public, impôts et taxes, liquidation (Le Roi fait non de la tête), solde de tout compte, famille royale (L’ascenseur reprend sa montée). Prison d’état, prison d’été, prison d’hiver, prison d’automne et de printemps, bagne pour petits et grands (L’ascenseur traverse un étage immense, murs gris, pont-levis, plusieurs étages de prisons), équipement militaire, ministère de la guerre et des hostilités, sous-secrétariat d’état à la paix, panoplies en tout genre (Étage supérieur : extérieur) bonneterie, feux d’artifices, dernière cartouche, fourrure, chapeaux, képis, trompettes, brosses à reluire et tambours, gendarmerie, lavatories, manu-militari, grandes imprimeries royales (Vue de l’intérieur de l’ascenseur : le Roi droit, immobile, le regard fixe), lettres de cachet, taxes et impôts, contrainte par corps (Ascenseur : extérieur), oubliettes et catacombes, passementerie et casse-tête, ombrelles et parapluies, casino, tir au pigeon, musée de l’armée, jardin des plantes (L’ascenseur ralentit devant le zoo ; singes), galerie des ancêtres, grands ateliers du roi, asile de nuit du roi, gibier de potence du roi, salon de coiffure du roi (L’ascenseur monte toujours à l’extérieur du palais, porté par une tige), pédicure du roi, bains de vapeur du roi, grandes eaux lumineuses du roi (L’oiseau s’approche du hublot de l’ascenseur et se moque du Roi), musique de chambre du roi, trompettes de la garde du roi.
Cravate Hermès à 100 Euros, merdes de pigeons. Pile là où j’ai perdu le viseur de mon Hasselblad, introuvable. Pause.
Je mettrais cinq mois à réaliser ce nouveau tome de quotidien, et à m’habituer à mon nouveau viseur, très cher, plus clair, mais moins précis que le précédent.
Paris, le 3 mars 2016.
Quotidien #8
Décembre 2015
Essayer, essayer encore jusqu’à ce qu’on y arrive, ne jamais rien lâcher. Même quand la photo est mauvaise, même lorsqu’elle est incapable de traduire un sentiment. Remonter sur sa planche et essayer à nouveau, encore et encore de sauter ces marches, tomber, se relever. Je suis un skateboarder qui ne fait plus de skateboard, ou presque plus, autrement que pour aller d’un point à un autre. Je n’imprime plus mes livres qui restent dorénavant dans mon ordinateur où dans mon ipad pro dernier cri qui me suis partout, mais sort très rarement de mon sac. Oui, juste à côté du Hasselblad SWC/M qui ne m’a jamais paru aussi encombrant. J’essaye vaguement la photo au Flash, de trouver de nouvelles possibilités. Parlais-je d’art pour justifier des photos sans intérêt ? Rennes, Paris, Angoulême, Ernée. Plus de neuf mois que j’ai pris ces photos. Écrire une introduction me paraît aussi pénible que de comprendre pourquoi je continue de vouloir archiver ma vie, coûte que coûte. Remplir tous les vides. Ne rien laisser derrière qui ne soit justifié par un texte ou une image, pour raconter un moment de vie, le partager, absolument. C’est une période malheureuse. La grande maison d’Ernée que j’aimais tant est vendue. Je pars dans un petit village près de Rennes signer « les foutus papiers », seul. Je erre dans les rues, profitant d’un changement de train que j’ai choisi long pour me vider la tête. Puis je photographie la fête foraine, le paradis juste à côté de l’église et en face du notaire. Space métal. Je marche aussi à Paris d’un quartier à un autre, shootant n’importe quoi n’importe comment, dans l’idée de continuer des séries que je ne maquette plus. Un chapitre de ma vie est en train de se clore. Noël approche, mais, mis à part la photo de couverture de ce nouveau tome de Quotidien, où Jessica et moi avant l’air plus heureux que jamais, tout me semble triste, insurmontable, morose. Étrangement, il n’y a pas une photo d’Anatole (sans doute pour l’épargner) dans cet album de famille qui n’est pas plus cela qu’autre chose. Michel le Bayon, le vieil ami de ma mère, décrète au passage que notre fils de quatre ans est infernal et refusera dorénavant de nous voir avec lui. Jessica monte une boite de production et filme son amie Saskia chez Martine alors que je continue de dessiner pour les magazines et sort de plus en plus rarement. Nous nous engueulons sans cesse. Sur une fin de pellicule apparaissent les photos de l’écran de télé contemporaines des attentats du 13 novembre 2015. Mon ami Daniele est là, dans un coin de l’image, à photographier le mémorial improvisé de République. Nous sommes le jour d’après. Fred Mathias, chez qui j’avais un temps prévu de stocker une partie de mes affaires, passe nous voir en coup de vent, voir quelques expositions d’art brut et s’arrêter sur la place de la république « pleurer la violence et l’imbécillité ». Je ne sais pas quoi penser de son émotion qui me laisse assez froid. Puis je file à Angoulême voir mes amis quelques jours, où, dans la bibliothèque de Sam, les livres de spiritualité avoisinent des ouvrages sur les sérials killers… Je gagne ma première OUT Session depuis des mois devant la Cité Internationale de la Bande Dessinée et de de l’Image contre mes vieux amis skateurs Sam et XP avant d’aller déménager la grande maison. Mais où stocker près de Paris « toutes mes merdes » (comme dit sans cesse jessica), plus de 10 ans de travail artistique, le projet de la chambre, et quelques rares meubles que j’ai tenu à garder. Le plan est simple : chez des amis de Jess à Fontainebleau avant de rapidement acheter sur Paris un bien en nous endettant sur 25 ans et en empruntant de l’argent aux parents de Jessica qui, au dernier moment annulent leur proposition, puisque Jessica a déjà hérité de son grand-père et qu’il me reste encore ma chambre à vendre. « Que je ne vendrais jamais car elle est aussi un projet artistique ». Retour à la case départ. Pourquoi ais-je vendu ma grande maison au fait ? Pétri m’accompagne à Ernée où je photographie une dernière fois la cabane à Pizza du supermarché (que je n’ai jamais réussi à prendre correctement en photo avant) et où il fait un portrait de moi devant la maison qui ne m’appartient déjà plus, avec Gwendoline, notre charmante petite voisine que je ne reverrais sans doute jamais. Photos sous exposées, granuleuses, floues, où je souris néanmoins. Que va-t-on faire maintenant ?
Paris, le 3 septembre 2016.
Quotidien #9
Janvier – Février 2016
Noël en famille, Paris et la campagne, à la recherche d’une maison dans l’Yonne, Anatole et mon beau-père, Ambleteuse, Boulogne-sur-Mer, Fontainebleau, Local Hero, Pierre-Hyppolite et Thibault, Natacha Andrews, le terrorisme, les dessins, Arthur Koestler, Fred et Daniele, Paris, Anatole chez le barbier, Calixte, Artus sur The Berrics, Nicolas Levy, et Vigipirate…
Photos nulles et non advenues, incapacité de choisir, portraits en double qui témoignent d’une volonté de dépassement de l’album de famille mais échouent (forcément) dans leur but avoué. Archiver, archiver sans cesse et sans fin, se perdre dans les méandres d’une décision prise et jamais reniée, ne pas regarder en arrière, jamais, et, pourtant, se confondre dans la contemplation trop rapide de ces images censées évoquer des souvenirs.
Je sais maintenant pourquoi je ne voulais pas reregarder ces images, les convoquer dans ma tentative d’épuisement d’une relation au bord de l’implosion. Notre couple ne se suffit plus à lui-même car il est sans cesse parasité par mon art et ces même décisions qui font de moi ce que je suis, ce que je veux être et que jamais je ne renierais.
Comment être sans faire ? Comment faire sans être. Les images s’entassent comme autant de piles de linge sale, usé jusqu’à la corde ou rongé par les mythes. Ceux que je m’invente. Odeur nauséabonde de l’artiste qui a pourtant raison , dans sa folie, mais surtout de son propre point de vue.
Lutte continuelle, acharnée. Guerre.
Non je ne céderais pas. Non. Jamais, dusais-je me perdre, et au hasard de cette perte et de ces retrouvailles m’égarer encore, car je crois à l’échec, je crois aux erreurs, je crois à tout ce qui m’a fait et est indissociable de ce moi que pourtant la raison, et mon couple, renient. Emprunter, c’est ne pas être soi. Mais peut-être le devenir.
Ce chemin-là n’est pas le mien car j’ai choisi, mais comment et surtout pourquoi emmener ma famille avec moi dans cette aventure qui n’est faite ni pour l’aventurier, ni d’aventures autres que celles du quotidien. Ce quotidien qui ronge par sa banalité, sa répétition, et l’envie, constante, de fuir au loin mais ensemble. Toujours ensemble. Quoiqu’il arrive. Unis, même par nos désacords.
A home is home. Nous l’emporterions partout avec nous cette maison qui n’est pas qu’une chambre, sauf qu’ici nous parlons de 55m3 soit 800 tonnes de bordel. 800 tonnes ? Le calcul me parait exorbitant. Prix à revoir.
Nous n’iront pas vivre ici ou là, mais juste sous notre nez. Bloqués. A la recherche d’une échappatoire que nous n’avons pas encore trouvée.
Devenir veut avant tout dire être.
Dimanche 4 septembre 2016.
Quotidien #10
Mars – Avril 2016
Les images se ressemblent et s’annulent. Il n’y a plus de limites. une image est reproduite une fois, deux fois, quatre fois. À peu de détails près il s’agit de la même image, sauf qu’aucune image n’est identique à la précédente et que ce sont ces infimes détails qui les différencient qui font leur valeur. Plus que jamais je suis incapable de choisir, parce que choisir ne m’intéresse pas. C’est l’intégralité de l’expérience qui m’intéresse, quitte à lasser mon lecteur. Alors plutôt que d’en mettre moins je choisi d’ajouter ces images «qui ne servent à rien» et «desservent mon travail». Elle en sont le fondement même. Certaines personnes sont obsédées par les planches contact des grands photographes. Comment font-ils leurs choix ? Pourquoi telle image plus que telle autre ? Parce qu’elle s’impose comme un résumé ? Il y a quelque chose dans la lumière, dans le cadrage, dans l’expression de la personne photographié, ou du lieu, qui fait que… Parfois il s’agit de quelque chose d’infime, une main qui entre dans le champ, un détail que l’on a «photoshopé», un recadrage. ici c’est l’expérience intégrale qui est offerte. Anatole ouvre son paquet cadeau et découvre un magnifique bateau pirate, il est ému, joue avec, demande à prendre un bain avec le bateau et à ce que je le photographie avec son nouveau jouet. Quelques jours plus tard il va au jardin du Luxembourg l’essayer avec son amoureuse Yasmine. Jessica est présente sur la plupart des images, c’est un très bon moment. Ces images prennent une place non négligeables dans ce nouveau tome de Quotidien. Notre fils à quatre ans déjà. Après une fin d’année 2015 difficile nous décidons en début d’année de partir à Venise. Pourquoi avoir associé ces deux séries et ajouté une session de skate à la fin de cet ouvrage ? Pourquoi avoir séparé les photos des parents de mon ami skateboarder Batman pour les mettre en face de celles de Jean-Charles de Castelbajac ? À cause du film que je fais sur Sylvain, parce que la chronologie (respectée) me paraît ici avoir un sens ? Et que veulent dire ces dates qui ne se suivent pas, se mélangent au gré des allers retours chez Negatif + qui ne développe pas à la même vitesse la couleur et le noir et blanc ? Au milieu de tout cela une photo d’Anatole chez Louis et Dominique, mon Beau-père et sa femme, dans leur maison de l’Yonne ou nous cherchons toujours à acheter, m’émeut particulièrement. Lauren, Arlette, Sam, Violette et Romain avec leurs enfants, Donald & Pipo, Daniele, XP et Fred m’accompagnent dans cette nouvelle période de vie. Bonheur retrouvé. J’ai skaté pour la première fois un full pipe (même si personne ne m’a pris en photo) et commencé une nouvelle série sur les grands magasins au flash… Aucune photo ne me paraît réellement supérieure aux autres, mais quelle importance ? En fin de compte, je crois qu’ici, tel n’est pas leur but.
Lundi 5 septembre 2016.
Quotidien #11
Avril – Mai 2016
Le jour de l’anniversaire de Jessica nous partons nous balader avec Anatole, qui s’endort dans sa poussette, et trouvons un petit restaurant, très sympathique, où nous célébrons avant tout la joie d’être une famille unie. Anatole ne nous quitte plus. Faute d’argent et de famille proche de mon côté, nous le donnons rarement à garder, et, si la fatigue nous surprend parfois, le fait d’être sans cesse ensemble est un bonheur éternellement renouvelé. Les amis, Ramdane, Fred, Daniele, Calixte, Sylvain, Pétri et Saskia viennent parfois nous rendre visite dans un quotidien qui s’inscrit dans la durée de l’enfance. Amitiés passagères avec d’autres parents, allers-retours au parc, lever à 7h, dîner à 7h. C’est une nouvelle vie que je découvre… depuis maintenant 4 ans, sans réellement m’y habituer. Après Venise, la mère de Nicolas (mon agent), Natasha, nous prête son incroyable maison dans les Alpilles. Un vrai miracle dans notre vie de couple toujours pas réellement remis de la vente de ma maison d’Ernée et de plus d’une année d’engueulades continuelles – malgré notre amour indéfectible. Le mistral souffle parfois sur les bassins de rétention d’eau, vides en cette saison, et la maison, quoique sublime et bientôt classée aux monuments historiques, se fissure au grès des glissements de terrain, paraît-il sans grands réels risques pour sa structure architecturale. Les grenouilles et les crapauds, les oliviers et les grandes promenades à deux ou à trois, nous font un bien fou. Les Saintes-Maries-de-la-Mer, la Camargue… Tout est si beau. Alors que nous sommes là à paresser au soleil mon téléphone sonne et on me propose, suite à un travail pour un magasin de design, de réaliser le carton d’invitation pour une exposition à New-York. Je demande si je ne peux pas plutôt venir réaliser une fresque « live », en échange d’un séjour d’une dizaine de jours tous frais payés à New-York « avec mon vélo ». Le projet, immédiatement accepté me ravi. Retour à Paris, chorale, parc, dîner et petits déjeuners (à 7h), j’avoue être content de repartir aussitôt, quoique l’idée d’abandonner ma femme et mon fils pour une semaine me fende déjà le cœur. Après une journée passée dans la banlieue où a grandit Jessica avec son père et son frère (que je trouve toujours aussi fascinante et d’une certaine manière aussi merveilleuse et belle que les Alpilles – dans un autre genre), je me dirige vers l’aéroport le cœur léger, heureux. Dans Un art moyen, de Pierre Bourdieu, je lis :
« On peut décrire ainsi les motivations de l’activité photographique : Le fait de prendre des photographies, d’en conserver ou de les regarder peut apporter des satisfactions dans cinq domaines : la protection contre le temps, la communication avec autrui et l’expression des sentiments, la réalisation de soi-même, le prestige social, la distraction ou l’évasion ».
Que vais-je bien pouvoir photographier à New-York, une fois éloigné de mon Quotidien ?
Jeudi 8 septembre 2016.
Quotidien #12
Juin – Aoüt 2016
Quand je regarde ces nouvelles images, je réalise à quel point le quotidien a pris le dessus sur la pratique photographique, ou même artistique. Quoique je continue d’expérimenter la photo au flash on sent une forme de lassitude dans le procédé photographique. Les photos sont moins cadrées, on les sent prises à la volée, comme un travail bâclé que l’on ne continue encore que poussé par l’habitude et la nécessité de continuer un projet dont les limites se font de plus en plus vaporeuses. Premières photos, dernières photos, photos de vacances, archivage du quotidien, tout se mélange pour n’avoir plus aucun sens ; et pourtant… C’est dans cet égarement que ce trouve peut-être le meilleur de ce travail. Jessica me dit : la photo au flash tue toute la douceur de ces instants partagés. Les copains d’Anatole, le parc de la pointe, les enfants qui s’invitent les uns chez les autres, les parents qui se rapprochent, les anciens amis devenus parents à leur tour qui proposent goûter (avec les enfants) ou terrasses de café (sans), ou refusent de nous voir accompagné de nos charmants bambins… La famille et les amis lointains qui rappliquent, fascinés par ce curieux ballet de l’évolution… Moments volés, temps de rien et nécessité de ne rien abandonner.
Nous continuons de chercher une maison à acheter dans l’Yonne, faisons des travaux rue Portefoin, mêlons voyages de plaisir et professionnels. Jessica part dans le sud une semaine pour me laisser travailler à ma guise. Je suis censé scanner mes livres et commencer à poster des choses sur Instagram, ce travail, par exemple, mais je refuse de m’y résoudre et commence une grande auto-interview où je tente, bien mal, de me justifier à mes propres yeux.
Comment traduire un ressenti, un instinct, une impression que rien ne vient étayer et surtout pas l’air du temps. Dans l’avion qui me ramène de New York je lis dans Popisme d’Andy Warhol et Pat Hackett (Mais peut-être ais-je déjà cité ce livre) qu’être Underground veut surtout dire qu’on veut qu’on nous laisse tranquille. (La phrase exacte est : « Mais je ne sais même pas ce que le terme « underground » peut vouloir dire, à moins que ça ne veuilles dire que vous ne voulez pas qu’on entende parler de vous, qu’on ne vous dérange pas, de la façon dont ça se passait sous Staline et Hitler. Mais dans ce cas là, je ne vois pas en quoi j’ai jamais été « Underground » puisque, au contraire, j’ai toujours voulu que l’on me remarque »).
Archiver ma vie dans le but de partager cette production un jour, dans mon cas, ne veut pas dire que j’accepte pour autant de trouver une forme qui coïncide nécessairement à mon époque (même si mon travail y fait sans cesse référence, puisqu’il est très ancré dans une réalité extrêmement centré sur le partage, l’autopromotion et l’autofiction – un terme que je déteste, puisque seule la réalité – ma réalité dans ce quelle à de plus subjectif, et donc vrai, m’intéresse). Passer par le biais des réseaux sociaux, ce serait d’une certaine manière rendre les armes. Telle est en tout cas mon opinion.
Le cours séjour que nous faisons chez Jean-René de Fleurieu, l’ancien mari d’Agnès b. avec qui Jessica s’est liée, pour aller voir le festival de la photo d’Arles, me plaît énormément puisque rien n’y est réellement attendu, sauf le château et sa piscine qui plaît beaucoup à notre fils – qui tombe immédiatement amoureux de Jean-René « patate pourrie ». On y croise des gens qui semblent assez libres et d’autres beaucoup moins sur fond de conversations sur Les Bordes, Gettary, Pierre Mendès-France, et les Situs.
Le festival D’Arles est cette année une véritable déception puisqu’il est pris d’assaut par « l’art contemporain », dans ce qu’il a de plus « spectaculaire ». Les expos sont pour certaines tellement surproduites qu’elles en deviennent insipides, un travers qui me dégoute encore un peu plus d’un monde dont je suis absolument de moins en moins certain de vouloir faire partie.
A la fin du séjour Jean-René, qui nous a beaucoup écouté lui raconter nos questionnements, nous propose de nous installer au château avec lui et nous fait visiter deux jolies dépendances qu’il est prêt à nous prêter « autant de temps que nous le voudrions », ainsi qu’une autre aile pour, pourquoi pas, y faire une expositions pendant le festival d’Arles 2017, « si nous le désirons ».
La proposition est trop tentante pour que nous n’y réfléchissions pas sérieusement, mais quelque chose nous gêne néanmoins. J’écris d’une traite un pré-projet dont les derniers mots créent une légère brouille entre Jessica, lui et moi, et annule une expérience de vie qui aurait pu s’avérer grandiose. « Dommage » comme le dit Jean-René dans un dernier texto qui met fin à ce projet. Resteront des souvenirs émerveillés de sa générosité et de sa contagieuse folie «d’une autre époque sans doute ».
Vendredi 9 septembre 2016.
Quotidien #13
Juillet 2016
Le Quotidien numéro 13, resté inachevé, décrit notre dernière tentative de visite avant de nous installer au Mont Saint Sulpice, et de commencer les travaux de la maison dans laquelle nous ne savons pas encore que nous allons vivre. L’idée de déménager en banlieue, dans le Grand-Paris («de l’autre côté du périph’»), ou dans une ville de province de grande ou moyenne envergure ne nous tentant pas trop, nous décidons néanmoins de passer un mois à Marseille pour voir si la vie pourrait potentiellement nous y plaire. C’est un échec, malgré la mer, les relations professionnelles possibles, et une merveilleuse semaine de camping avec des amis dans l’arrière pays. De retour à Paris, pressé par le temps, nous retournons presque par hasard voir la seule maison qui nous aie réellement plu en Bourgogne, entre Sens et Auxerre et l’achetons sur un coup de tête. La photo qui clôt cet ouvrage, et une grande période de vie, a été prise dans la chambre où s’est conclue notre histoire avec Jessica. On nous y voit, avec Anatole, et le Fuji GA 645 qui remplacera pour un temps très court le Hasselblad SWC/M que j’abandonne dans l’idée d’enfin arrêter d’archiver mon quotidien comme le grand maniaque que je suis devenu. Arrivé au tome 30 de Quotidien, ne me préoccupant plus ou à peine des tomes restés en suspend, comme ce dernier d’un nouveau Best Of, je me questionne sur mon incapacité à cesser de partager mon vécu, comme je l’ai toujours fait, dans l’intimité, comme dans mon travail artistique, pour réaliser que cet échec est finalement, ma plus grande victoire.
Mercredi 30 mai 2018.