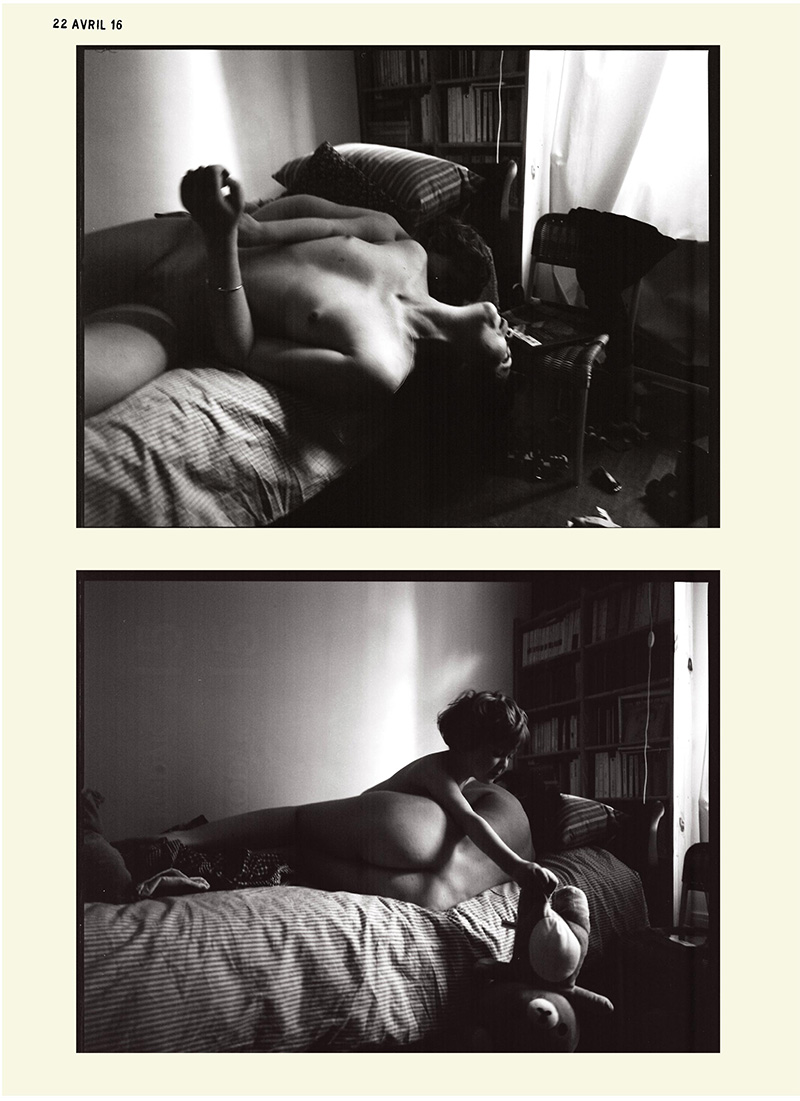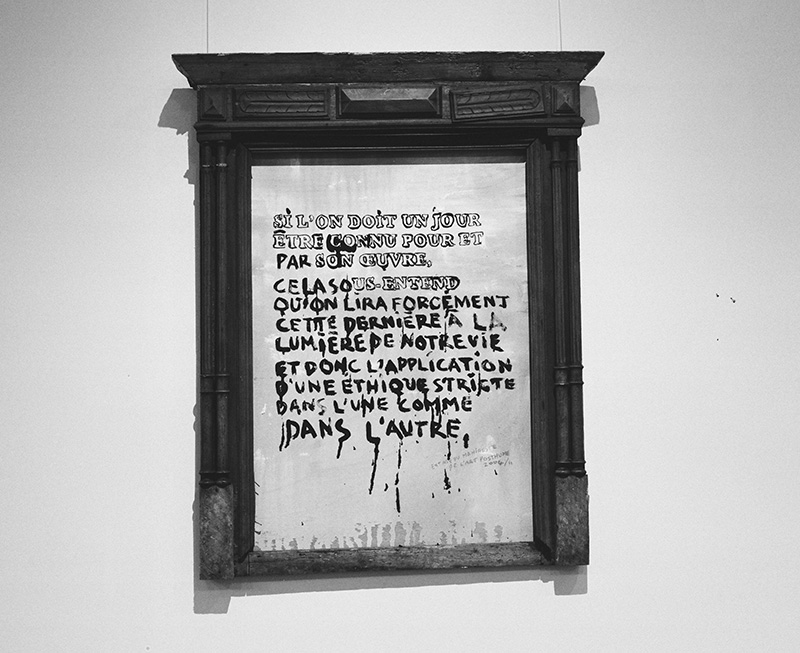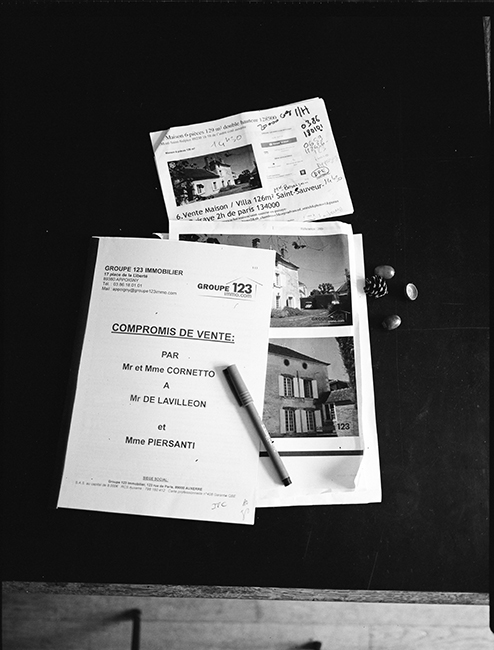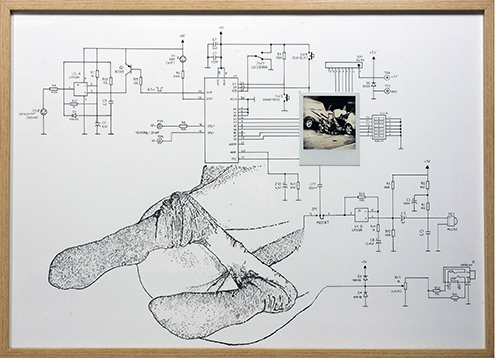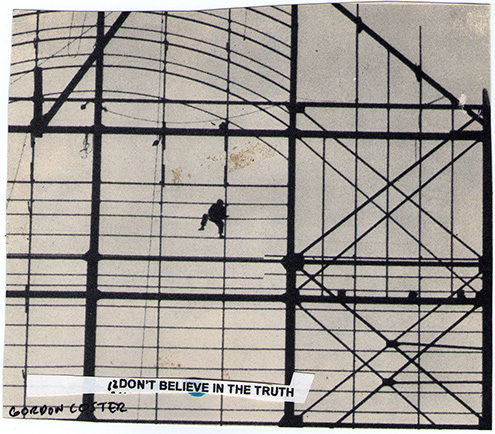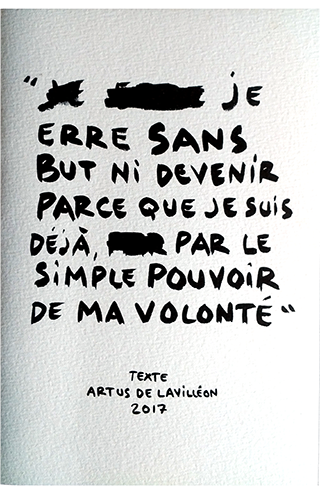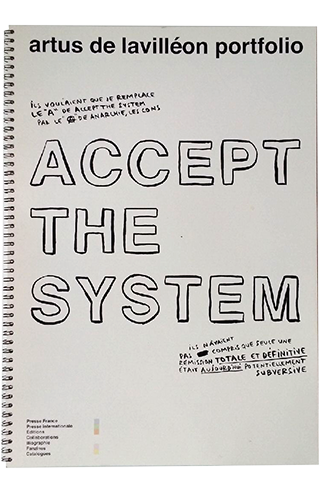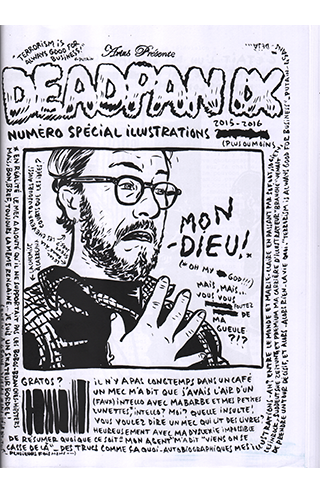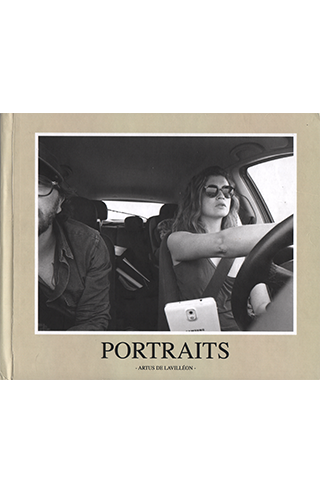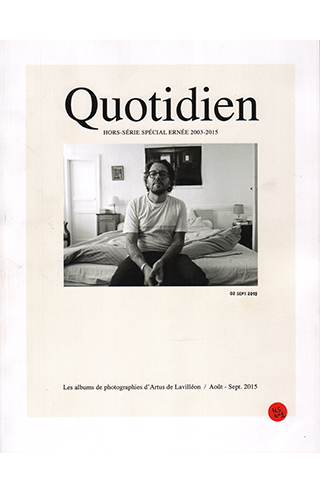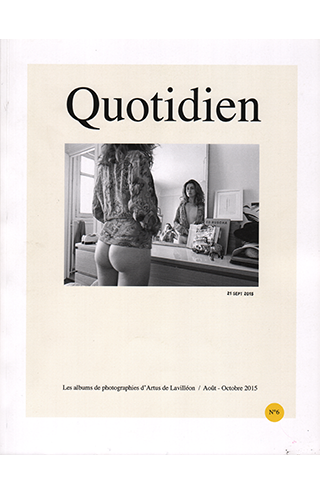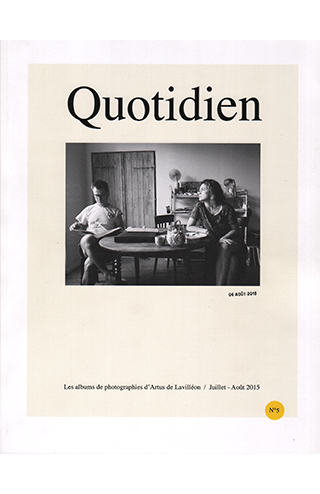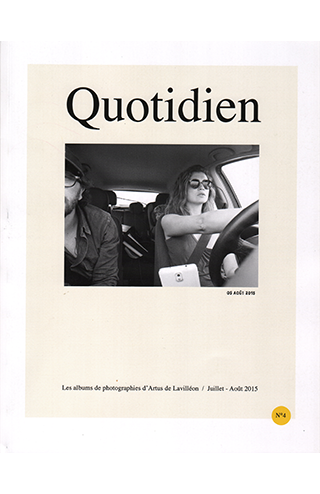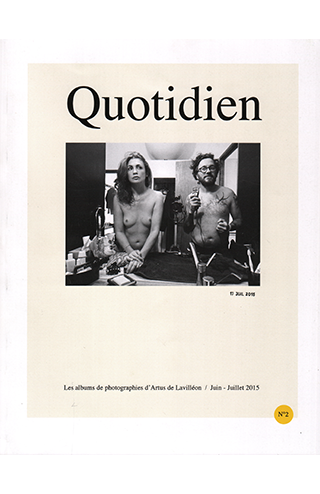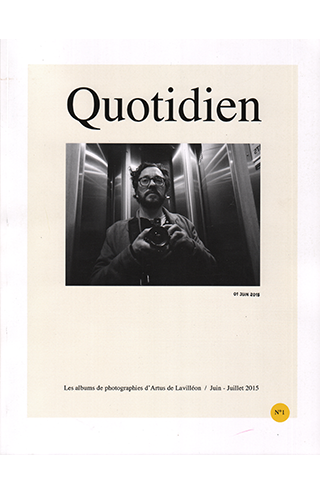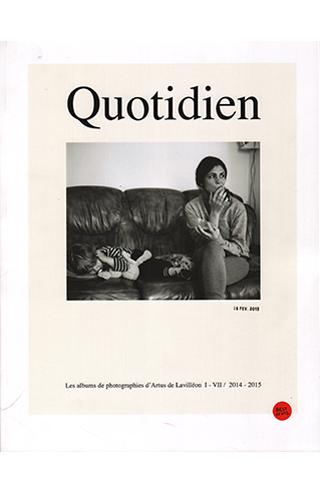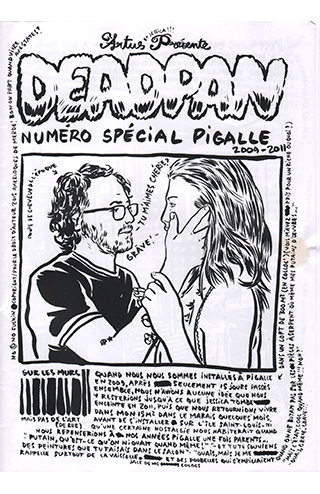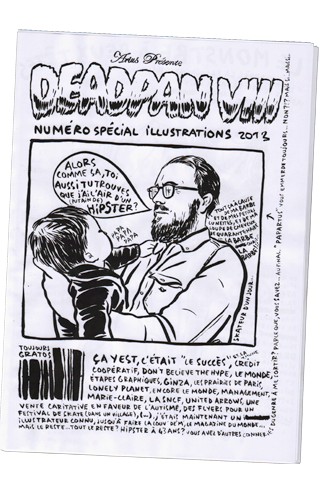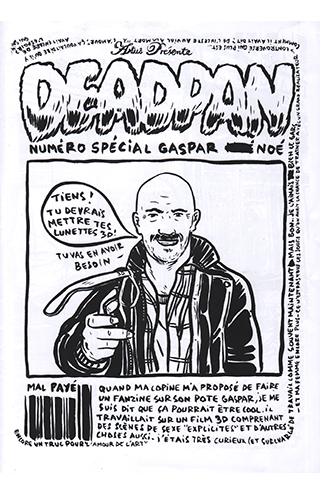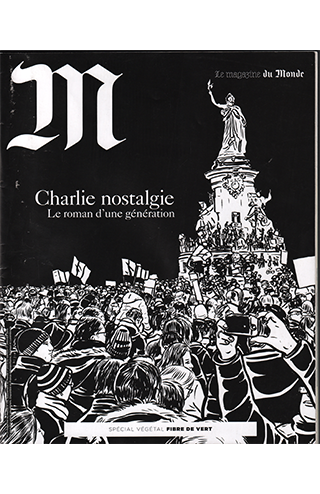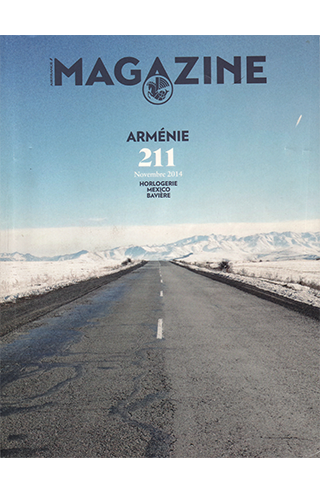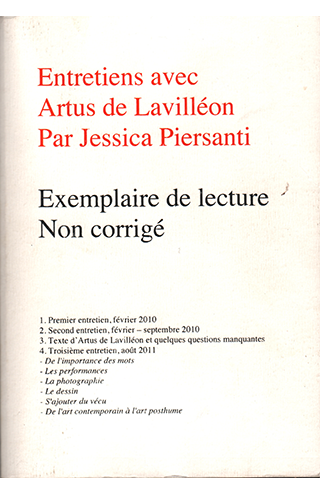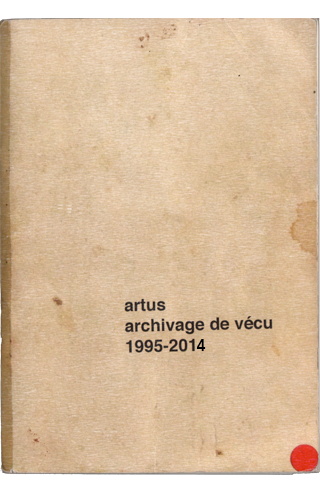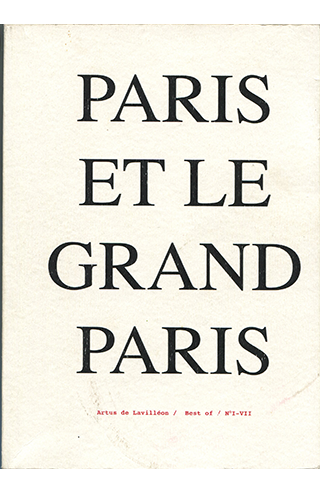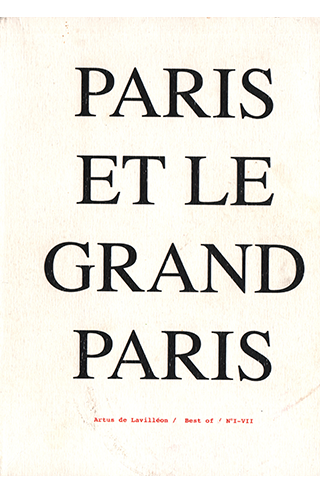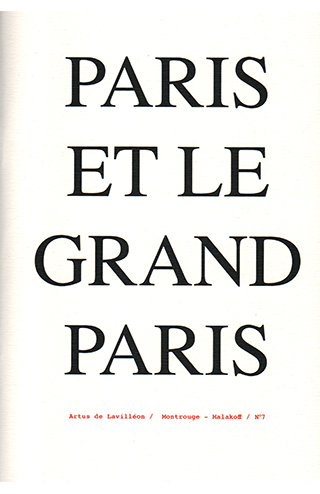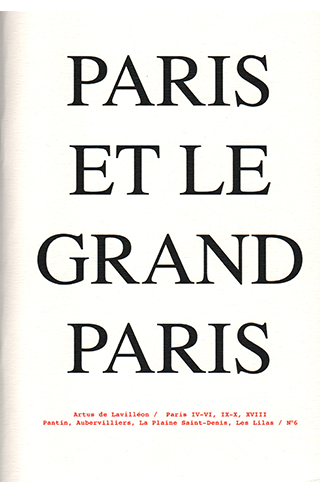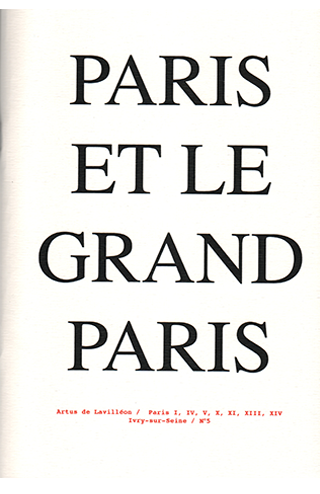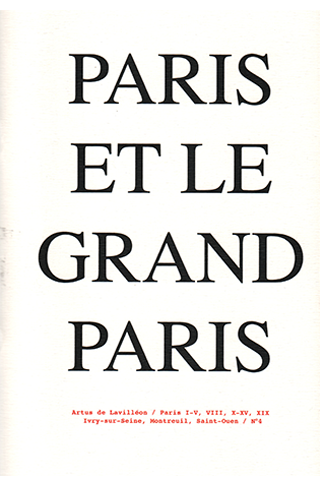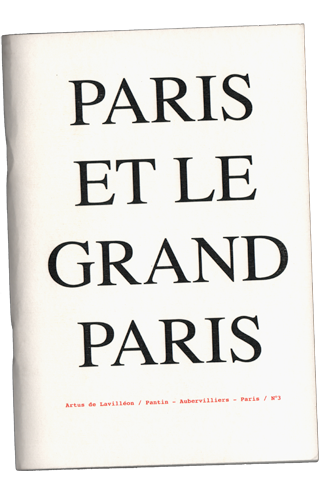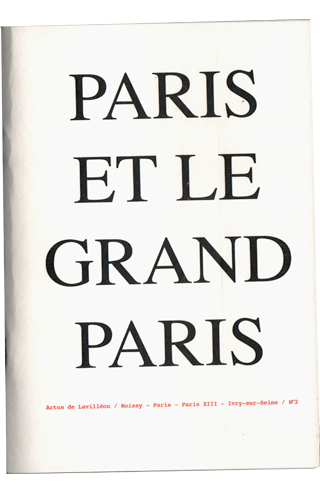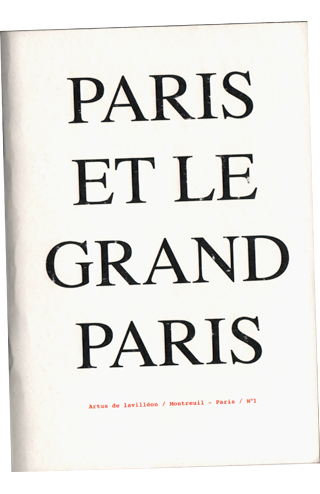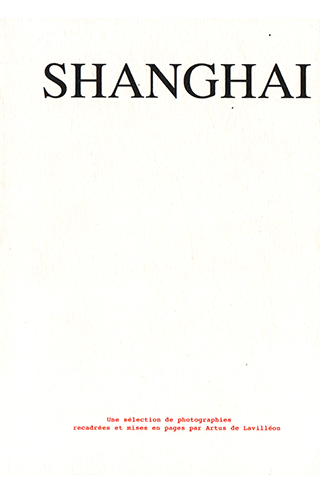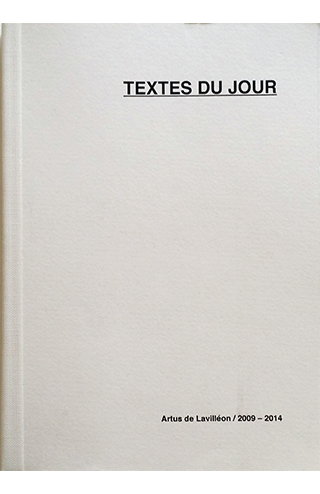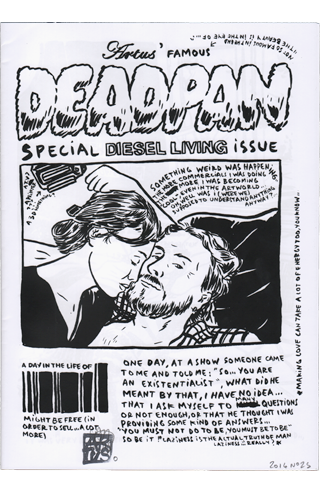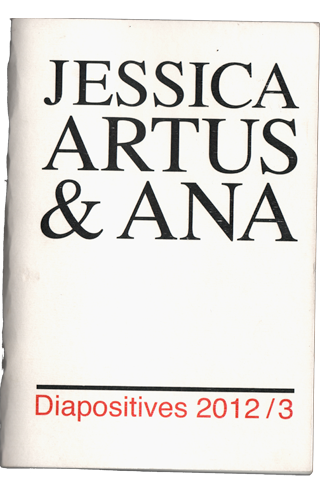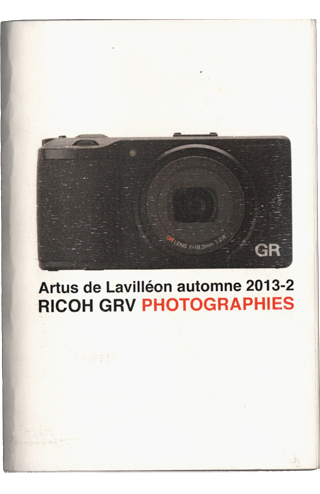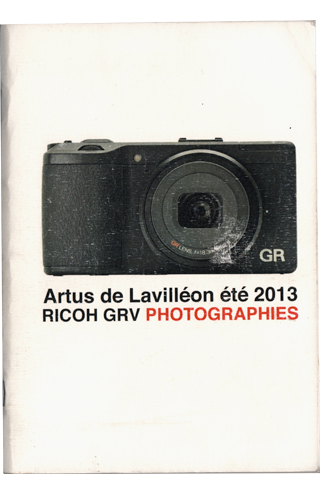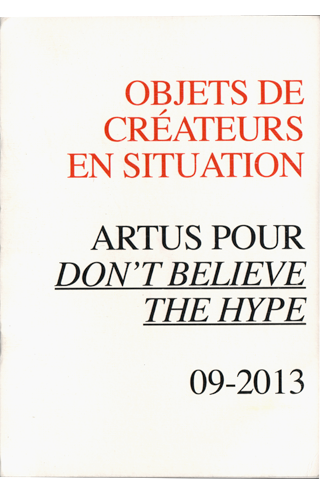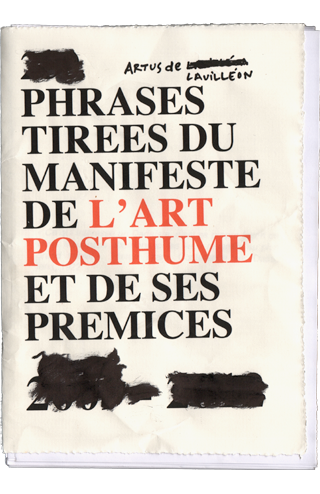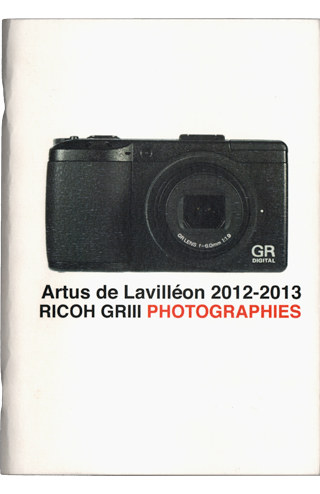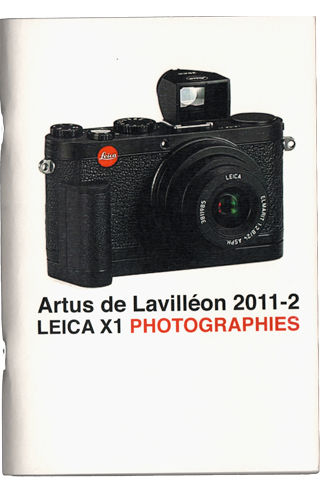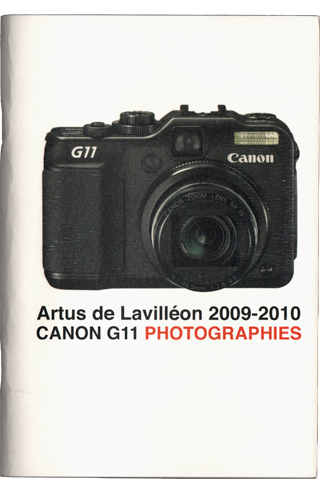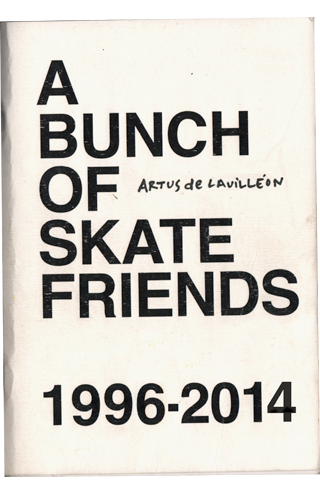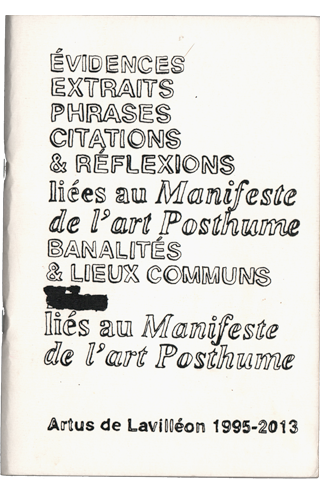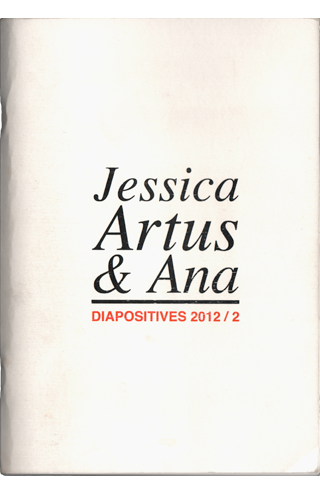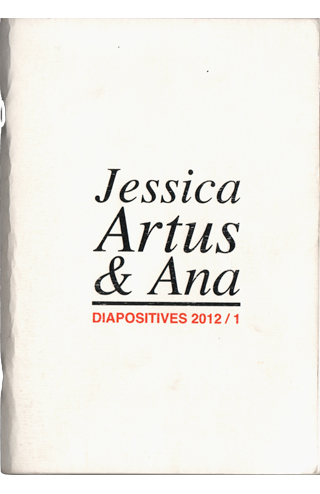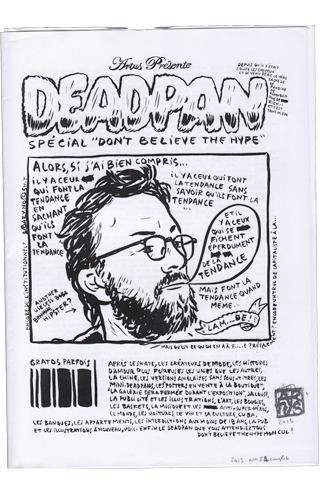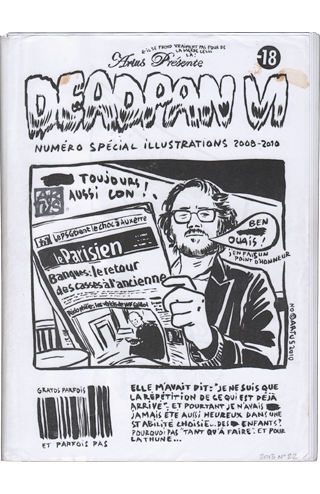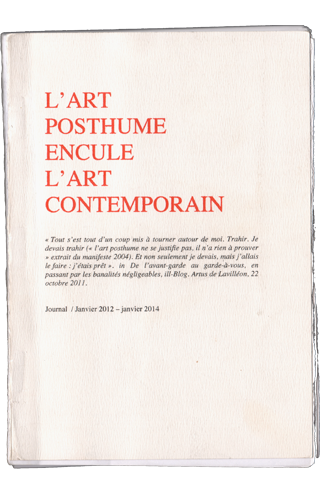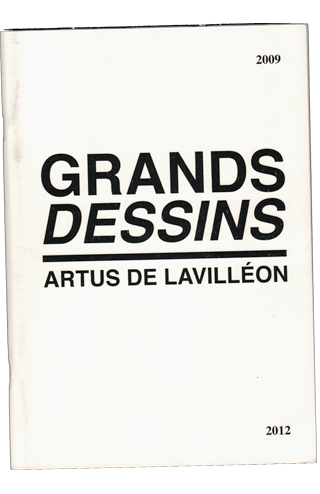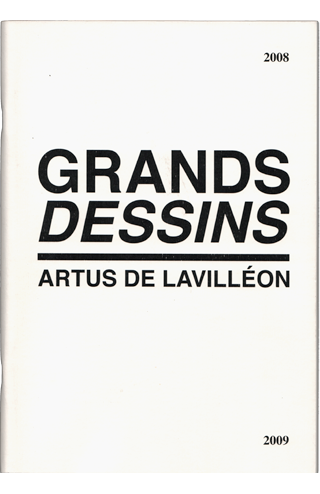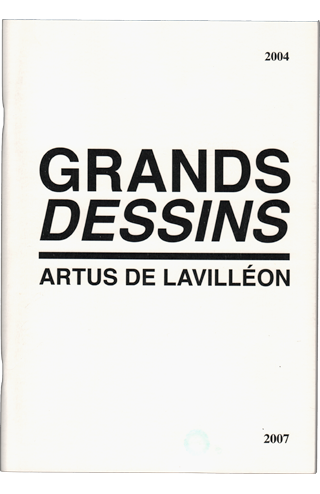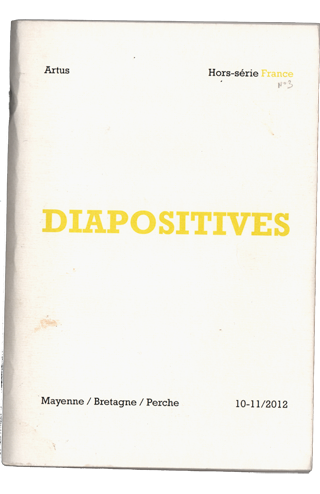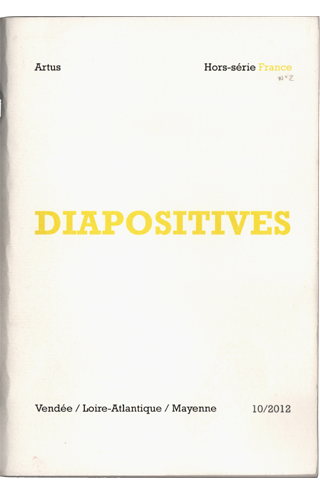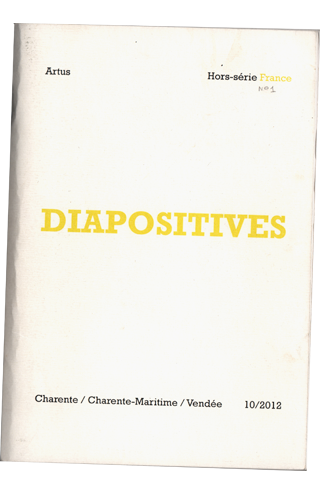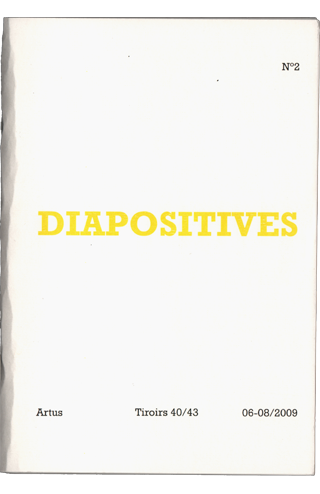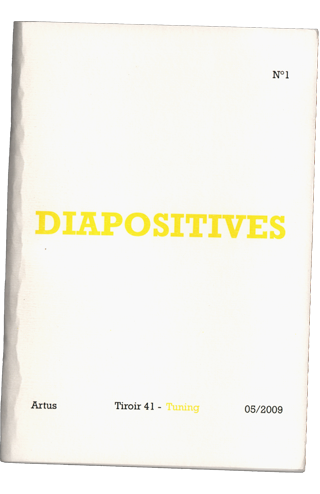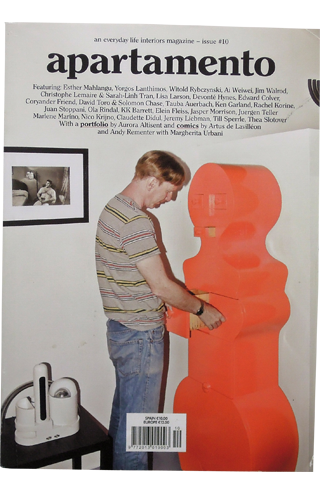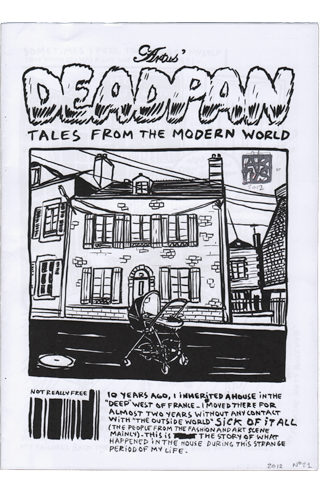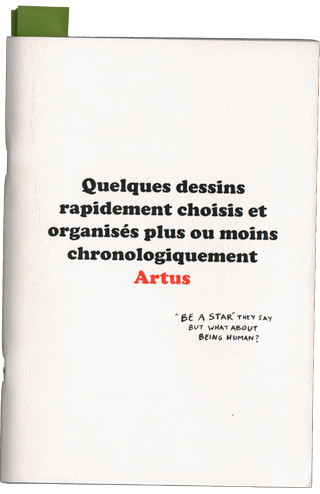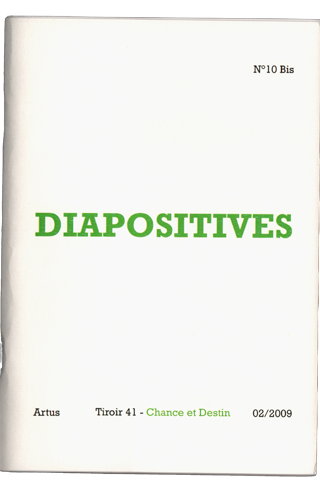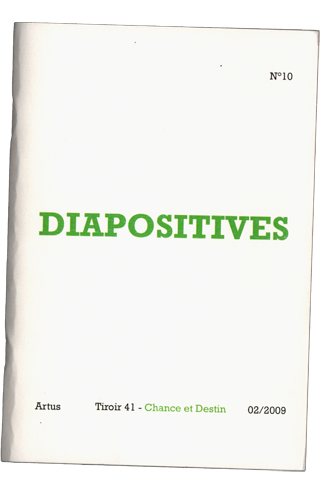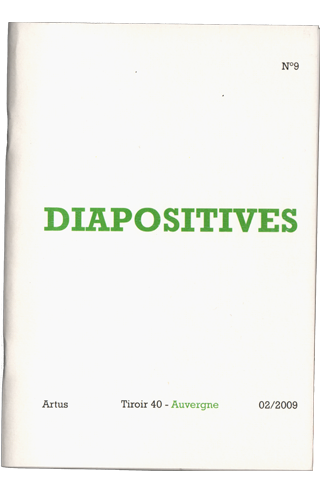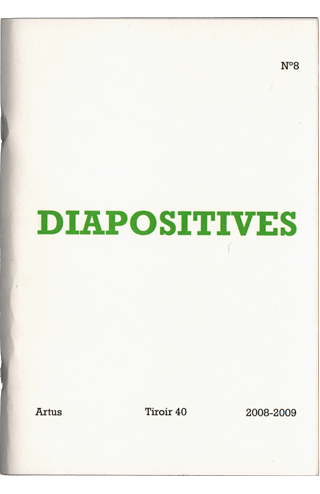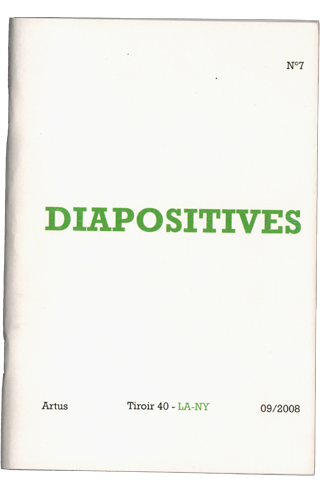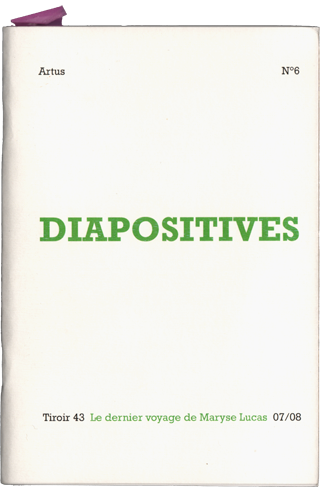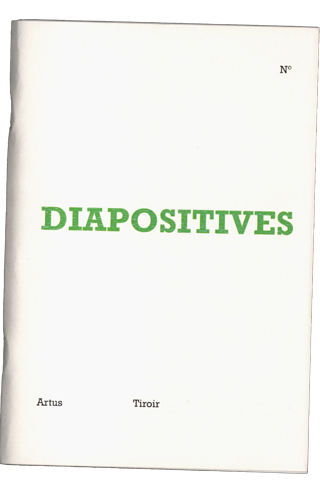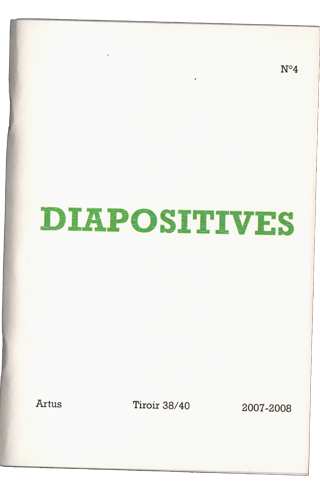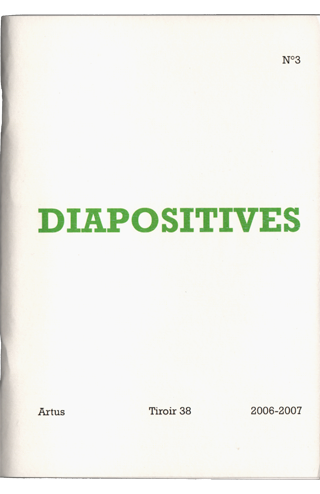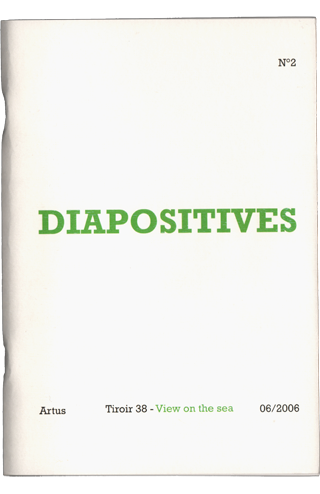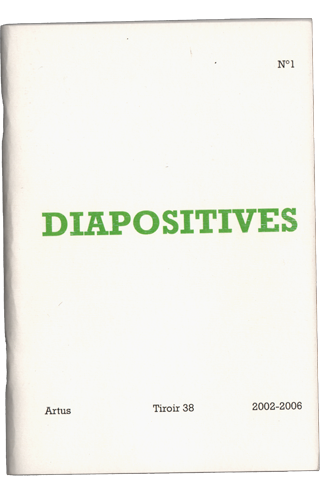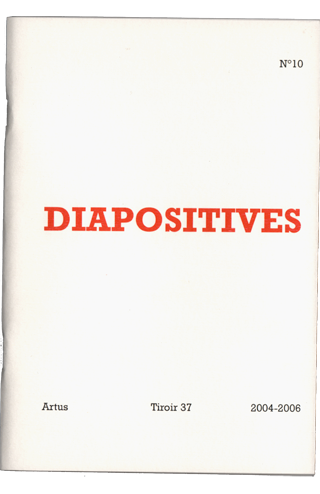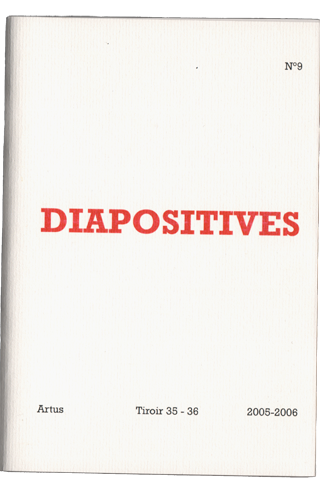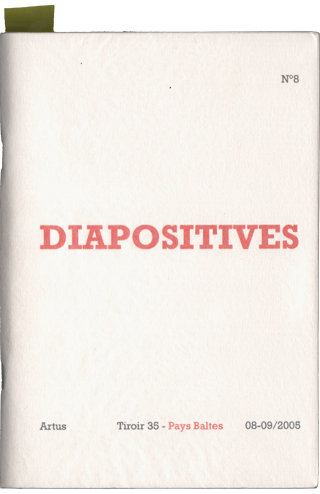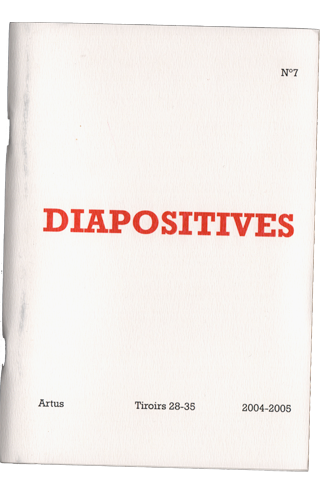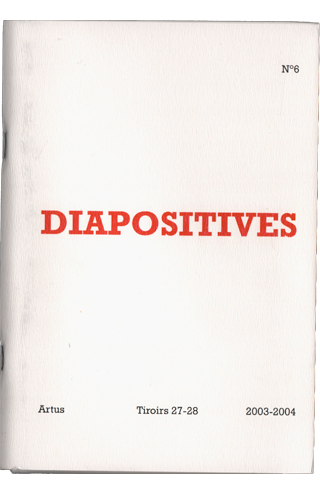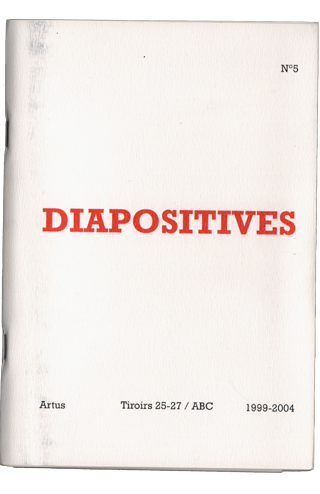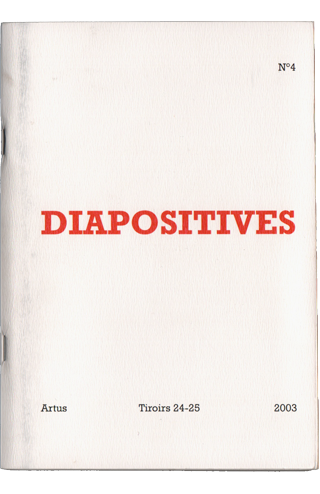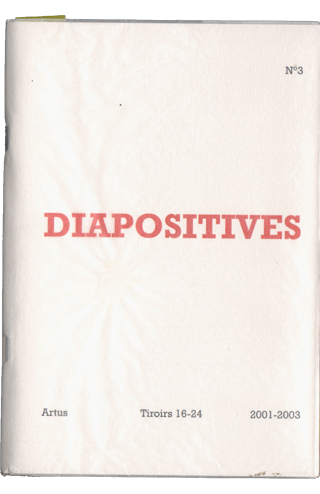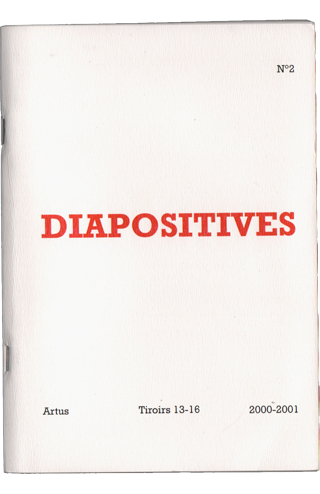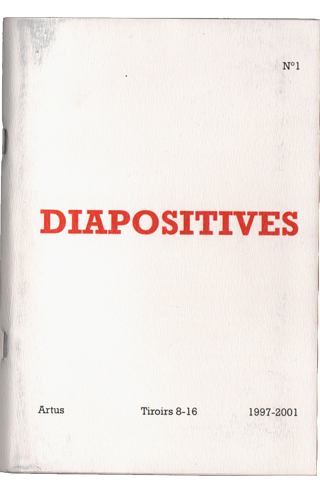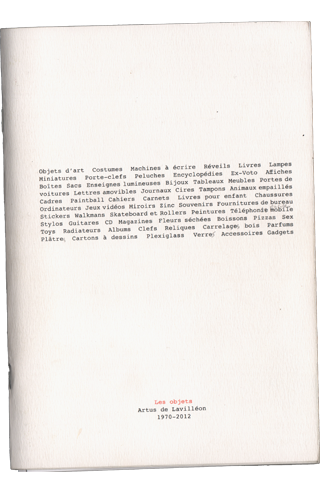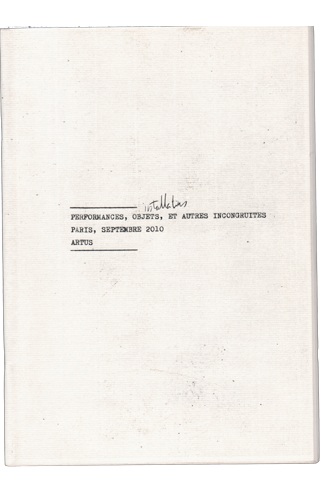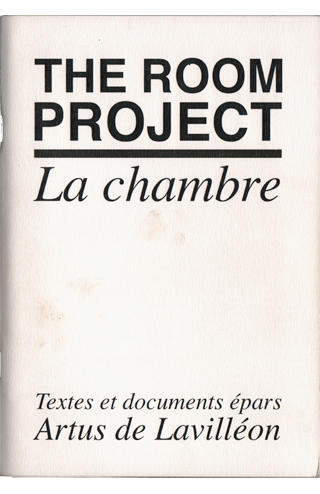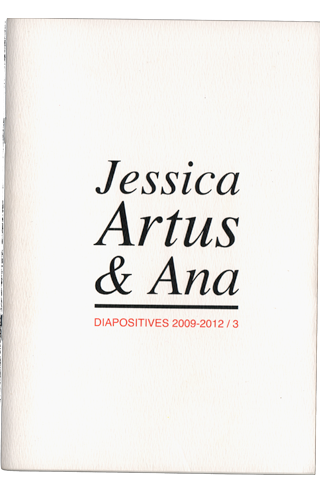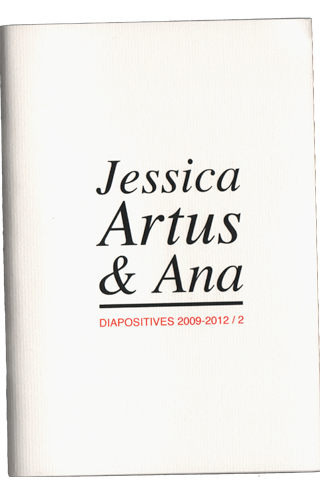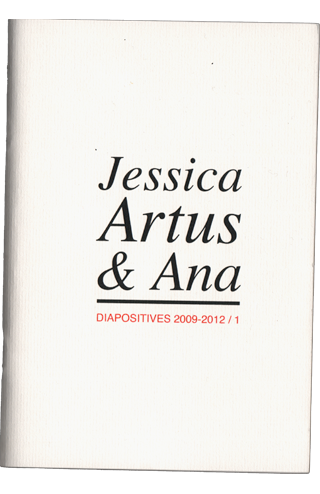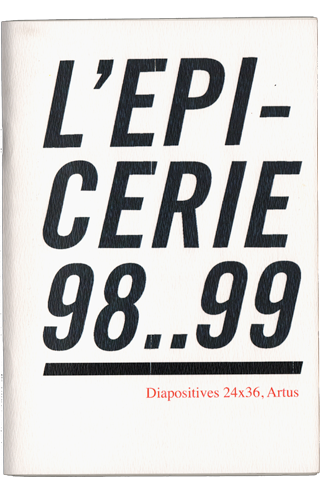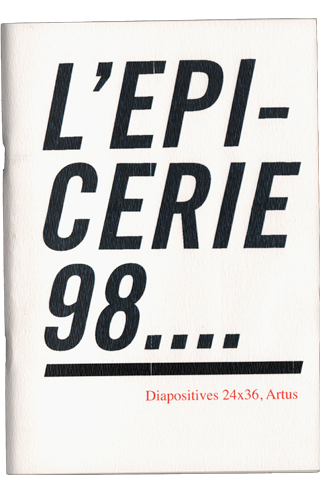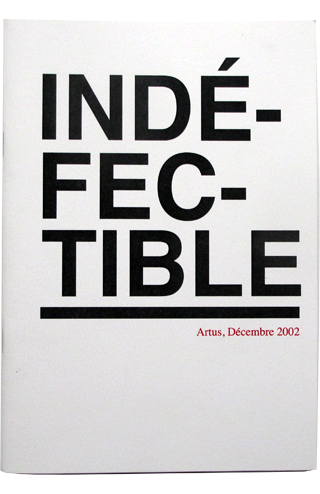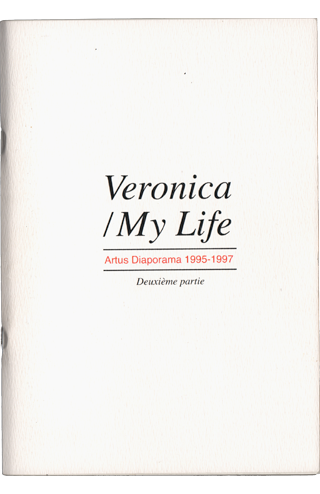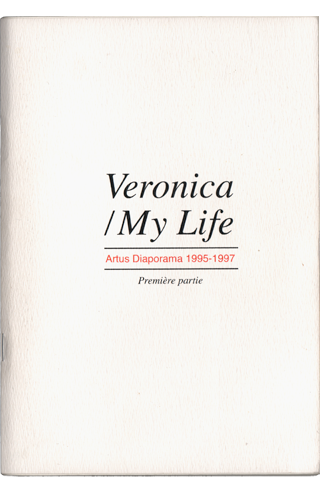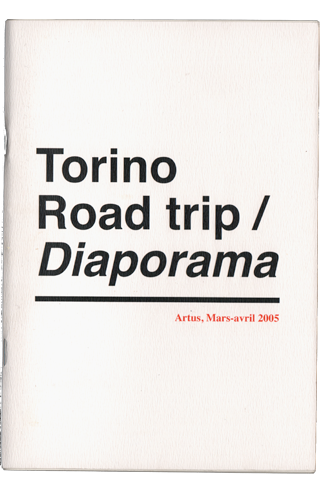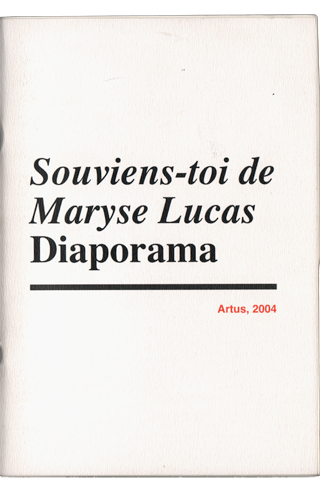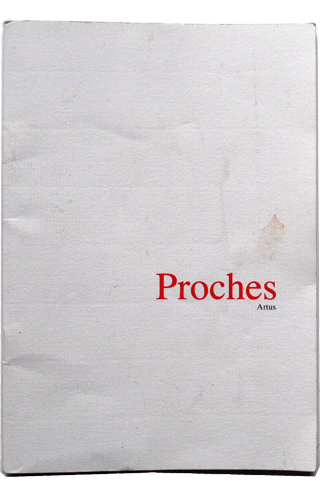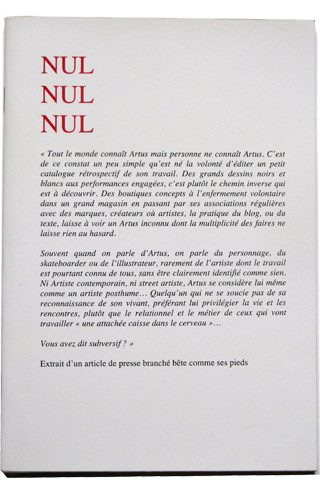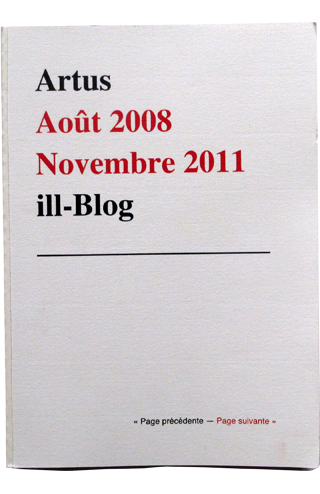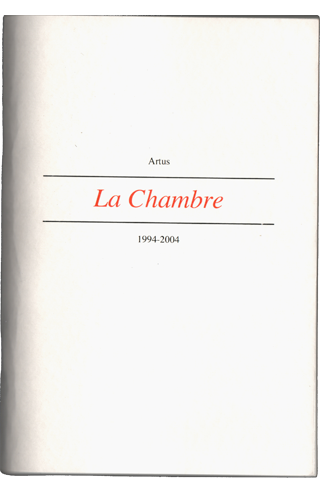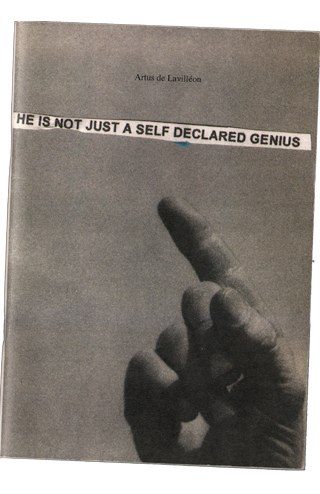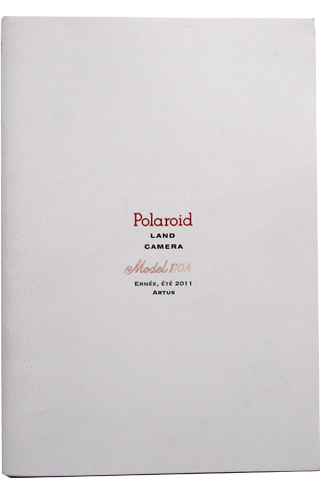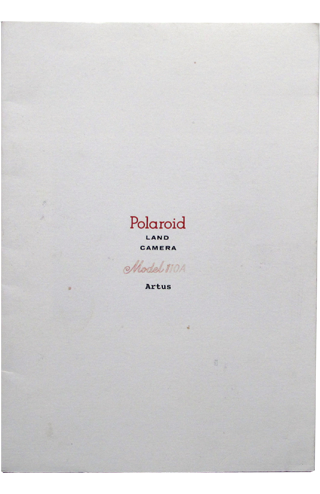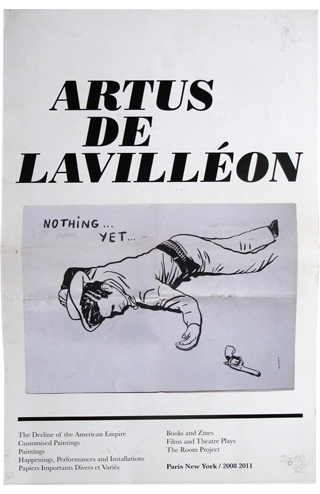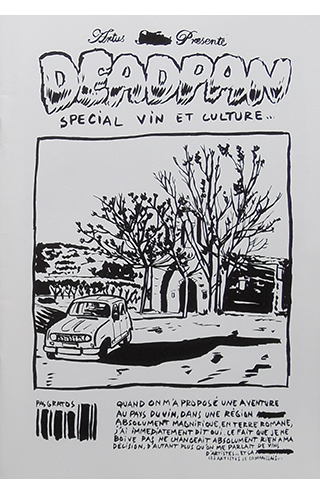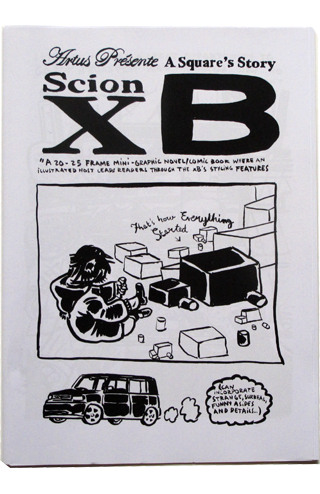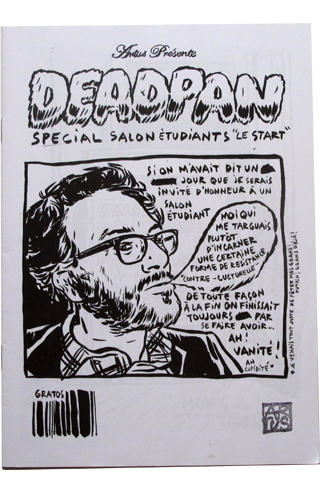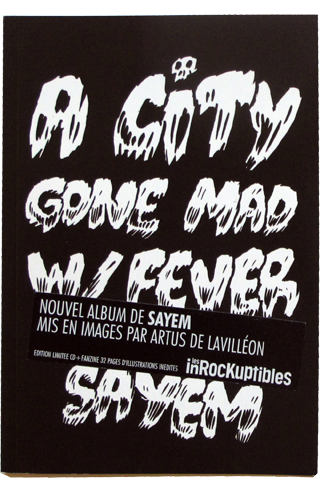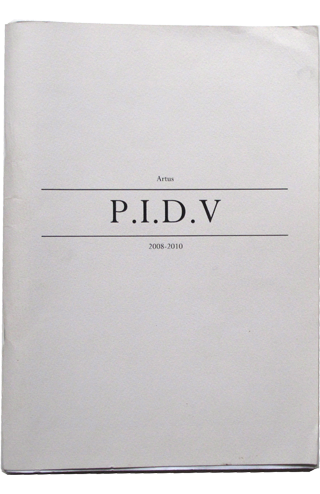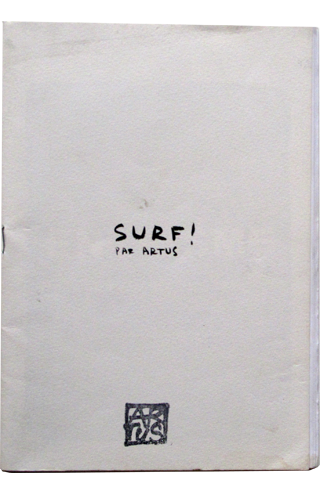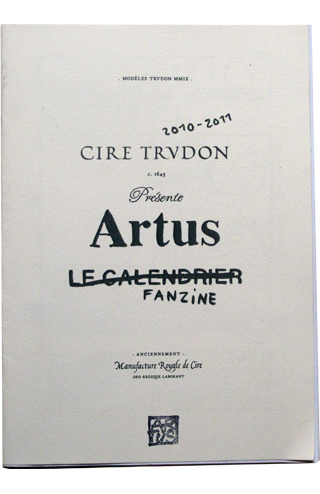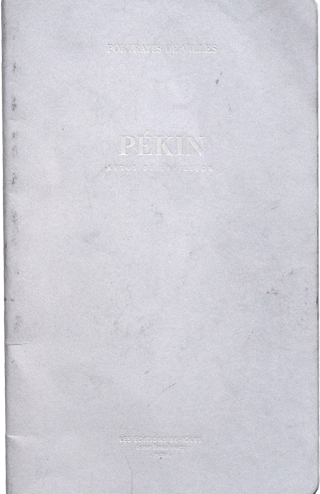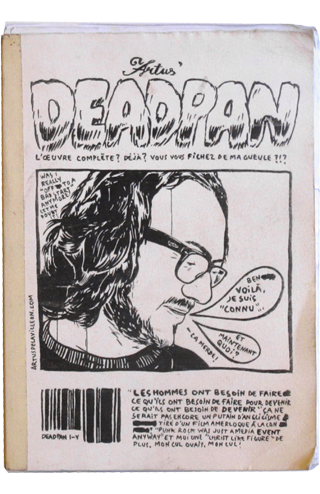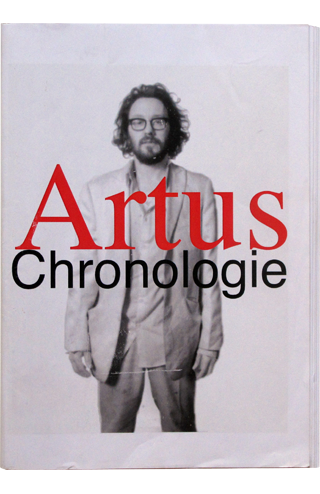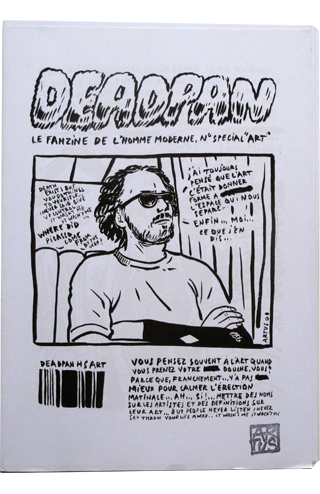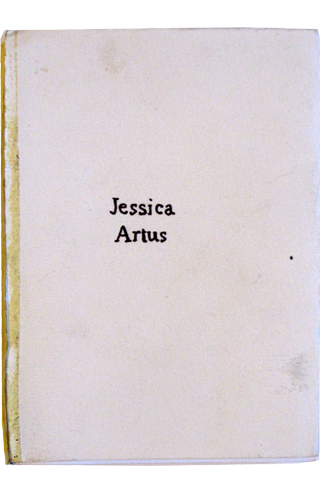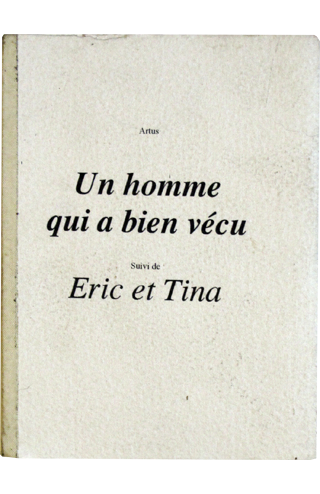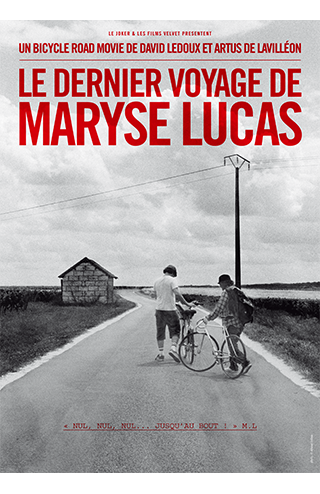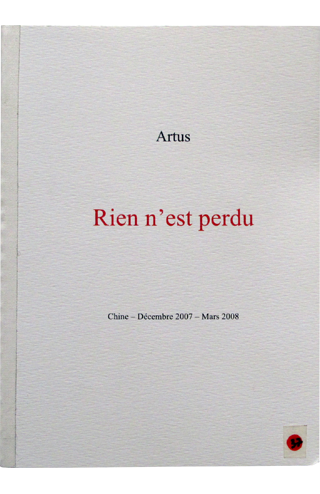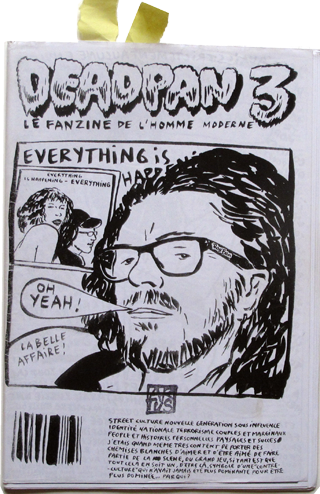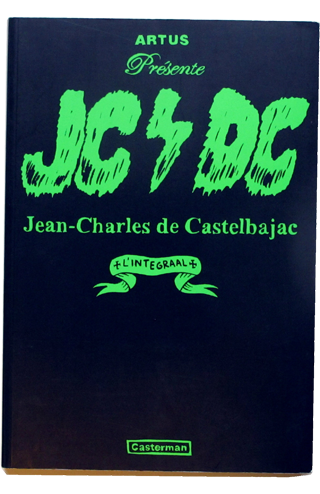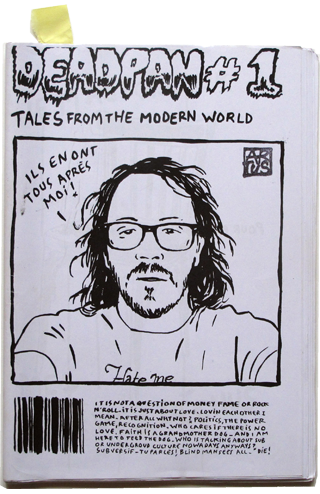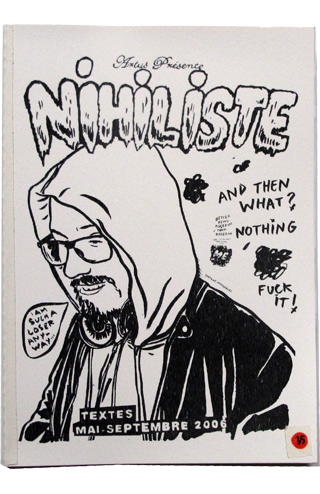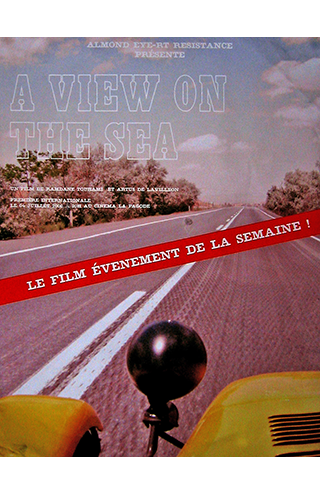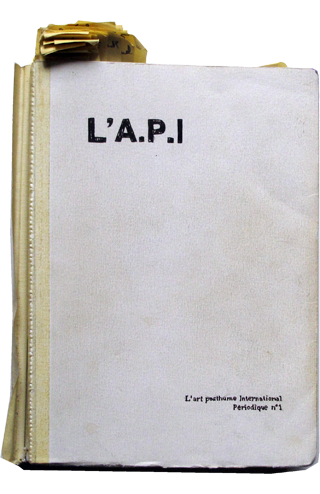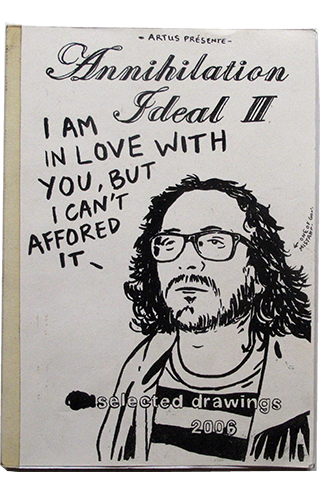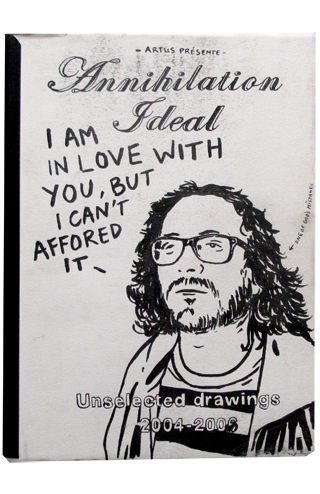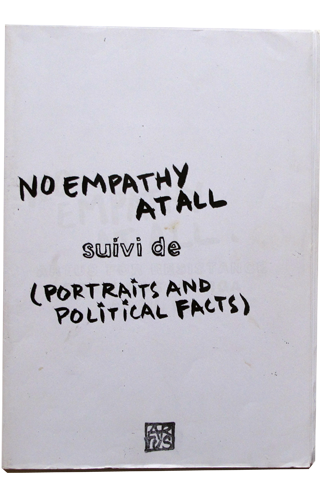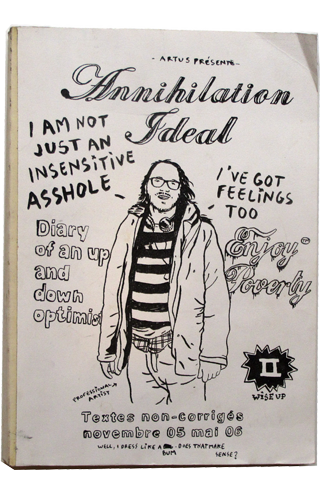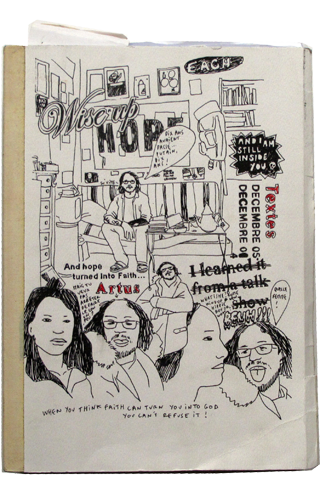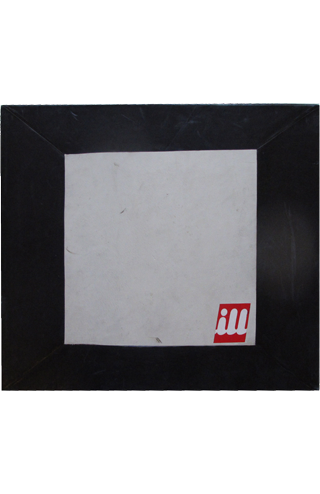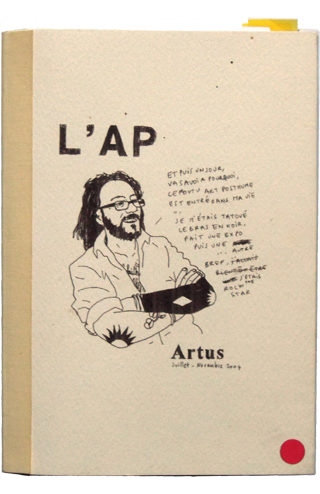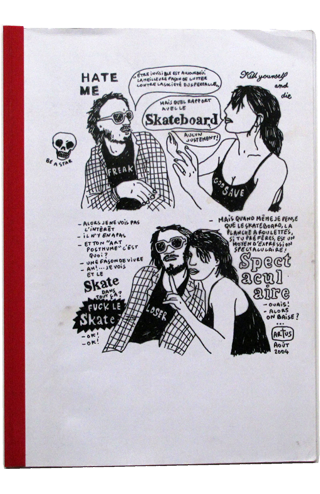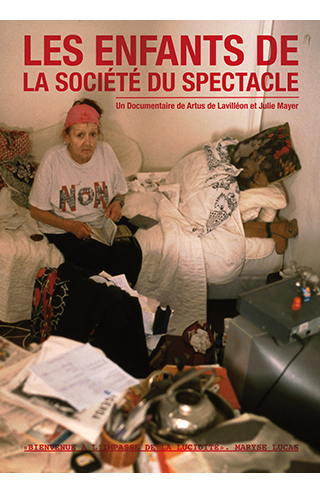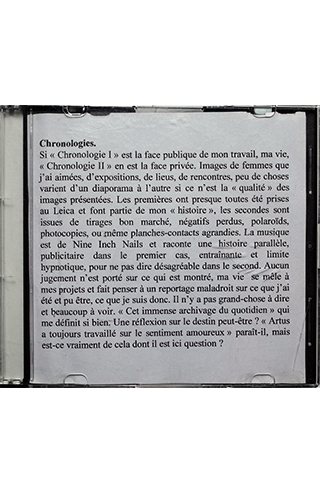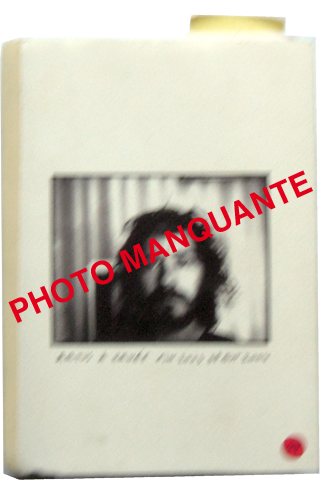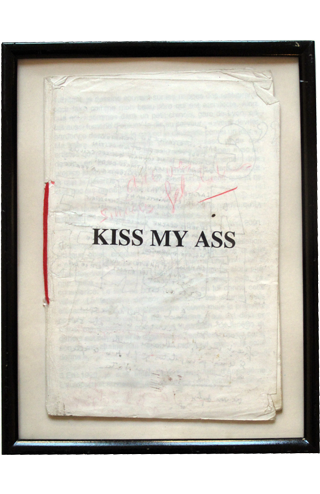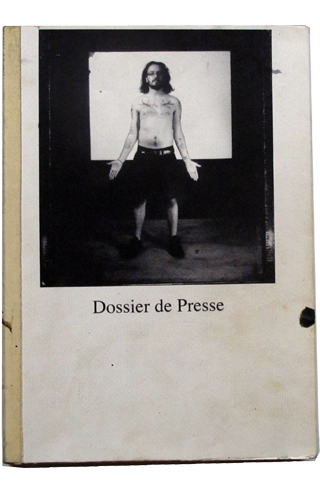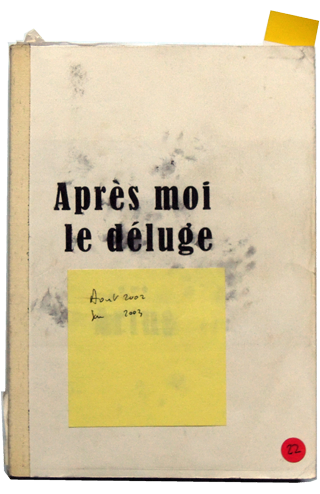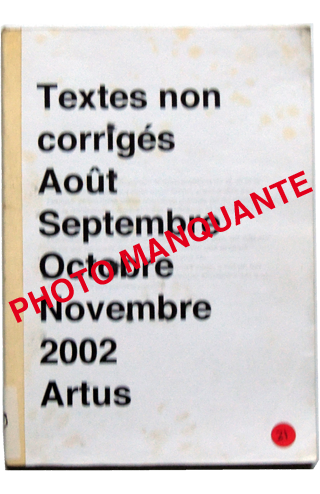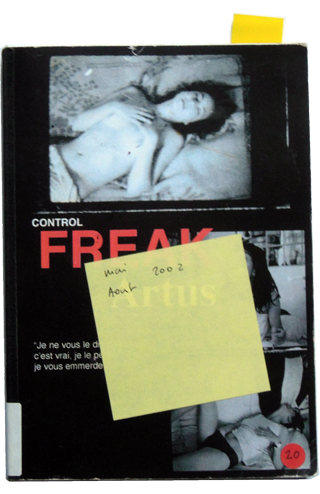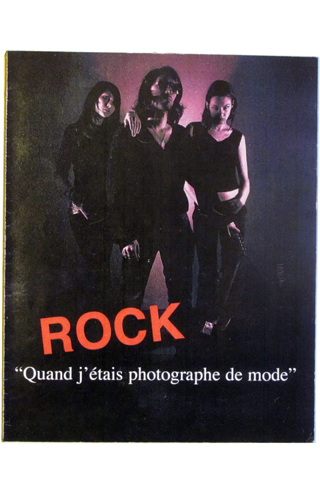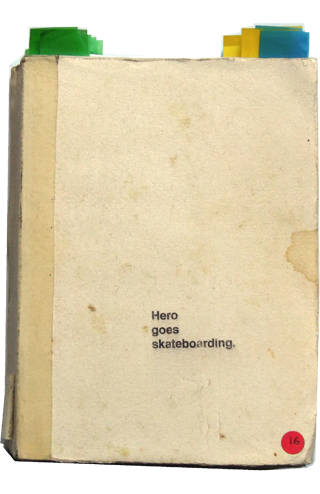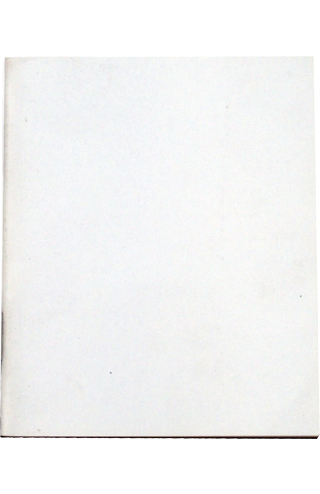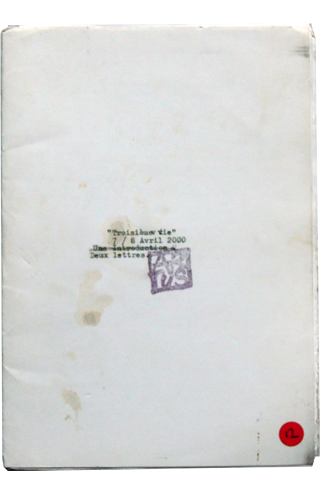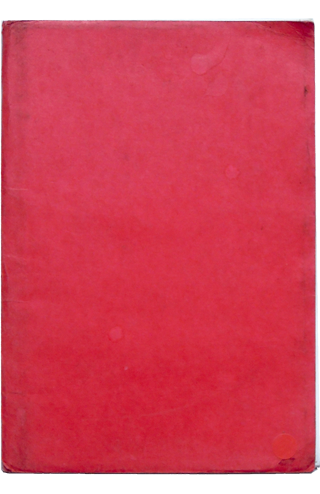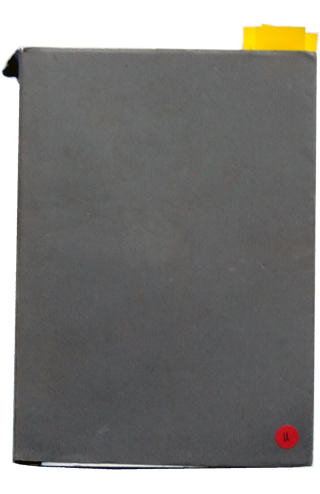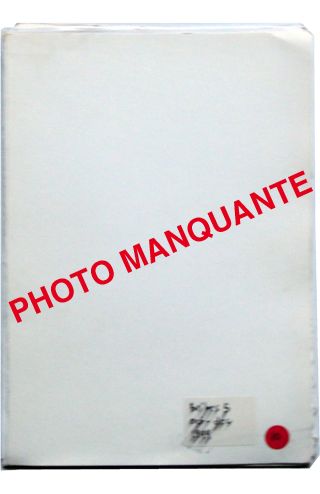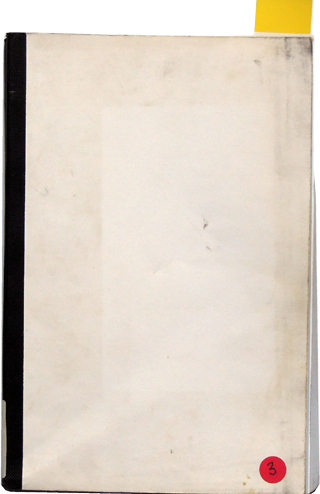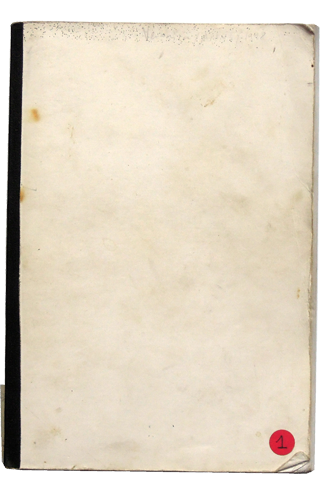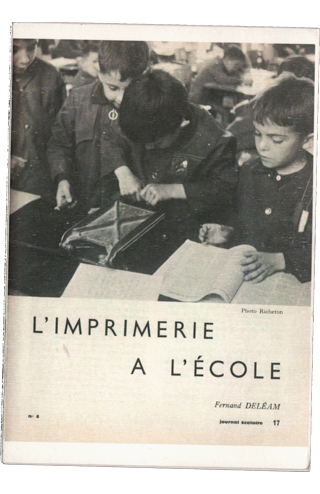Les textes qui suivent, illustrés par une image unique, figurent en introduction des photographies reproduites dans le Best of Quotidien #2
Et tout d’un coup, c’est sa vie que l’on voit s’écouler devant soi. Anti-chronologie inattendue, le projet des Best of dessine un paysage en marge de tout le reste : ce qui a été abandonné, ce qui a continué, ce qui s’est passé et ce qui n’est pas arrivé. Pourquoi cette parution rétroactive ? Pourquoi ne pas avoir commencé par le numéro 1, ou par la réédition de la première compilation de mes photos à la Plaubel ? Mes débuts au moyen format et ma prime volonté de donner à ces photographies le statut d’art ? Parce que j’avais besoin de lire à l’envers ma vie et, peut-être, ne plus commencer comme je le fais habituellement par le début. Les textes de Quotidien 1 à 14 font sans cesse référence aux textes situationnistes, à Malevitch, aux grands photographes dont j’ausculte le travail méticuleusement. L’utilisation du Hasselblad SWC/M quand à lui modifie mon rapport à la réalité. Hyper réalité du présent, volonté subie de changement. Vacances. Vie de Famille. Sortie du marché de l’art et professionnalisation de mon métier d’illustrateur, et Jessica au centre de cette nouvelle vie…

Quotidien #1
Juin – Juillet 2015
À chaque fois que je regarde les photos prises avec le Hasselblad SWC/M je suis fasciné.
En à peine un mois je réalise un nouveau tome de Quotidien pour essayer ce nouveau boîtier pour lequel j’ai un véritable coup de foudre, sans vraiment comprendre comment il marche. Les images me ressemblent sans me ressembler – comme si elles étaient habitées d’une forme d’hyperréalité. Alors que le négatif est plus petit que celui de la Plaubel, il est plus piqué, plus «métallique». Et je n’arrive pas à savoir si ces images me plaisent vraiment.
Je me balade tous les jours avec ce livre brut de scan photographié, maquetté et imprimé à la va-vite, sans réel choix dans la sélection des négatifs et positifs qui le constituent (comme souvent cela dit), constamment dans le sac à côté du Blad.
Tout y est mélangé. Photos de Jessica, d’Anatole, de skateboard, de lieux et lotissement, entre Paris, sa banlieue, et Angoulême, où je continue de tourner le film sur mon ami Batman avec un pote. Surchargé de travail comme souvent depuis que le dessin est devenu mon moyen de subsistance principal… Lutter pour ne pas me laisser enfermer par ce succès que je crois encore potentiellement éphémère.
Et puis les vacances arrivent vite. Il faut tout boucler avant de partir, mais avec quel boîtier ? Les deux Plaubel sont réparées et tout le monde me dit que le tome 1 de Quotidien me correspond mieux. Reste de mystère du fameux 38mm Biogon dont on ne sait parfois s’il est l’équivalent d’un 21, d’un 24, ou même d’un 50 mm en 23 x 36, quand on respecte scrupuleusement le niveau à bulles… l’optique préférée de Friedlander dont les livres Family in the Pictures et Stick and Stones me travaillent (un reste d’influence de Stephen Shore dans la tête).
Shooter en moyen format pour éviter le grain maintenant considéré comme « daté ». Régler son appareil manuellement pour retrouver une lenteur, un cadrage, et une réflexion qui me semble cruellement manquer en numérique… limiter le nombre de clichés aussi. Me confronter à une vision imposée par un objet intermédiaire dont l’angle de champ est si large que son empreinte sur la réalité modifiera forcément ma façon de voir les choses.
La veille du départ je suis encore au labo, puis à la photocopieuse, où j’imprime ce livre.
C’est décidé, je partirais avec le Blad, sans aucune certitude, sauf celle d’être, pour la première fois, étonné par mes propres images, si différentes et en même temps si proches de celles que j’ai toujours faites. Le tâtonnement expérimental prôné par Célestin Freinet dans sa Méthode, avec laquelle j’ai été élevé, s’oppose dans mon esprit à l’industrie du loisir artistique, et s’impose peut-être aussi comme l’embryon d’une réponse apporté à cette société du spectacle où tout semble si maîtrisé qu’on a l’impression d’y perdre tout ce qui fait notre humanité.

Quotidien #2
Juillet 2015
Parti en vacances avec le tome 1 des photos prises au Hasselblad SWC/M (qui ne me quitte plus) je me fais envoyer les scans de mes dernières pellicules par We Transfer, ainsi que mes premières photos de vacances que j’organise toujours sous le titre Quotidien. Le livre est ainsi photographié et édité en moins d’un mois.
Loin du « Best Of » des images faites à la chambre Plaubel Makina – qui étaient issues de cahiers où je collais mes tirages originaux – je suis ici dans une autre logique, proche de mes fanzines de dessins Deadpan où ce n’est pas la qualité de la photo que je cherche (alors que j’utilise l’une des meilleures optiques jamais produites), mais une forme d’accumulation qui témoigne d’un vécu réel.
Comment partager autrement la fascination qu’exerce sur moi les villes où villages pavillonnaires de la petite ou grande banlieue parisienne ou nous allons parfois voir parents ou amis, qu’en la mettant en vis-à-vis de photos de notre couple, ou d’endroits où nous passons nos vacances – ici en Provence dans les Alpilles, dont la beauté ne me paraît ni plus évidente ni plus forte, juste différente.
Je me souviens de l’immense émotion qu’avait généré en moi l’exposition The Place We Live au musée du Jeu de Paume que j’avais vue plusieurs fois. La simplicité des images, le regard critique de Robert Adams sur l’empreinte environnementale de l’homme, mais aussi son affection évidente pour les lieux photographiés. Puis la lecture de ses livres. Ses marches. La beauté des constructions humaines, quelles qu’elles soient, parfois en telle rupture avec ce qui nous entoure et notre vécu intime qu’on se demande souvent ce qui nous a amené là.
Avec la naissance d’Anatole, le temps à commencé à me manquer pour mes projets artistiques et mes propres marches se sont vite résumées à un tour du pâté de maison, ou de la résidence où nous allions passer vacances, quoi qu’il y ait aussi ici quelques photos d’Arles où Jessica s’est débrouillée pour m’emmener (sans notre fils) aux Rencontres de la Photographie que je n’avais jamais visités.
Dois-je avouer que j’ai détesté cette expérience (tout comme je déteste les foires d’art contemporain) alors que mon intérêt pour la photographie n’a jamais été aussi grand ?
Ayant découvert la culture photographique sur le tard, principalement à travers les livres, me retrouver face à Stephen Shore ou à sa rétrospective, ou à l’éditeur Xavier Barral, à qui j’aurais adoré montrer mon travail, m’a vite mis dans la position d’un jeune photographe cherchant à faire partie du milieu, ou à le comprendre.
Ajouter à cela la profusion d’images, de Walker Evans à Gusinde, en passant par d’autres expositions dont la qualité ne m’a pas paru évidente, je n’ai cessé de me questionner, durant ce cours séjour, sur ce qui me poussait à faire toutes ces photos… et sur la succession de choix qui peuvent amener à la création d’une image et à vouloir révéler un regard porté sur la réalité. Car qu’est-ce que la photo sinon cela ?
L’utilisation d’une technique qui modifie notre quotidien par le regard que l’on pose sur lui ?
Le nouvel intérêt maladif que je porte à mon nouvel appareil photo et à son grand angle soi-disant sans déformation reste incompréhensible car je me sens comme un peintre qui serait obsédé par un nouvel outil ou un nouveau format pour témoigner d’une vision en total décalage avec la technique utilisée.
Dans un SMS, que j’ai éprouvé le besoin de m’auto-envoyer, alors que je regardais l’une de ces mises en scène du spectacle artistique contemporain, j’ai noté : « – Ne rien lâcher », en me demandant pourquoi je me sentais toujours aussi mal à l’aise dans un environnement dans lequel je pourrais pourtant m’épanouir.
Et si le fait d’avoir toujours, dans mes projets comme dans ma « posture », quelque chose de raté, de trop ou de pas assez, indiquait une volonté de partager ma réalité dans ce sens ?
De montrer une forme d’humanité en dehors des apparences et des choix qu’implique la décision de vouloir devenir artiste ou photographe.
Avec toute l’acuité générée par un outil qui appuie cette volonté et permet de voir plus large « sans déformation ».
Septembre 2015.

Quotidien #3
Juillet – Août 2015
Henri Miller dirait peut-être que la meilleure façon d’être vrai c’est de mentir, ou plutôt que l’exactitude n’est pas son problème.
« Que peut-il y avoir de plus fictif que l’histoire de sa propre vie ? A force de polir ses souvenirs, on se perd, on devient un autre – soi, peut-être », écrit Béatrice Commengé dans sa biographie.
« Polir » la réalité pour faire passer notre « message » ou choisir de partager son quotidien tel qu’on l’a vécu « en tant réel », est-ce cela qui sépare les photographies de famille de grands photographes (telle que la pratique Lee Friedlander par exemple) de celles que nous collons dans nos albums personnels ? La sélection d’images opposée à la profusion des souvenirs dont elles ne se veulent pas forcément le meilleur témoignage ? L’affect qui sépare souvent la qualité d’un travail à l’empathie qu’il génère. Et le talent celui de réconcilier valeur et émotion.
En faisait de nombreux allers retours au laboratoire, mélangeant les pellicules couleur et noir & blanc, j’ai un peu perdu le fil de la chronologie. Ce fil qui est si important pour moi. Bouger les photos d’une ou deux pages, pour mieux raconter l’histoire, ou coller au plus prêt d’une réalité qui n’est pas celle de la prise de vue (mais de la mise en page) est-ce déjà tricher ?
Pour la première fois, je réalise plusieurs livres à la fois. Je jongle avec plusieurs dos argentiques Hasselblad et séries en même temps. Noir et blanc, couleur, paysages, portraits, photo d’architecture, d’intérieurs… avec la même exigence de spontanéité, sans jamais rien retoucher ou déplacer, à de rares exceptions prêt.
Léautaud, que je découvre dans la bibliothèque de mon père et de ma belle-mère (tous deux décédés), note dans son Journal Littéraire : « ce n’est pas la réalité qui m’intéresse mais ma réalité ». La seule objective finalement.
Les photos de vacances, dans leur banalité même, nous rapprochent d’un quotidien vécu au jour le jour que seule la photographie sort de son contexte, Mon fils, ma femme, quelques proches, la famille… Et puis régulièrement je fais le tour du pâté de maison du lotissement ou de la maison où nous restons quelques heures ou quelques jours.
Un ami me demande : « Pourquoi dépenses-tu autant d’argent sur tes photos alors que cela ne te rapporte rien? », et je lui lit une phrase de Baudelaire qui explique que confondre art et photographie est une erreur. Mais n’est-ce pas exactement ce que je fais ? « Pourquoi n’essaye tu pas de faire une sélection plus pointue », ajoute Jessica. « Tu devrais faire quelque chose de toutes ces images Artus » insiste une amie.
« Aujourd’hui on n’a plus le temps de prendre le temps » (Dans un livre sur Le moment robotique).
Comment expliquer sans avoir l’air prétentieux que j’essaye de mettre en place une œuvre qui se lise dans sa globalité plus que dans son détail. Comme un peintre pourrait peindre une série de toile pour rendre compréhensible une démarche qui sans cela resterait floue.
Pourtant mes photos n’ont rien de picturales, ni de réellement poétiques… Sont-elles d’ailleurs des photographies de famille ? Si je devais les définir je dirais que mes photos sont factuelles, évitant tout débat avec mes détracteurs. Elles sont issues d’un besoin constant de partager mon quotidien – mais pas seulement. Et c’est sans doute là que cela devient « compliqué ».
« Nous avons été ici ». « Nous avons fait ça ». « Nous avons vu et rencontré telle et telle personne ». « Photographié ci et ça »… Comme tout le monde, nous sommes partis en vacances, nous sommes revenus et repartis, et revenus à nouveau, années après années, parfois au même endroit, parfois pas, parfois avec les mêmes personnes, parfois avec de nouveaux amis, mais c’est la même réalité dans sa répétition et sa familiarité qui nous a entouré. .. à part que chaque réalité est unique, même dans sa plus grande banalité.
Jessica, à qui je lis ce texte ajoute : « En fait, ce que tu essaye de dire de façon assez compliquée, c’est que les gens sont toujours impressionnés par ce qui est semble inaccessible – comme la célébrité ou ce qui est montré dans les musées – en oubliant d’être émerveillés par leur quotidien ».
Je crois que deux minutes avant je lui parlais de ma lassitude des musées et des galeries, dans lesquelles je vais de plus en plus rarement. Sauf que, au milieu des vacances à Juan-les-Pins, j’ai quand-même éprouvé le besoin d’aller, seul, voir une exposition : « De Chagall à Malévitch, la révolution des avant-gardes en Russie entre 1904 et 1930 », au Grimaldi Forum, à Monaco.
Entre les Constructions de Rodchenko et Le monument à la troisième internationale de Tatline, j’ai repensé à l’émotion qu’avait généré en moi le Carré blanc sur fond blanc de Malévitch dont la seule idée avait changé ma vie. Jean-Louis Prat écrit à propos de cette exposition qu’il « parle de la liberté des artistes à exprimer leur vérité, leur temps et ainsi à imposer leurs idées ».
Je pense pour ma part qu’un grand artiste n’est pas forcément un grand révolutionnaire, ou en tout cas que c’est idée se perd dans la contemporanéité actuelle, mais celui qui sait s’approprier une évidence.
Et que ces évidences ont effectivement le pouvoir de changer le monde.

Quotidien #4
Juillet – Août 2015
Les photographies de vacances s’accumulent comme autant de preuves d’un quotidien d’une banalité exemplaire. Piscine, amis, parents, dans des paysages quelconques qui, dans ce contexte, malgré leur beauté, n’évoquent pas grand-chose.
La route défile nous amenant d’un point à un autre en traversant la Provence, le Lubéron, puis le Lot, avec un court arrêt à Nîmes pour couper le voyage en deux.
Jessica me dit : « Peut-être que ta force c’est la quantité après tout ».
Succession de moments partagés, soi-disant en marge de toute pratique artistique, alors que, peut-être, je n’ai jamais été aussi proche de ce que j’ai toujours voulu dire.
Pourtant je photographie peu. Presque toujours frontalement, sans vraiment réfléchir.
En re-regardant ces images, je trouve tout plus ou moins plat. Sauf les scènes de voiture, les plus intimes, celles où nous parlons de tout et de rien sans rien creuser en profondeur.
Anatole joue avec les enfants d’Aleksi et nous dînons avec ses parents juste à côté de la piscine.
Jessica allongée sur le lit regarde son téléphone portable tandis que j’installe mon mon pied photo.
Je lis dans les toilettes pour ne pas déranger ma petite famille.
Mais c’est vrai, pourquoi mets-je autant d’énergie dans ce projet ?
Plus les livres s’accumulent plus j’y vois une forme de résistance au « spectaculaire ».
Les bonheurs sont simples.
À travers la vitre à moitié sale je photographie les champs sans cadrer, à la vitesse de notre voyage.
Anatole fronce les sourcils pour comprendre un dessin animé.
Un camionneur regarde dans la direction d’une ligne haute tension.
Et puis les rires sur une aire d’autoroute.
Dans un livre sur le situationnisme je lis :
« Ils voulaient faire savoir à la postérité qu’ils avaient conscience de produire leur propre histoire ».
« Pour la première fois, la volonté de vivre se substituait à la volonté de puissance ».

Quotidien #5
Juillet – Août 2015
Dans la photo, il y a quelque chose de l’ordre de ce que j’ai toujours cherché en peinture.
Remettre l’œuvre dans son contexte, privilégier la vie du vivant de l’artiste, montrer sa prédominance (plus que son influence) sur sa pratique.
Il y a dans la photographie une « simplicité », qui permet une proximité plus « évidente ».
Trouver un chemin dans des images, c’est un peu comme trouver le sens d’une œuvre et par conséquent avouer chercher celui de la vie.
Pourquoi tel ou tel « sujet » s’impose-t-il à nous ? Quel est l’impact du quotidien, des rencontres, des endroits dans lesquels on va, de ce que l’on voit, sur le destin d’un homme, d’une œuvre. Comment partager ce questionnement de la façon la plus simple possible ? Pourquoi parle-t-on de moins en moins de destin ou de vies quand on parle d’une œuvre ? De l’homme qui se trouve derrière elle ? Quel est notre rôle dans la société ?
Témoigner, agir, créer. Se reculer d’un pas. Assister aux choses est-ce ne pas les vivre ?
De retour de vacances je dois attendre mes négatifs pendant plusieurs semaines, et je erre, sans vraiment savoir quoi faire, à la recherche d’un nouveau projet. Le film que je co-réalise sur mon ami Sylvain dit « Batman » est en stand by et les commandes commerciales de dessin sont rares.
Avec la vente de ma maison d’Ernée, je perds une forme de stabilité. Savoir que mes archives, peintures, documents, vont finir dans une cave, inaccessibles pour quelques années, me retourne littéralement le cerveau. Ce n’est pas qu’un accès que je perds, mais aussi une projection dans le futur et une ouverture sur le passé. Qu’est-ce qu’un artiste sans œuvre ?
Une fois les photos reçues, je réalise la masse de travail qui m’attend. Sélectionner (même à minima), organiser, classer, mettre en page, va me prendre un temps monstrueux, tandis que le projet de la chambre, que je poursuis seul, ne me permet pas de digérer toutes ces images qui sont aussi un vécu.
Me détacher des images pour mieux les voir. Comprendre leur potentiel et leur histoire propre.
Le décalage entre mes prétentions d’artiste et mon travail de photographe, ne me paraît pas incontournable, il a «l’admirable capacité de fixer les processus de la pensée vivante », comme dirait Malévitch à propos de ces textes en marge de son travail de peintre, que je relis avec avidité.
« Le temps des gifles est passé », ajoute-t-il, alors qu’il enjoint à être encore plus radical dans un texte de 1913 (Tiré du Premier congrès Pan-Russe des bardistes de l’avenir – Poètes futuristes), juste avant la réalisation du Carré.
« Il fallait une force énorme de volonté pour détruire toutes les règles et arracher la peau devenue grossière de l’âme de l’académisme et cracher au visage du bon sens »
K. Malévitch, Du cubisme au suprématisme, le nouveau réalisme pictural, 1915
« L’œuvre artistique suprême est écrite quand l’intellect est absent »
K. Malévitch, Les vices secrets des académiciens, 1916
« Mais nous forgerons notre visage dans notre temps et nos formes, nous formerons le temps, mettrons le sceau de notre visage et le laisserons dans le torrent des siècles, où il sera reconnu »
K. Malévitch, Pour une nouvelle face, 1918

Quotidien #6
Septembre – Octobre 2015
Le problème, c’est que j’arrive à un moment où je ne peux plus faire demi-tour.
Depuis que j’ai réalisé qu’exposer en galerie ne m’intéressait plus, aussi bonne la galerie soit-elle, et que je me suis progressivement retiré du marché, une sorte de lassitude m’a envahi. Mais c’est un cul-de-sac.
Je relis Malevitch, cherchant dans des textes qui sont à l’origine de ma vocation d’artiste une réponse à mon mal être présent, qui a tout à voir avec le « marché de l’art » et rien avec ma vie de famille qui est florissante et joyeuse. Je déteste devoir me justifier.
Alors j’archive compulsivement ma vie sous forme de livres et de photographies, croyant affirmer une forme de résistance par l’intime.
Quand il s’agirait de faire connaître ma position, et de la diffuser, je me noie dans un travail que je garde devers moi, ne diffusant plus rien et tenant une position en marge des réseaux sociaux soi-disant devenus incontournables, et pourtant responsables non pas de la croissance des possibles, mais de l’augmentation d’un mercantilisme policé appliqué à tous les domaines de la vie.
Ce qui ne demande aucun effort est aussi vite oublié que consommé. L’industrie du culturel, du loisir, du spectacle, de la technique, ou quelque soit le nom que l’on choisisse de lui donner, ne permet plus d’être respecté pour des positions souvent jugées obsolètes par une nouvelle génération qui ne cherche plus des nouvelles manière de contourner un système incontestable et tout puissant, mais plutôt des façons de « faire avec ».
Je cherche une issue qui ne soit pas qu’une nouvelle soumission déguisée.
Travailler seul est difficile car le besoin de partager qui m’habite est, lui, toujours aussi présent.
Comment montrer une œuvre sans passer par la phase de production qui attesterait de sa côte et la prouverait aux yeux de tous.
Comment dire que je ne crois plus au combat de l’intérieur ?
Sur France Inter, ou Culture – je ne sais plus – différents commissaires d’exposition parlent de la valeur du refus, de l’importance d’artistes qui se retirent du système, sans proposer aucune autre solution que celle, dans ce même système, de montrer leur retrait, de le monnayer, de lui donner une valeur muséale qui la justifie aux yeux de tous, faute d’avoir été comprise sans ce filtre.
Combien d’artistes travaillent aujourd’hui en marge de tout système et « produisent » « dans leur grenier », une forme d’art qu’ils ne savent pas – ou n’ont pas – envie de vendre, se méfiant des blogs et autres sites internet dont l’utilité, si elle ne leur semble pas contestable, leur apparaît comme ennemie d’une rareté qu’il défendent à la hauteur de leur investissement dans la construction d’une œuvre réelle, non d’une image.
C’est certainement dans la confusion entre les termes de vente et de partage, d’image et de réalité, que se niche le plus grand préjudice porté aux artistes aujourd’hui.
« Un bon artiste est un artiste qui vend, non un artiste qui travaille lentement et surement à établir une pratique dans le temps », dit-on. Alors que c’est justement ce décalage dans le temps qui est la seule manière de juger un artiste, et pas de décréter la viabilité de son œuvre à l’aune de son image sociale et financière, telle qu’elle est relayée dans les medias – réseaux sociaux compris, qui ne jurent que par l’immédiateté.
Cette « immédiateté » illusoire, aveugle sourde et amnésique, qui s’étend maintenant à l’infini, fait du temps présent un laboratoire en constante mutation, ignorant de son passé comme de son futur, aussi sûr du bon droit de ses laborantins (producteurs/diffuseurs) que nous sommes certains d’avoir abdiqué pour le meilleur notre pouvoir décisionnaire à la masse toute puissante. Celle qui ne se trompe jamais…
(…)
Alors que je me noie dans ces débats, je découvre la biographie de Walker Evans, où est décrite « la première exposition dédiée à un photographe jamais organisée par le Museum of modern art » de New York en 1938, où, contre la volonté du directeur il recadre, découpe, et séquence son travail afin d’imposer un sens de lecture et une « narration» à ses images, la veille du vernissage (sans se soucier de créer une séquence différente de celle du livre).
Ce geste, me fait réaliser à quel point le photographe est à la fois proche de l’artiste et de l’écrivain.
Comme l’artiste, il poursuit un but qui le dépasse souvent et suit une logique qui, même dans ses commandes commerciales, telles qu’elles seront plus tard réintégrées dans son œuvre, laisse transparaître son identité.
Comme l’écrivain, son œuvre se limite souvent à deux ou trois livres qui témoignent d’un regard sur le monde, d’une pensée, et d’une vision dans laquelle on se reconnaît parfois.
Comme l’artiste et l’écrivain l’exposition (médiatique ou muséale), ne résume jamais son regard.
Ce regard, qui peut glisser à la surface des choses ou être engagé, documentaire ou topographique, « objectif » ou subjectif, abstrait ou concret, factuel ou conceptuel, voir informel, ne change rien à la force d’identification que porte en soi tout travail abouti, quel que soit le filtre (magazine, expositions, médias divers et variés) qui nous a amené à lui.
Comme le peintre, et comme tout créateur, le photographe est à la recherche de quelque chose qui est à la fois en lui et hors lui, et auquel il doit donner forme.
- Mais le photographe doit faire avec la réalité telle qu’il la perçoit et la retransmet, ce qui ne veut pas forcément dire telle qu’elle est.
Comment entrer dans une photographie – et à plus forte raison dans une œuvre, en ignorant cela, à un moment de l’histoire où l’on cherche plus à gommer les différences qu’à les exacerber ?
Et surtout, qu’est-ce qui fait que certains photographes sont définitivement des artistes avec une écriture qui dépasse de loin tous ces débats, quand ne reste que cette « image » d’une réalité qui n’est pas simplement la leur et auquel il est impossible de les réduire, dans le temps présent, comme dans les temps futurs.

Quotidien #7
Octobre – Décembre 2015
Quelques jours après les attentats du 13 novembre, je reçois un texto d’un ami : « En fait, plus il y a d’attentats, plus tu te fais de pognon… ». Mes dessins sont publiés dans M le magazine du Monde, Les Inrocks (dont je fais la une), Elle… et je suis contacté par différents magazines étrangers pour illustrer ce qui se passe en France (finalement sans parutions à la clef). Malgré la tentation de prendre mon appareil photo pour faire le tour des lieux ou subsistent encore des traces de la violence terroriste, je me cantonne au média (le dessin) qui « me rapporte le plus », celui aussi ou je peux exprimer, par des courts textes, ce que je pense des évènements.
Bizarrement, j’éprouve peu d’empathie pour la France en tant que Nation, car je suis trop au courant (pour l’avoir traversée) de ce que peu représenter la destruction d’une partie de la Syrie, ou de la réalité de ce que l’on nomme les frappes chirurgicales sur des terroristes et leurs familles dans les pays « où ils se cachent ». Je sens déjà venir la dérive sécuritaire, et ne peux que hocher la tête quand un autre ami me forwarde la vidéo d’Alain Badiou « à partir des meurtres de masse du 13 novembre », diffusée sur Youtube, où il parle notamment de la création de zones de non-droit hautement profitables pour l’occident, et dont le terrorisme ne peut-être que la conséquence logique.
Bien que je trouve la vidéo très inégale, et proche du lieu commun par certains côtés, elle a le mérite de « mettre les pieds dans le plat ».
Les tensions après la vente de ma maison de campagne d’Ernée avec Jessica (que faire de toutes mes archives), sont à leur apogée, je dors peu ou mal, et suis très tendu. Mon dos se bloque régulièrement – ce que la pratique du dessin n’arrange pas, et mon projet de film sur le skate est plus ou moins en pause. C’est une période difficile à tous les points de vue. Mon ami Michel Vedette m’invite pour la première fois à l’un de ses shows (très impressionnant), et nous allons rendre visite à des amis en banlieue (Fontainebleau, L’Étang-la-ville) où je photographie ces maisons dans lesquelles je sais que je ne pourrais jamais vivre, fasciné par la tristesse de ces portes fermées, haies, et autres bâtisses préfabriquées (ou pas) que la présence proche de la forêt ne rend pas plus sympathiques à mes yeux. Qu’allons nous faire de l’argent de la vente d’Ernée, acheter un 50m2 à Paris, un 80 dans le Grand Paris, une petite maison en Ile de France, une grande en province ? Et toujours cette question de mes archives, mes peintures, le déménagement à organiser, juste au moment où je me sentais prêt à me lancer à corps perdu dans le projet de La Chambre (qu’il faut lui aussi stocker).
Jessica, qui est en train de monter sa boîte de production avec une amie, rompt tout dialogue avec moi, et c’est, peut-être pour la première fois de ma vie, qu’un horizon me paraît aussi bouché – mis à part le dessin que je commence à regarder d’un autre œil avec une petite évolution de « mon style », qui est de plus en plus détaillé, et me permet de continuer de témoigner de mon quotidien par magazine interposé. Particulièrement pour un mensuel japonais qui m’offre un chronique sur Paris, ou je raconte un peu ce que je veux. Du marché des Enfants Rouges à Château Rouge, en passant par la crise du logement que j’illustre avec un dessin de mon atelier d’artiste de 15m2, « où j’ai passé presque toute ma vie ».
Ici j’entends très bien Jessica me dire : «Toujours la même rengaine ».
De plus Anatole et Jessica ont des problèmes de santé alarmants qui nécessitent scanners et opérations potentielles (tout s’arrangera début 2016).
Les photos que je fais de Villerupt, dans l’est de la France, où habitent les grands-parents de Jessica sont tristes à souhait, la pluie, la pauvreté, les maisons à vendre, et Anatole, toujours souriant qui grandit au milieu de tout ça.
Le retour sur l’Île Saint Louis, où nous vivons, nous fait bien relativiser et comprendre à quel point nous vivons dans un petit paradis. La visites des amis, Natasha, Julien ; Titus et sa femme, le premier film auquel a participé Jessica au cinéma ; et le week-end à Trouville chez Vanessa avec Marie, permettent de prendre un peu de recul sur une situation pleine d’évolutions possibles.
Et puis il y a les attentats du 13 novembre. Juste au moment où les premiers tirs retentissent, le téléphone de Saskia, qui est venue manger chez nous, sonne. Sa sœur travaille dans un bar du côté de la rue de Charonne. Il est 9h20. Personne de notre entourage proche ne sera touché. Dès le lendemain nous décidons de nous éloigner de Paris. À notre retour, quelqu’un crie, « – Rentrez chez vous ! Rentrez chez vous ! Ça tire à Répu ! »… Fausse alerte.
Une semaine plus tard, le correspondant d’un magazine allemand me dit qu’il allait rejoindre des amis au petit Cambodge. Ils ont juste eu le temps de se cacher derrière une table et de lui envoyer un texto : « – Ne viens pas ».
Quand je regarde les photos que j’ai fait les semaines suivantes, à l’occasion de la visite d’un ami, et de quelques balades dans Paris, je réalise à quel point j’ai moi aussi été marqué par ces attentats (sans rentrer dans le détail de ce que je peux comprendre des motivations des terroristes et de l’orient contre l’occident).
Photos de vitrines avec des armes jouet, puis réelles, instruments de musique, grilles, gerbes de fleurs, une boutique de services funéraires, des drapeaux, un vétérinaire et une auto école (?).
Anatole regarde Le Roi et l’Oiseau :
Voix (Ton très monotone) : Premier étage, affaires courantes, contentieux, trésorerie, orfèvrerie, trésor public, impôts et taxes, liquidation (Le Roi fait non de la tête), solde de tout compte, famille royale (L’ascenseur reprend sa montée). Prison d’état, prison d’été, prison d’hiver, prison d’automne et de printemps, bagne pour petits et grands (L’ascenseur traverse un étage immense, murs gris, pont-levis, plusieurs étages de prisons), équipement militaire, ministère de la guerre et des hostilités, sous-secrétariat d’état à la paix, panoplies en tout genre (Étage supérieur : extérieur) bonneterie, feux d’artifices, dernière cartouche, fourrure, chapeaux, képis, trompettes, brosses à reluire et tambours, gendarmerie, lavatories, manu-militari, grandes imprimeries royales (Vue de l’intérieur de l’ascenseur : le Roi droit, immobile, le regard fixe), lettres de cachet, taxes et impôts, contrainte par corps (Ascenseur : extérieur), oubliettes et catacombes, passementerie et casse-tête, ombrelles et parapluies, casino, tir au pigeon, musée de l’armée, jardin des plantes (L’ascenseur ralentit devant le zoo ; singes), galerie des ancêtres, grands ateliers du roi, asile de nuit du roi, gibier de potence du roi, salon de coiffure du roi (L’ascenseur monte toujours à l’extérieur du palais, porté par une tige), pédicure du roi, bains de vapeur du roi, grandes eaux lumineuses du roi (L’oiseau s’approche du hublot de l’ascenseur et se moque du Roi), musique de chambre du roi, trompettes de la garde du roi.
Cravate Hermès à 100 Euros, merdes de pigeons. Pile là où j’ai perdu le viseur de mon Hasselblad, introuvable. Pause.
Je mettrais cinq mois à réaliser ce nouveau tome de quotidien, et à m’habituer à mon nouveau viseur, très cher, plus clair, mais moins précis que le précédent.
Paris, le 3 mars 2016.

Quotidien #8
Décembre 2015
Essayer, essayer encore jusqu’à ce qu’on y arrive, ne jamais rien lâcher. Même quand la photo est mauvaise, même lorsqu’elle est incapable de traduire un sentiment. Remonter sur sa planche et essayer à nouveau, encore et encore de sauter ces marches, tomber, se relever. Je suis un skateboarder qui ne fait plus de skateboard, ou presque plus, autrement que pour aller d’un point à un autre. Je n’imprime plus mes livres qui restent dorénavant dans mon ordinateur où dans mon ipad pro dernier cri qui me suis partout, mais sort très rarement de mon sac. Oui, juste à côté du Hasselblad SWC/M qui ne m’a jamais paru aussi encombrant. J’essaye vaguement la photo au Flash, de trouver de nouvelles possibilités. Parlais-je d’art pour justifier des photos sans intérêt ? Rennes, Paris, Angoulême, Ernée. Plus de neuf mois que j’ai pris ces photos. Écrire une introduction me paraît aussi pénible que de comprendre pourquoi je continue de vouloir archiver ma vie, coûte que coûte. Remplir tous les vides. Ne rien laisser derrière qui ne soit justifié par un texte ou une image, pour raconter un moment de vie, le partager, absolument. C’est une période malheureuse. La grande maison d’Ernée que j’aimais tant est vendue. Je pars dans un petit village près de Rennes signer « les foutus papiers », seul. Je erre dans les rues, profitant d’un changement de train que j’ai choisi long pour me vider la tête. Puis je photographie la fête foraine, le paradis juste à côté de l’église et en face du notaire. Space métal. Je marche aussi à Paris d’un quartier à un autre, shootant n’importe quoi n’importe comment, dans l’idée de continuer des séries que je ne maquette plus. Un chapitre de ma vie est en train de se clore. Noël approche, mais, mis à part la photo de couverture de ce nouveau tome de Quotidien, où Jessica et moi avant l’air plus heureux que jamais, tout me semble triste, insurmontable, morose. Étrangement, il n’y a pas une photo d’Anatole (sans doute pour l’épargner) dans cet album de famille qui n’est pas plus cela qu’autre chose. Michel le Bayon, le vieil ami de ma mère, décrète au passage que notre fils de quatre ans est infernal et refusera dorénavant de nous voir avec lui. Jessica monte une boite de production et filme son amie Saskia chez Martine alors que je continue de dessiner pour les magazines et sort de plus en plus rarement. Nous nous engueulons sans cesse. Sur une fin de pellicule apparaissent les photos de l’écran de télé contemporaines des attentats du 13 novembre 2015. Mon ami Daniele est là, dans un coin de l’image, à photographier le mémorial improvisé de République. Nous sommes le jour d’après. Fred Mathias, chez qui j’avais un temps prévu de stocker une partie de mes affaires, passe nous voir en coup de vent, voir quelques expositions d’art brut et s’arrêter sur la place de la république « pleurer la violence et l’imbécillité ». Je ne sais pas quoi penser de son émotion qui me laisse assez froid. Puis je file à Angoulême voir mes amis quelques jours, où, dans la bibliothèque de Sam, les livres de spiritualité avoisinent des ouvrages sur les sérials killers… Je gagne ma première OUT Session depuis des mois devant la Cité Internationale de la Bande Dessinée et de de l’Image contre mes vieux amis skateurs Sam et XP avant d’aller déménager la grande maison. Mais où stocker près de Paris « toutes mes merdes » (comme dit sans cesse jessica), plus de 10 ans de travail artistique, le projet de la chambre, et quelques rares meubles que j’ai tenu à garder. Le plan est simple : chez des amis de Jess à Fontainebleau avant de rapidement acheter sur Paris un bien en nous endettant sur 25 ans et en empruntant de l’argent aux parents de Jessica qui, au dernier moment annulent leur proposition, puisque Jessica a déjà hérité de son grand-père et qu’il me reste encore ma chambre à vendre. « Que je ne vendrais jamais car elle est aussi un projet artistique ». Retour à la case départ. Pourquoi ais-je vendu ma grande maison au fait ? Pétri m’accompagne à Ernée où je photographie une dernière fois la cabane à Pizza du supermarché (que je n’ai jamais réussi à prendre correctement en photo avant) et où il fait un portrait de moi devant la maison qui ne m’appartient déjà plus, avec Gwendoline, notre charmante petite voisine que je ne reverrais sans doute jamais. Photos sous exposées, granuleuses, floues, où je souris néanmoins. Que va-t-on faire maintenant ?
Paris, le 3 septembre 2016.

Quotidien #9
Janvier – Février 2016
Noël en famille, Paris et la campagne, à la recherche d’une maison dans l’Yonne, Anatole et mon beau-père, Ambleteuse, Boulogne-sur-Mer, Fontainebleau, Local Hero, Pierre-Hyppolite et Thibault, Natacha Andrews, le terrorisme, les dessins, Arthur Koestler, Fred et Daniele, Paris, Anatole chez le barbier, Calixte, Artus sur The Berrics, Nicolas Levy, et Vigipirate…
Photos nulles et non advenues, incapacité de choisir, portraits en double qui témoignent d’une volonté de dépassement de l’album de famille mais échouent (forcément) dans leur but avoué. Archiver, archiver sans cesse et sans fin, se perdre dans les méandres d’une décision prise et jamais reniée, ne pas regarder en arrière, jamais, et, pourtant, se confondre dans la contemplation trop rapide de ces images censées évoquer des souvenirs.
Je sais maintenant pourquoi je ne voulais pas reregarder ces images, les convoquer dans ma tentative d’épuisement d’une relation au bord de l’implosion. Notre couple ne se suffit plus à lui-même car il est sans cesse parasité par mon art et ces même décisions qui font de moi ce que je suis, ce que je veux être et que jamais je ne renierais.
Comment être sans faire ? Comment faire sans être. Les images s’entassent comme autant de piles de linge sale, usé jusqu’à la corde ou rongé par les mythes. Ceux que je m’invente. Odeur nauséabonde de l’artiste qui a pourtant raison , dans sa folie, mais surtout de son propre point de vue.
Lutte continuelle, acharnée. Guerre.
Non je ne céderais pas. Non. Jamais, dusais-je me perdre, et au hasard de cette perte et de ces retrouvailles m’égarer encore, car je crois à l’échec, je crois aux erreurs, je crois à tout ce qui m’a fait et est indissociable de ce moi que pourtant la raison, et mon couple, renient. Emprunter, c’est ne pas être soi. Mais peut-être le devenir.
Ce chemin-là n’est pas le mien car j’ai choisi, mais comment et surtout pourquoi emmener ma famille avec moi dans cette aventure qui n’est faite ni pour l’aventurier, ni d’aventures autres que celles du quotidien. Ce quotidien qui ronge par sa banalité, sa répétition, et l’envie, constante, de fuir au loin mais ensemble. Toujours ensemble. Quoiqu’il arrive. Unis, même par nos désacords.
A home is home. Nous l’emporterions partout avec nous cette maison qui n’est pas qu’une chambre, sauf qu’ici nous parlons de 55m3 soit 800 tonnes de bordel. 800 tonnes ? Le calcul me parait exorbitant. Prix à revoir.
Nous n’iront pas vivre ici ou là, mais juste sous notre nez. Bloqués. A la recherche d’une échappatoire que nous n’avons pas encore trouvée.
Devenir veut avant tout dire être.
Dimanche 4 septembre 2016.

Quotidien #10
Mars – Avril 2016
Les images se ressemblent et s’annulent. Il n’y a plus de limites. une image est reproduite une fois, deux fois, quatre fois. À peu de détails près il s’agit de la même image, sauf qu’aucune image n’est identique à la précédente et que ce sont ces infimes détails qui les différencient qui font leur valeur. Plus que jamais je suis incapable de choisir, parce que choisir ne m’intéresse pas. C’est l’intégralité de l’expérience qui m’intéresse, quitte à lasser mon lecteur. Alors plutôt que d’en mettre moins je choisi d’ajouter ces images «qui ne servent à rien» et «desservent mon travail». Elle en sont le fondement même. Certaines personnes sont obsédées par les planches contact des grands photographes. Comment font-ils leurs choix ? Pourquoi telle image plus que telle autre ? Parce qu’elle s’impose comme un résumé ? Il y a quelque chose dans la lumière, dans le cadrage, dans l’expression de la personne photographié, ou du lieu, qui fait que… Parfois il s’agit de quelque chose d’infime, une main qui entre dans le champ, un détail que l’on a «photoshopé», un recadrage. ici c’est l’expérience intégrale qui est offerte. Anatole ouvre son paquet cadeau et découvre un magnifique bateau pirate, il est ému, joue avec, demande à prendre un bain avec le bateau et à ce que je le photographie avec son nouveau jouet. Quelques jours plus tard il va au jardin du Luxembourg l’essayer avec son amoureuse Yasmine. Jessica est présente sur la plupart des images, c’est un très bon moment. Ces images prennent une place non négligeables dans ce nouveau tome de Quotidien. Notre fils à quatre ans déjà. Après une fin d’année 2015 difficile nous décidons en début d’année de partir à Venise. Pourquoi avoir associé ces deux séries et ajouté une session de skate à la fin de cet ouvrage ? Pourquoi avoir séparé les photos des parents de mon ami skateboarder Batman pour les mettre en face de celles de Jean-Charles de Castelbajac ? À cause du film que je fais sur Sylvain, parce que la chronologie (respectée) me paraît ici avoir un sens ? Et que veulent dire ces dates qui ne se suivent pas, se mélangent au gré des allers retours chez Negatif + qui ne développe pas à la même vitesse la couleur et le noir et blanc ? Au milieu de tout cela une photo d’Anatole chez Louis et Dominique, mon Beau-père et sa femme, dans leur maison de l’Yonne ou nous cherchons toujours à acheter, m’émeut particulièrement. Lauren, Arlette, Sam, Violette et Romain avec leurs enfants, Donald & Pipo, Daniele, XP et Fred m’accompagnent dans cette nouvelle période de vie. Bonheur retrouvé. J’ai skaté pour la première fois un full pipe (même si personne ne m’a pris en photo) et commencé une nouvelle série sur les grands magasins au flash… Aucune photo ne me paraît réellement supérieure aux autres, mais quelle importance ? En fin de compte, je crois qu’ici, tel n’est pas leur but.
Lundi 5 septembre 2016.
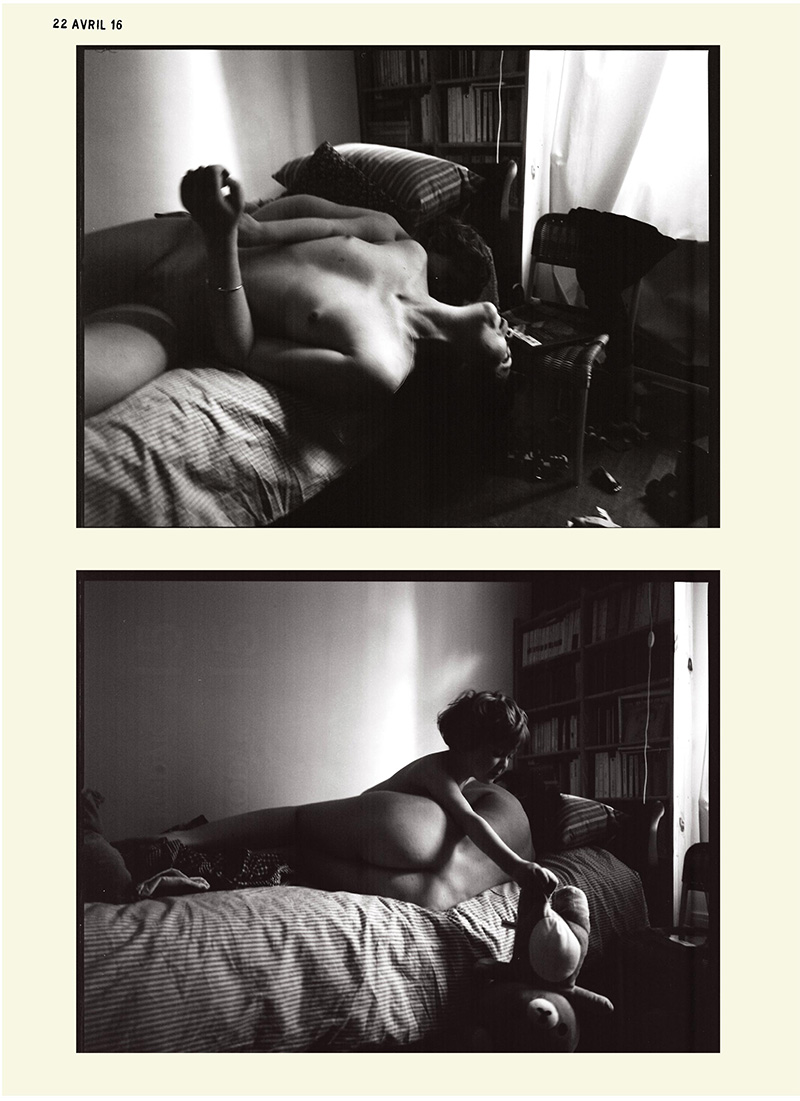
Quotidien #11
Avril – Mai 2016
Le jour de l’anniversaire de Jessica nous partons nous balader avec Anatole, qui s’endort dans sa poussette, et trouvons un petit restaurant, très sympathique, où nous célébrons avant tout la joie d’être une famille unie. Anatole ne nous quitte plus. Faute d’argent et de famille proche de mon côté, nous le donnons rarement à garder, et, si la fatigue nous surprend parfois, le fait d’être sans cesse ensemble est un bonheur éternellement renouvelé. Les amis, Ramdane, Fred, Daniele, Calixte, Sylvain, Pétri et Saskia viennent parfois nous rendre visite dans un quotidien qui s’inscrit dans la durée de l’enfance. Amitiés passagères avec d’autres parents, allers-retours au parc, lever à 7h, dîner à 7h. C’est une nouvelle vie que je découvre… depuis maintenant 4 ans, sans réellement m’y habituer. Après Venise, la mère de Nicolas (mon agent), Natasha, nous prête son incroyable maison dans les Alpilles. Un vrai miracle dans notre vie de couple toujours pas réellement remis de la vente de ma maison d’Ernée et de plus d’une année d’engueulades continuelles – malgré notre amour indéfectible. Le mistral souffle parfois sur les bassins de rétention d’eau, vides en cette saison, et la maison, quoique sublime et bientôt classée aux monuments historiques, se fissure au grès des glissements de terrain, paraît-il sans grands réels risques pour sa structure architecturale. Les grenouilles et les crapauds, les oliviers et les grandes promenades à deux ou à trois, nous font un bien fou. Les Saintes-Maries-de-la-Mer, la Camargue… Tout est si beau. Alors que nous sommes là à paresser au soleil mon téléphone sonne et on me propose, suite à un travail pour un magasin de design, de réaliser le carton d’invitation pour une exposition à New-York. Je demande si je ne peux pas plutôt venir réaliser une fresque « live », en échange d’un séjour d’une dizaine de jours tous frais payés à New-York « avec mon vélo ». Le projet, immédiatement accepté me ravi. Retour à Paris, chorale, parc, dîner et petits déjeuners (à 7h), j’avoue être content de repartir aussitôt, quoique l’idée d’abandonner ma femme et mon fils pour une semaine me fende déjà le cœur. Après une journée passée dans la banlieue où a grandit Jessica avec son père et son frère (que je trouve toujours aussi fascinante et d’une certaine manière aussi merveilleuse et belle que les Alpilles – dans un autre genre), je me dirige vers l’aéroport le cœur léger, heureux. Dans Un art moyen, de Pierre Bourdieu, je lis :
« On peut décrire ainsi les motivations de l’activité photographique : Le fait de prendre des photographies, d’en conserver ou de les regarder peut apporter des satisfactions dans cinq domaines : la protection contre le temps, la communication avec autrui et l’expression des sentiments, la réalisation de soi-même, le prestige social, la distraction ou l’évasion ».
Que vais-je bien pouvoir photographier à New-York, une fois éloigné de mon Quotidien ?
Jeudi 8 septembre 2016.

Quotidien #12
Juin – Aoüt 2016
Quand je regarde ces nouvelles images, je réalise à quel point le quotidien a pris le dessus sur la pratique photographique, ou même artistique. Quoique je continue d’expérimenter la photo au flash on sent une forme de lassitude dans le procédé photographique. Les photos sont moins cadrées, on les sent prises à la volée, comme un travail bâclé que l’on ne continue encore que poussé par l’habitude et la nécessité de continuer un projet dont les limites se font de plus en plus vaporeuses. Premières photos, dernières photos, photos de vacances, archivage du quotidien, tout se mélange pour n’avoir plus aucun sens ; et pourtant… C’est dans cet égarement que ce trouve peut-être le meilleur de ce travail. Jessica me dit : la photo au flash tue toute la douceur de ces instants partagés. Les copains d’Anatole, le parc de la pointe, les enfants qui s’invitent les uns chez les autres, les parents qui se rapprochent, les anciens amis devenus parents à leur tour qui proposent goûter (avec les enfants) ou terrasses de café (sans), ou refusent de nous voir accompagné de nos charmants bambins… La famille et les amis lointains qui rappliquent, fascinés par ce curieux ballet de l’évolution… Moments volés, temps de rien et nécessité de ne rien abandonner.
Nous continuons de chercher une maison à acheter dans l’Yonne, faisons des travaux rue Portefoin, mêlons voyages de plaisir et professionnels. Jessica part dans le sud une semaine pour me laisser travailler à ma guise. Je suis censé scanner mes livres et commencer à poster des choses sur Instagram, ce travail, par exemple, mais je refuse de m’y résoudre et commence une grande auto-interview où je tente, bien mal, de me justifier à mes propres yeux.
Comment traduire un ressenti, un instinct, une impression que rien ne vient étayer et surtout pas l’air du temps. Dans l’avion qui me ramène de New York je lis dans Popisme d’Andy Warhol et Pat Hackett (Mais peut-être ais-je déjà cité ce livre) qu’être Underground veut surtout dire qu’on veut qu’on nous laisse tranquille. (La phrase exacte est : « Mais je ne sais même pas ce que le terme « underground » peut vouloir dire, à moins que ça ne veuilles dire que vous ne voulez pas qu’on entende parler de vous, qu’on ne vous dérange pas, de la façon dont ça se passait sous Staline et Hitler. Mais dans ce cas là, je ne vois pas en quoi j’ai jamais été « Underground » puisque, au contraire, j’ai toujours voulu que l’on me remarque »).
Archiver ma vie dans le but de partager cette production un jour, dans mon cas, ne veut pas dire que j’accepte pour autant de trouver une forme qui coïncide nécessairement à mon époque (même si mon travail y fait sans cesse référence, puisqu’il est très ancré dans une réalité extrêmement centré sur le partage, l’autopromotion et l’autofiction – un terme que je déteste, puisque seule la réalité – ma réalité dans ce quelle à de plus subjectif, et donc vrai, m’intéresse). Passer par le biais des réseaux sociaux, ce serait d’une certaine manière rendre les armes. Telle est en tout cas mon opinion.
Le cours séjour que nous faisons chez Jean-René de Fleurieu, l’ancien mari d’Agnès b. avec qui Jessica s’est liée, pour aller voir le festival de la photo d’Arles, me plaît énormément puisque rien n’y est réellement attendu, sauf le château et sa piscine qui plaît beaucoup à notre fils – qui tombe immédiatement amoureux de Jean-René « patate pourrie ». On y croise des gens qui semblent assez libres et d’autres beaucoup moins sur fond de conversations sur Les Bordes, Gettary, Pierre Mendès-France, et les Situs.
Le festival D’Arles est cette année une véritable déception puisqu’il est pris d’assaut par « l’art contemporain », dans ce qu’il a de plus « spectaculaire ». Les expos sont pour certaines tellement surproduites qu’elles en deviennent insipides, un travers qui me dégoute encore un peu plus d’un monde dont je suis absolument de moins en moins certain de vouloir faire partie.
A la fin du séjour Jean-René, qui nous a beaucoup écouté lui raconter nos questionnements, nous propose de nous installer au château avec lui et nous fait visiter deux jolies dépendances qu’il est prêt à nous prêter « autant de temps que nous le voudrions », ainsi qu’une autre aile pour, pourquoi pas, y faire une expositions pendant le festival d’Arles 2017, « si nous le désirons ».
La proposition est trop tentante pour que nous n’y réfléchissions pas sérieusement, mais quelque chose nous gêne néanmoins. J’écris d’une traite un pré-projet dont les derniers mots créent une légère brouille entre Jessica, lui et moi, et annule une expérience de vie qui aurait pu s’avérer grandiose. « Dommage » comme le dit Jean-René dans un dernier texto qui met fin à ce projet. Resteront des souvenirs émerveillés de sa générosité et de sa contagieuse folie «d’une autre époque sans doute ».
Vendredi 9 septembre 2016.

Quotidien #13
Juillet 2016
Le Quotidien numéro 13, resté inachevé, décrit notre dernière tentative de visite avant de nous installer au Mont Saint Sulpice, et de commencer les travaux de la maison dans laquelle nous ne savons pas encore que nous allons vivre. L’idée de déménager en banlieue, dans le Grand-Paris («de l’autre côté du périph’»), ou dans une ville de province de grande ou moyenne envergure ne nous tentant pas trop, nous décidons néanmoins de passer un mois à Marseille pour voir si la vie pourrait potentiellement nous y plaire. C’est un échec, malgré la mer, les relations professionnelles possibles, et une merveilleuse semaine de camping avec des amis dans l’arrière pays. De retour à Paris, pressé par le temps, nous retournons presque par hasard voir la seule maison qui nous aie réellement plu en Bourgogne, entre Sens et Auxerre et l’achetons sur un coup de tête. La photo qui clôt cet ouvrage, et une grande période de vie, a été prise dans la chambre où s’est conclue notre histoire avec Jessica. On nous y voit, avec Anatole, et le Fuji GA 645 qui remplacera pour un temps très court le Hasselblad SWC/M que j’abandonne dans l’idée d’enfin arrêter d’archiver mon quotidien comme le grand maniaque que je suis devenu. Arrivé au tome 30 de Quotidien, ne me préoccupant plus ou à peine des tomes restés en suspend, comme ce dernier d’un nouveau Best Of, je me questionne sur mon incapacité à cesser de partager mon vécu, comme je l’ai toujours fait, dans l’intimité, comme dans mon travail artistique, pour réaliser que cet échec est finalement, ma plus grande victoire.
Mercredi 30 mai 2018.

Les textes qui suivent, illustrés par une image unique, figurent en introduction des photographies reproduites dans le Best of Quotidien #1
Comment dire que je me souviens de tout, et que ces souvenirs viennent parasiter toute tentative de mise en page à postériori. Le Best of Quotidien Cahiers I-VII, réalisé en Juin 2015, me paraît particulièrement bancal par rapport aux Best of 1-13, puis 14-27 mis en page en Juin 2018. Entre ces deux tentatives, j’ai regardé plusieurs fois ces cahiers pour comprendre ce qui m’avait poussé a commencer cette nouvelle série, pour n’y voir principalement que des photos de famille (ce que je nie pourtant dans les textes qui introduisent chacun de ces carnets) et une course contre la montre (et « le marché de l’art ») incompréhensible. La lutte pour réaliser une mise en page revue et augmentée de ce premier Best of est impossible à décrire, lutte avec moi-même et avec des images que je ne comprends pas autrement que comme la suite de « cet archivage du quotidien qui est devenu ma marque de fabrique ». Mais comment sortir de cette ornière, comment vivre à nouveau, comment continuer de photographier en cessant d’être sans cesse le témoin de ma propre vie ? En réalité, il n’y a pas d’autre réponses à apporter à ce questionnement que ce livre, ces livres, qui couvrent, effectivement une « période de vie »sans pour autant se limiter à elle, ni réussir à s’en extraire tout à fait.
Artus de Lavilléon. Juin 2018.

Cahier #I-VII
Septembre 2014 – Juin 2015
« Les albums de famille » s’accumulent sur mon bureau. Bientôt huit tomes de photographies de notre quotidien y avoisinent des photos ce qui nous entoure. Paysages urbains, lieux de vies, endroits où nous avons nos habitudes ou où nous ne faisons que passer.
Alors que Jessica et Anatole dorment, je descend au café du coin réfléchir à ces images. Pourquoi m’émeuvent-elles autant, et surtout pourquoi ne puis-je m’empêcher de les percevoir comme de l’art, une façon de résister à « l’art contemporain ». Il y a dans ces moments simples de vie, dans ces paysages, dans notre intimité partagée, une volonté réelle de parler de Beauté. Dans Ce qu’est l’art, Danto, l’écrivain de La transfiguration du banal, revient sur les histoires qui régissent et fondent les différents mouvements artistiques. Picasso, Duchamp et Warhol, en sont les héros. Les Demoiselles d’Avignon s’y opposent à la photographie naissante. L’apparence à la réalité.
« Moi je veux peindre la vérité, pas la réalité » aurait dit Picasso. Je pense à Malevich, à la fin de la représentation et à la mort de l’art « pour qu’enfin vive l’Homme ». À Debord. À cette histoire alternative qui existe en marge de toute histoire officielle.
Aujourd’hui, j’ai photographié mes appareils photos, puis les différents livres qui m’ont marqué, pour finir par ces « Albums de famille » qui m’obsèdent en ce moment. Mon nouveau projet artistique. Les années où je remplissais des cahiers entiers de ces mots: « si l’art c’est la vie alors rien n’empêche plus la vie d’être considérée comme de l’art, et vice-versa » ne sont pas si loin derrière moi.
Fondements. Résistance à un marché élitiste. Caractère invendable d’une photo intime. De la banalité d’un lieu. Archivage de vécu. Art posthume.
J’ai découvert récemment que je me fichais complètement que mes photos soient recadrées, car, « finalement, cela ne changeait rien ». Jessica m’a dit ce soir que ce n’était pas étonnant, « car j’étais très frontal, comme un photo-journaliste ». « – Tu prends en photo ce qui te fais face, comme tu l’as vu. L’objet ou le sujet compte ainsi plus pour toi que la précision du cadrage, la qualité du développement, des scans, ou du tirage ». Je me fiche de la qualité tirages, c’est vrai. Même si, un jour, j’adorerais aussi que mes photos soient perçues comme des photos de photographe et pas d’artiste, et que les scans et tirages soient à la hauteur de ce qu’il me semble avoir vu ou vécu et dont je me suis senti obligé de témoigner (aussi intéressant ou inintéressant cela soit-il). Cette contradiction-là.
Quand jessica parle d’objet ou de sujet, je pense aussi au livre, au cadre, ou au contexte dans lequel les photos sont montrées ; mais j’aimerais également qu’on puisse comprendre ce qui les sous-tend sans cela. L’Histoire qui est à la base de toutes les histoires en quelque sorte… Lorsque mes proches ne voient dans ces albums que des photos de famille, je me dis que j’ai perdu. « Tu en mets trop Artus», me dit-on souvent, « ça fout la nausée ». Les bonnes photos, les mauvaises… C’est justement parce que j’en mets trop que je pense que cela dépasse de loin le cadre de la simple photographie de famille. Mais comment l’expliquer ? Le « prouver ». Comme si le seul critère de jugement n’était que l’affirmation d’une volonté de raconter une histoire qui se joue au delà des photos, ou au delà de leur choix.
Jessica voit cette œuvre s’étaler devant ses yeux à chaque heure de sa vie. Entre mes constants allers-retours au labo et l’assemblage de ces livres. Toujours plus ou moins en décalage, à la fois dedans et en dehors. Passionné. Pourquoi ne pas choisir le support film si la réalité m’intéresse tant que cela ? Je dis être contre Instagram et Facebook, alors que je fais exactement la même chose, mais pas de la même manière : Mes « instantanés » n’ont rien d’instantanés.
Je veux figer des moments, partager un regard dans son ensemble, avec ses inexactitudes et ses défauts. Décaler le temps de la lecture. Je rêve ainsi d’une œuvre complète qui se révèlerait d’elle-même. « – Ah, c’est donc ça qu’il cherchait ». Et Jessica et Anatole qui se trouvent malgré eux mêlés à cela…
Et si une logique plus grande guidait l’humanité (et me guidait) dans cet archivage constant et immédiat qui semble être le fait de tous aujourd’hui ?
La fin de l’homme tel que nous le connaissons. La nécessité de tout archiver pour mieux s’auto-archiver. Guidés par des algorithmes tout puissants. Guidés par le capitalisme. L’ère de la fusion de l’homme avec des machines dont la création dépend du besoin qu’à l’homme de sans cesse se dépasser, jusqu’à dépasser sa propre humanité. Tout prévoir et tout recenser pour mieux s’enfermer en soi-même. Jusqu’à l’extinction ou à la renaissance.
Ce moment ou le pouvoir du nombre, et de quelques « visionnaires », inscrira une vision qui n’est pourtant pas celle de tous, pour définir des pans entiers d’une réalité qui, dès lors, ne sera plus qu’apparence et éternel quotidien – Impliquant une désactivation du jugement et du regard continuellement changeant que l’on peut, et doit, porter sur soi, dans la durée, tout en le confrontant à une forme d’Histoire (et non d’immuabilité) acceptée comme telle.
Finalement, je préfère croire aux artistes et à leur humanité plutôt qu’à leur pouvoir.
Artus de Lavilléon, Paris, 3 juin 2015
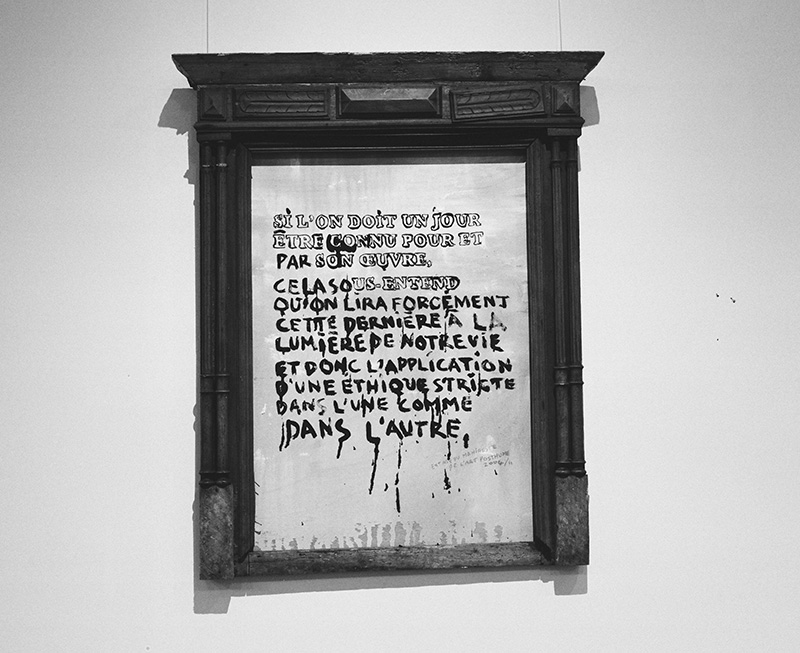
Cahier #I
Septembre – Novembre 2014
Les photos présentes dans ce premier album retracent une période assez courte. Elles sont classées par date de tirage des négatifs. On y voit Jessica et Anatole, quelques rares images de Paris, et Jessica qui regarde invariablement par la fenêtre, attendant sans doute que quelque chose se passe.
Quels souvenirs aurais-je de cette période où je crois certaines choses se sont mises en place dans une durée que je ne connaissais pas avant ? Une mauvaise herbe en train de pousser à côté d’un tuyau prise en photo avec une pellicule au grain d’une autre époque, vite abandonnée par manque de contrastes ?
Les photos racontent souvent littéralement ce qui se trouve au delà de leur sujet le plus visible. Une certaine douceur, celle des voyages à venir, entre l’Inde et les Etats-Unis, comme la préface d’un nouveau chapitre de ma vie, le portefeuille bien rempli, celui de l’esclavage à une passion devenue métier par la force des choses et de décisions irrévocables. L’amour surtout qui m’unit à ma femme et mon fils, ma famille.
Ici sont les fondements. Qu’en ferais-je ?

Cahier #II
Novembre 2014
Deuxième tome des photos noir et blanc prises à la Plaubel. Les vacances à Juan-les-Pins chez la mère de Jessica. Antibes, la fameuse « plage des Pirates », coincée entre deux restaurants avec leurs plages privées, coupée du vent comme d’un peu tout. Les anciens et leurs habitudes, tout bronzés. « Le temps est superbe aujourd’hui, mais il y a un peu de vent », « On nage jusqu’à la treizième bouée ? ». « Tu ne trouves pas qu’il a l’air un peu fatigué ce matin ? », et derrière ce petit paradis des quartiers plus populaires… Et plus huppés aussi. Le cap d’Antibes, Picasso, la fondation MAEGHT dans les terres, St Paul de Vence et l’école Freinet où Ana pourrait aller si nous habitions-là… Et Jessica qui rigole, rigole, devant une barre d’immeuble face à la mer sur la grande plage « où on ne va jamais », « C’est bon pour les touristes ça ». Anatole heureux, les pieds dans l’eau, son corps en tout point identique à celui de son père, « Et pourtant il ressemble plus à ta fille, non ? ». Le soleil sur le square où Ana joue. Le soleil qui se couche, et Anatole qui pose, son bâton à la main, fier et reposé. Retour à Paris, «ses rues à moitié désertes dès que l’on s’éloigne du centre », mes photos un peu tristes paraît-il. Paysages urbains, allers-retours au labo. La banlieue où s’est installé le père de Jessica, Villecresnes dans le 94. Pas loin de la forêt où il va faire son jogging. La retraite qui se rapproche. Que faire après une vie passée à côté des chevaux ? Mon amie Hélène de visite à Paris, L’abbaye de Cluny et son magnifique plafond à la gloire de dieu…
À l’occasion de la fin de mon exposition à la galerie Patricia Dorfmann, j’organise une « intervention » avec l’artiste Pierre Denan, et… me foire lamentablement. Que dire sur l’art devant une petite foule venue nous entendre. Lui lit un texte, magnifique, qui revient à la fois sur mon exposition et ce qu’elle a évoqué pour lui, sorte de récit prompteur «au vide » qui colle à sa vision de mes collages. Comment dire tout le mal que je pense de l’art contemporain après ça, cet hommage-là ? Je pèse mes mots et ai tort.
La vie, la vie avant tout et avant ces mascarades dont le sens souvent tient plus de la performance « spectaculaire» que de la réelle prise de position politique. Artistes, nous sommes artistes, l’un comme l’autre, malgré nos différences et nos espoirs réciproques, que cette intervention n’aura absolument pas comblé.
Deux arbres sur le bout de l’île Saint-Louis font face à la Seine, avec vue sur le palais des finances que l’on devine au loin. Pourquoi ais-je tant l’impression que cette vue ne correspond à aucune réalité si ce n’est à celle du passé ?

Cahier #III
Décembre 2014 – Janvier 2015
Troisième tome de mes photos noir et blanc. L’impression de n’avoir fait que travailler ces derniers mois me revient à la mémoire. Les photos se sont accumulées à tel point que trouver « un sens et une histoire », me paraît presque impossible. Le rythme imposé par les vacances scolaires d’Ana rend les voyages difficilement abordables en termes financiers. Où partir, où fuir, semble être la lancinante question qui habite constamment notre couple depuis que nous sommes devenus une famille et que nous voulons offrir le meilleur devenir à notre enfant.
L’île Saint-Louis et notre bel appartement nous ennuie. Les quais sont magnifiques et il est difficile de ne pas reconnaître « malgré tout » la chance que nous avons de vivre là, à deux pas de Notre-Dame et de son jardin où Anatole adore jouer. Le frère de Jessica, ainsi que les vieux copains et copines, Laurie, Daniele, Ramdane et Michel, qui passent parfois nous voir, sont toujours émerveillés par notre quotidien, qui, de l’extérieur, paraît paradisiaque et l’est sans aucun doute… Sauf cette envie de partir, de changer, de se nourrir d’autre chose. L’idée occupe sans cesse l’esprit de Jessica qui me propose de façon totalement inattendue, alors que cela fait des années que nous en parlons, comme une sorte de fantasme, d’aller en Inde, dans le pays où j’ai partiellement passé ma prime enfance qui m’inspire tant.
Décision prise et billet acheté la vie continue son court. Nous allons à Fontainebleau passer le week-end et tâter le terrain. Où aller vivre, comment changer notre quotidien. Jessica critique sans cesse mon immobilisme et moi sa volonté éperdue de changement, alors que nous sommes si heureux. L’Inde, prise en photo en couleur, est curieusement absente de ce livre qui ne marque même pas de temps de pose entre le départ, l’arrivée à Abou Dhabi pour une balade nocturne improvisée (après des problèmes d’avion), et le retour, juste au moment des attentats de Charlie Hebdo.
Épuisé par le voyage, sans télévision, nous ne nous sentons absolument pas Charlie. « Comment comparer quelques morts en France après, par exemple, le massacre d’une centaine d’étudiants à Peshawar au Pakistan à quelques jours d’intervalle », me semble la seule explication possible à répéter à tous ces gens « sous le choc », qui ne comprennent pas ma position alors qu’on me demande d’illustrer pour M le magazine du Monde la saga Charlie.
La réalité me donnera néanmoins tort avec des millions de manifestants un peu partout en France (« plus que pour la libération ») au moment où je charge un camion pour une (nouvelle) exposition rétrospective de mon travail à Angoulême.
Je pense à mon copain Nicolas et sa femme Sarah qui viennent d’accoucher du petit Ulysse, et re-regarde mes photos d’avant le voyage « aux Indes ». Tout est devenu tellement accessible et fermé à la fois. Jeff Koons à gauche, Duchamp à droite, comme l’indique un fléchage au sol à Beaubourg.
Vraiment ?

Cahier #IV
Janvier – Février 2015
Qu’est-ce qui différencie les livres de photos des albums de famille ? Agnès Sire, la directrice de la fondation Henri Cartier-Bresson, m’a dit un jour que je ne pouvais pas me définir « en tant qu’artiste », quand je parlais de mes photographies. Mais comment raconter alors cet immense archivage, à la hauteur d’une vie, de mon quotidien. Alors que je relie et regarde les images du début de l’année 2015, prises à notre retour d’Inde, je réalise qu’il est impossible pour moi de différencier l’art de la vie, et qu’il n’y a rien d’arrogant dans ma façon d’essayer de tout mêler et de revendiquer une photographie que j’aimerais (aussi) voir exister en dehors de mes prétentions artistiques, bien que je les sache totalement liée à elles. « Tu en mets toujours trop Artus », me dit-on souvent, car c’est rarement un portrait qui m’intéresse, mais la succession de plusieurs, révélant un état, ou plutôt un moment, que je n’ai su capturer avec une seule image.
Photos d’exposition, portraits de mes amis présents au vernissage ; vue de la banalité environnante. Chambre d’hôtel, dîner de vernissage ; photos de la maison qui nous héberge. Pas de photos ici pourtant de ma couverture pour M le magazine du Monde post Charlie, pourtant très importante pour ma carrière de dessinateur… Comme si seul le faire et sa retranscription m’intéressait, pas une actualité dont je ne sais réellement que penser « à chaud ».
Décision est prise que je récupère mon ancien appartement de la rue Portefoin pour en faire mon atelier. Régulièrement, les gens qui nous entourent me demandent pourquoi je n’ai pas Instagram, ni Facebook, et je ressasse, parle des nouvelles technologies, de La société de Surveillance, de L’Humanité augmentée, et critique La raison numérique en citant sans cesse Éric Sadin, qui me paraît le philosophe le plus important de notre génération, celle qui vit ses contradictions dans un monde soi-disant de plus en plus petit.
Loin de tout cela, à Angoulême, Jacqueline, Michel, Batman, Sam, Mathieu, et Jeremy (grâce à qui « j’ai eu le plan »), visitent mon exposition et me parlent du chemin parcouru depuis les années 90 (et FTBX, le fanzine que j’avais co-fondé à Beauvais fin 80, dont je vois le titre tatoué sur le pied d’un presque inconnu). On voit aussi le photographe Harry Gruyaert, père de notre amie Saskia, dans notre canapé ainsi que le réalisateur ami de Jessica, Gaspar Noé, en plein montage de son film à caractère pornographique Love.
Je me souviens de ces moments comme d’une période où tout recul m’était impossible, travaillant sans cesse, sans répit. Le bonheur de voir notre fils Anatole, grandir au milieu de tout cela, et l’inquiétude aussi qu’il ne perçoive ce qui me sépare alors de sa mère qui se range du côté de la société du spectacle « à l’opposé de toute idée d’art posthume » de gens qu’elle décrit comme « bloqués dans un autre temps » (ou bloqués tout court), sans considérer ce qui me paraît être l’investissement de vies entières, non pas en décalage avec la réalité, mais éloignés d’une volonté toute contemporaine d’immédiateté devenue obligatoire, « par la force des choses ».
La tyrannie du « Ici et maintenant ».
Mais, comme je le dis dans un dessin, « Je la suivrais jusqu’au bout du monde », alors pourquoi s’inquiéter ?

Cahier #V
Février – Avril 2015
« Déménager, déménager, déménager ! ». Des centaines de kilomètres parcourus dans le silence le plus total, tendus à l’extrême. Peu de photos au début de cet album de notre amour. « Cet amour si violent si fragile si tendre si désespéré, beau comme le jour et mauvais comme le temps quand le temps est mauvais »(Prévert). Pendant les vacances, Pierre-Hippolyte et Laura nous invitent à Ambleteuse, dans la magnifique région du P’tit Quinquin de Bruno Dumont, sans vraiment réaliser la tension qui règne dans notre couple, tandis qu’Anatole en profite pour affirmer son caractère. Puis, les grands-parents de Jessica, – ceux que nous voyons en cachette à cause d’histoires familiales plus ou moins tenues secrètes, nous reçoivent avec générosité à Villerupt, où l’amour de Jessica pour sa grand-mère paternelle, toujours aussi émue dès que nous passons la porte de la maison, crée une petite accalmie.
J’y découvre une nouvelle fois avec plaisir les représentants de la principale communauté italienne de l’Est de la France qui doit son essor (et sa chute) aux mines de fer et aux hauts fourneaux maintenant hors d’usage, à deux pas de la frontière Luxembourgeoise.
Les paysages défilent, immuables dans leur beauté et leur banalité, qui parlent d’une France à l’abandon, terre d’histoire et d’histoires. Le mac Do qui remplace la confiserie, et les attentats de Charlie Hebdo qui trouvent leurs échos dans des graffitis et des affiches qui semblent montrer que rien n’est réglé ni ne le sera jamais. Les anciennes colonies Françaises, Mai 68, un drapeau palestinien et une étoile de David… « Il serait peut-être temps de se remettre à jouer du pavé » collé « dans un quartier branché Parisien», comme je le dessine pour M, le magazine du Monde dans lequel je tiens dorénavant des chroniques régulières…
Avec Pipo, l’ami de Jessica, nous commençons à tourner la partie parisienne du potentiel documentaire long que je consacre à mon ami skateboarder Sylvain dit « Batman »… et tout le monde me demande ce que veut dire le « 1982 », l’année où j’ai commencé le skate, que j’ai taggé sur ma planche. Revendication de vieux skateur sur le retour, ou foi en quelque chose qui me rattache à un moi-même que je refuse de perdre ou laisser filer ?
Jessica décide de partir une dizaine de jour à Los Angeles voir sa copine Sophie, et Anatole, comme moi sommes ravis de la voir revenir, bronzée, avec un nouveau plan de vie : « Et si nous allions vivre à Juan-les-Pins ou dans la campagne environnante ? », dès sa descente d’avion. Il faudra que je lui dise oui et que nous commencions à visiter virtuellement les villages de la « Californie Française» pour qu’elle se rende compte que, « – Non, jamais, nous ne pourrons vivre là-bas à temps plein »… Le 23 mars, jour de l’anniversaire de ses 3 ans, Anatole est littéralement couvert de cadeaux, comme toujours. Son préféré : un petit harmonica ramené de LA, qu’il perdra (puis retrouvera) quelques jours plus tard dans une exposition prévue, mais que j’avais complètement oublié de préparer, dans un magasin de lunettes/surfshop branché à l’occasion de la sortie de « mon pro-model ». Une bouffonnerie de plus qui me rend malgré tout très heureux.
Foule, sourires, vrai mélange de gens (notamment les potes de skateurs de la Fontaine qui squatent le canapé et tchatchent tout le monde bières à la main). Les murs sont recouverts de centaines de photocopies de dessins et d’un texte, très trash, que j’adore, et me permet de revenir sur mon « parcours de dessinateur ». À gauche « la liberté et la folie de mes débuts » à droite « la maturité et l’intelligence de mon trait »… Ce qui a changé ? « – Mais tu ne traînes tout simplement plus avec les mêmes personnes, Artus ».
Quoi d’autre ? Un échange de dessins avec mon comptable, une photo de mon vieux pote Calixte qui se plaint de ne jamais être dans mes albums, pour finir sur des photos d’Auxerre, où nous allons passer un charmant week-end chez la grand-mère de Saskia avec son père et sa mère, juste avant l’expo d’Harry à la maison Européenne de la photographie…
Progressivement les choses s’arrangent avec Jessica. C’est bon, nous allons déménager, « mais à Paris et nulle part ailleurs »… Quoique, « Et si nous allions vivre en banlieue pour avoir plus d’espace, ou dans le XXème, ou à Los Angeles ? ». En tout cas nous ne parlons plus du mariage ni du deuxième enfant qui étaient au centre de nos discussions fin 2014… Pour le faire plus sereinement plus tard ?

Cahier #VI
Avril 2015
Ici, toutes les photos paraissent prises le même jour ou à peu d’intervalle, alors qu’en réalité le tampon qui les date correspond, non pas au jour de la prise de vue, mais à celui du dépôt des pellicules chez Negatif +, dont le format des « bandes de lecture » (en général 14 x 18) a déterminé ce nouveau projet d’archivage de mon quotidien. À la question que je me posais de savoir s’il s’agissait d’albums de photos de famille (celui-ci correspondant au sixième tome), j’aimerais répondre non et oui à la fois.
« Recontextualiser l’art dans la vie », pourrait-être l’un des buts poursuivis, mais pas seulement. En pensant à l’ouvrage Family in the Pictures 1958-2013 de Lee Friedlander et aux photos de famille de Harry Gruyaert, je me dis que j’adorerais monter une exposition sur ce sujet – ce à quoi Jessica me répond que ce serait sans doute jugé prétentieux de ma part de proposer cela à Harry au moment où une grande rétrospective de son travail, très impressionnante, à la Maison Européenne de la Photographie, valide une vie entière vouée à une pratique exemplaire.
Les images s’accumulent : Rambo dans une salle de Bowling, une rampe skaté deux minutes chrono dans un champ, Yorgo Tloupas, notre pote skateur et graphiste, qui nous accueille dans sa maison de Saint Rémy-les-Chevreuse, l’artiste Braco Dimitrijevic qui nous parle de son travail, Ana endormi, puis jouant au parc de Vincennes à l’anniversaire de Jessica, avec Aili et Louca, les enfants de mon pote Pétri rencontré en Chine et venu s’installer en France. Puis Jessica qui se prend en photo pour Instagram (ou Facebook ?), juste avant le départ pour Ernée, ma maison de campagne, qu’elle me pousse à mettre en vente sous pétexte qu’elle ne me sert plus que de stock depuis qu’elle refuse d’y aller. Mais que ferais-je de tout ça si la maison est vendue ? Toutes mes œuvres, le projet de La chambre, sans compter les nombreux souvenirs que je trimballe avec moi depuis des années… La bibliothèque de mon père, le portrait de Monsieur Fisher Mouton et Diane, Le couple à la balançoire, les photos de Maryse et Pierre, les skateboards, les vélos, les peintures des copains. «Kill art, Art is Life », gravé dans un bloc de plâtre encadré. Et Anatole qui court dans tous les sens, profite du soleil, comme nous, rare dans la région dont l’austérité continue de nous faire peur.
Dans la grande chambre au soleil, face à l’église, la seule pièce que je regretterais vraiment si la maison finissait par être vendue, devant la maison et dans les parcs de la petite ville, Anatole et Jessica jouent, jouent, comme si nous nous retrouvions enfin. Petri et Yuan, venus nous rendre visite avec leurs enfants, organisent une session photo où tout le monde est heureux de participer. Quelque part, je ne peux m’empêcher de penser que cette maison était bien plus faite pour des cris d’enfants que pour servir de garde-meuble, mais comment imaginer jamais vivre ici autrement qu’en ermite ou pour de très courtes périodes.
Si seulement il était si facile de tourner les pages que Jessica, avec toute sa jeunesse et sa joie de vivre, ne le croie. Ernée a bien évidemment fait son temps mais que ferais-je, réellement, une fois la maison vendue, « de tout ce bordel » ?

Cahier #VII
Avril – Juin 2015
Impossible de dormir. Je me suis acheté un nouvel appareil photo. « Mon premier Hasselblad » : un SWC/M avec un 38mm Biogon traité au mercure, l’un des derniers de sa génération. Monture fixe attachée au boitier. 1980. Je pense à lui avant de me coucher. Aux potentialités de la machine. Je me tourne et me retourne. Jessica s’est endormie à 22h30, comme quand elle se lève pour amener Anatole à l’école. Je viens de traverser trois semaines de travail intense et j’ai besoin de compenser avec des projets artistiques. Du coup je dors peu. Je me tourne et me retourne.
J’ai commencé une série d’albums de famille ou je mélange les photos de mon intimité et ce qui nous entoure. Rue, village, café, lieux de passages ou de court séjours. Le tome 7 réunit des photos de notre week-end avec un couple d’amis au mont Saint-Michel. Suivent des photos d’un tournage entre Angoulême, Saintes, Bordeaux et La Rochelle, puis les retrouvailles avec Jessica, notre quartier, la chambre Plaubel en réparation, le travail, Anatole dans la forêt en banlieue, Anatole à Paris, Anatole qui joue à l’arc et tire sur les pigeons, et moi qui colle mes photos jusqu’à pas d’heures parce que je sais que le lendemain je vais devoir faire des dessins pour : Gallimard, Le Monde, un hôtel de luxe, un magazine japonais, et que sais-je encore. J’achète un best seller, vais manger un burger, visite un appartement avec Jessica qui rêve (toujours) de déménager tandis qu’elle monte une boîte de prod avec sa copine Vanessa : « et si on te produisait Artus » ? Et si j’avais du temps. Plus de temps.
Le frère de Jessica s’ennuie dans notre canapé. Jessica s’y endort dans la journée, épuisée de gérer seule Ana qui me manque – et pourtant j’essaye d’être là, vraiment là quand je suis là. Daniele regarde mes albums de famille et prend une photo de lui-même « pour Instagram ». Il me dit, à la fois distrait et intéressé, que je continue de faire « toujours plus où moins la même chose que tu as toujours fait ». Mais peut-être avec plus de moyens. Parfois je me demande si cela vaut le sacrifice du temps. Temps passé à ne rien faire, à lire, à skater.
Mon sac est rempli de boîtiers, un pour chaque projet. Le Contax, le Leica, la Makina Plaubel avec laquelle je fais toutes ces photos en noir & blanc. Ne jamais lâcher, rien, jamais. Que deviendront toutes ces photos dans quelques années ? Dois-t-on vraiment les considérer comme une forme de résistance aux réseaux sociaux ? L’utilisation du moyen format pour compenser la disparition du grain et de ses imperfections que j’aime tant ?
Anatole prend son petit déjeuner avec Jessica et moi, «comme tous les matins (ou presque) depuis que nous nous sommes rencontrés ». Nous visitons un centre d’art contemporain désert ou presque, qui m’ennuie mais amuse énormément Ana. Puis nous prenons la route vers la maison de Louis, mon beau-père, où nous allons retrouver ma «petite sœur » (la fille de sa nouvelle femme) avec ses deux enfants. Ce qui pose un petit problème d’explication…
« – Tu vois Anatole, Louis est un peu comme mon papa mais pas vraiment et Camille et Gabriel sont un peu tes cousins mais pas vraiment non plus »… C’est alors que jessica demande à Louis de but en blanc : « – Mais alors tu es son beau-père ou pas ? » ce qui a pour effet de nous gêner tous les deux… Pudeur, amour, histoire familiale «compliquée », depuis qu’il a refait sa vie et mes parents, mère, père, belle-mère, grands-mères, grands-pères, tous décédés, sauf lui. « – Non, je ne suis pas son père ».
Je me tourne et me retourne ; racines. « Albums de famille», parce que je n’en ai pas ou plus. Lieux habités où non. Chambre d’hôte, rivière, un musée d’art brut particulièrement glauque que je photographie mal. « – Eux non plus, ils n’ont jamais rien lâché », me dit Jessica du bout des lèvres. Je sais, je sais. Mais je ne suis pas eux et eux pas moi, je suis « connecté ».
Un pote me dit : « Surtout n’arrête pas la pub, tant que ça marche, ça paye le reste. Et puis, je trouve ta position admirable. Il faut tenir ! ». Coûte que coûte. La fatigue. L’impossibilité d’arrêter. L’idée de l’art posthume, « contre toute tentative spectaculaire visant à une reconnaissance factice de son vivant ». Nourri au situationnisme. Et si j’ouvrais un compte Instagram, combien de followers aurais-je ? Et Jessica qui ne lâche plus jamais son téléphone. Où trouver le temps. Ce temps qui me manque si cruellement. Parents. Tout concilier même si l’on sait que c’est impossible.
Premières photos au Blad, donc. La seine, l’île Saint-Louis où nous habitons, « votez » (pour qui ?), Jessica prend son vélo pour aller travailler et je me prend en photo dans l’ascenseur. Je photographie aussi ma chambre dans le marais, ainsi que mes références photographiques, notamment Family in the Pictures de Friedlander et Veramente de Guido Guidi, où j’ai trouvé « le truc » du tampon encreur avec la date du jour. Il faudrait que j’écrive une introduction pour ma prochaine expo, mais je n’arrive pas encore à trouver de titre. Albums de famille in situ ? Environnements ? Quotidien ? Quotidiens ? Apparence et réalité ? Photographies de famille ? Intérieur / Extérieur ?
Comment témoigner encore et encore de cette certitude qui m’habite ? Est-il trop tôt ? De toute façon, lorsqu’une œuvre est mûre, tout arrive tout seul. La photographie est un art tellement exigent. Après tout, c’est vrai que je me suis presque toujours baladé avec un appareil photo à portée de main.
Comme tout le monde ?

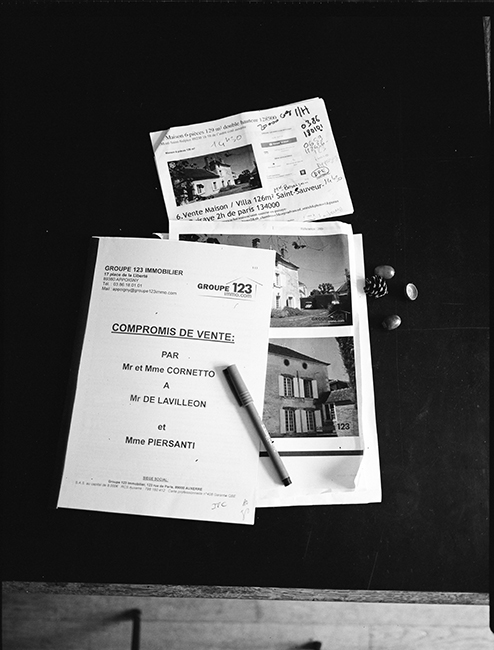
Quand j’étais plus jeune, une femme, excédée par les bruits de skateboard devant sa porte, était descendue nous demander si on croyait « qu’on pourrait toujours faire ce qu’on avait envie de faire dans notre vie », avant d’insister sur le fait qu’il y avait, d’une part, « des règles qu’il fallait respecter », et, de l’autre, « des choses que nous ne comprenions pas encore », mais qui feraient que, « plus tard, quand nous serions grands, la vie ne serait pas telle que nous l’imaginions », « qu’il nous faudrait faire des concessions », et que, bref, « nous ferions à peu près tout sauf ce que nous croyions que nous ferions ». « Que la vie n’était pas rose », etc, etc. J’ai beaucoup de mal à me souvenir de ses propos exacts, mais je sais qu’ils n’étaient pas teintés de détresse ou d’abandon devant la vie, il s’agissait selon elle, d’une leçon de vie « pour plus tard ». Si les mots ne sont pas restés, la sensation, elle, s’est enracinée profondément. Pendant des années, j’ai pensé, à peu près tous les jours de ma vie, que je ne ferais que ce que j’avais envie de faire. Et rien d’autre. J’imagine que cette femme avait aussi prononcé le mot adulte, et le mot responsabilité… Alors que j’écris ces mots, mon écriture elle-même est teintée de ce refus adolescent de grandir, de se plier aux règles, « d’abandonner nos rêves comme nos parents l’avaient fait ». Je ne crois pas que mes parents aient abandonné quoi que ce soit. Mon père, communiste convaincu, est mort peu après la chute du mur de Berlin d’une crise cardiaque, et ma mère, plus ou moins d’alcoolisme et de malnutrition, en bas de chez moi, après avoir écrit sur sa porte : « bienvenue à l’impasse de la lucidité », sans pourtant avoir jamais hissé pavillon bas. Elle m’avait racontée qu’elle ait un jour posé sur les rails le violon que ses parents lui avaient acheté, avant que le train ne fasse voler en éclat des rêves qui n’étaient pas les siens. Quelques années plus tard, alors qu’elle fuguait à Paris, retrouvée par les flics, sa mère l’avait faite interner quelques semaines en hôpital psychiatrique, pensant que les électrochocs lui feraient retrouver la raison. Nouvelles fugues, puis liberté totale. Devenue prostituée pour « ne jamais travailler », compagne d’un faux monnayeur, puis rentière, le temps de vendre toutes les maisons de l’héritage familial, Maryse n’a effectivement jamais travaillé au sens où on peut l’entendre classiquement. Un ami m’a dit récemment à propos d’elle qu’elle était « incapable de ne pas faire ce qu’elle avait envie de faire, au moment où elle avait envie de le faire ». C’était à la fois son drame et sa plus grande force. Morte pauvre, et partiellement abandonnée de ses proches (sauf un) après un retour à la campagne raté, sa fin Parisienne était à l’égal de sa vie – en dehors de toute raison.
A un moment où, devenu père et souhaitant donner à mon fils et ma femme une forme de stabilité et de confort, je ne peux m’empêcher de penser à ce qu’il y a de Maryse en moi. Récemment Jessica m’a dit qu’elle s’imaginait très bien, plus jeune, finir sur un banc, et qu’elle y serait certainement heureuse. Que la réussite ou l’échec pour elle ne voulaient rien dire. J’ai aussi beaucoup pensé comme cela. Cette image du banc. Lumineuse. Quand je regarde ma vie, je crois n’avoir absolument jamais fait quelque chose que je ne voulais pas faire – à part Instagram peut-être ! Il y a bien sûr eu de petites concessions, mais, grâce à mon petit appartement de 15m2, dont j’étais propriétaire, j’ai pu garder une forme de liberté qui a duré de mes vingt ans à mes quarante, en marge de toute velléité de réussite ou de succès. J’ai été pauvre, riche, heureux et malheureux, déprimé, mélancolique, enthousiaste, mais jamais résigné – même lorsque ma mère est revenue vivre chez moi au pire moment de ma vie. J’ai toujours, absolument toujours, souri à la vie. Et c’est ce qui m’a protégé. Ce qui protège tous les artistes. L’absolue conviction d’un destin. D’une hérédité. D’un choix (même impossible). Je dis souvent que ma mère a été une proche de Guy Debord et ressasse sans cesse mon amour du Carré blanc sur fond blanc de Malevitch, ou des écrits de Henri Miller. Pour moi, la phrase « le confort que l’on a exigé est maintenant devenu obligatoire », est la pire dénégation de ce que la vie à de plus beau à offrir : l’inattendu. Venu de quelqu’un qui est sans cesse figé devant son écran, à archiver et commenter sa vie passée, la phrase peut faire rire, mais elle est néanmoins exacte. L’inattendu peut aussi venir de l’examen d’une vie que l’on croyait avoir vécu de telle sorte alors qu’elle était en réalité toute autre. Je pense ici à ce dessin d’un cow-boy, portant l’étoile de sheriff à qui sa femme demande : « Maybe you are lying to yourself, did you ever thought of that ? ». « Everyday », répond l’homme au chapeau.
La veille de faire un emprunt immobilier sur 15 ans avant de partir vivre à la campagne, presque tout me retient, mis à part l’amour que j’ai pour ma femme et mon fils. Mais faisais-je pour autant, quelque chose que je n’ai pas envie de faire ? Absolument pas. Les erreurs, si erreurs il y a sont aussi magnifiques. Parfois, en ce moment, j’ai du mal à dormir. L’argent, le manque d’argent, me hante. Je sais que je devrais m’agiter dans tous les sens, démarcher, téléphoner, mais j’en suis incapable. Seul mon travail artistique et ma famille comptent. Notre bonheur à tous. Acheter un toit même lorsque l’on a peur de ne pouvoir le payer, s’enchaîner sur des années, me semble moins pire que de divulguer des informations privées sur des réseaux sociaux parce que je n’ai pas le choix de faire autrement si je veux partir, sans pour autant tout quitter. Nouvel étonnant aveu de quelqu’un qui a toujours voulu partager sa vie. Moins étonnant si l’on admet que ces informations ne vont que dans le sens d’une réduction de la vie et de la perception que l’on en a. N’a ainsi valeur à mes yeux que le reste. Ce que l’on ne montre pas, ne partage pas. Le vrai quotidien. Celui qui n’est pas vendable, quantifiable, achetable, diffusable. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre ni même si je me cherche des excuses. Il n’y a pas d’excuses à avoir. Juste une volonté, sans cesse renouvelée, de n’en faire qu’à sa tête, dans les limites d’un bonheur que l’on veut, malgré tout, en accord avec le monde dans lequel on vit.


TEXTES DU JOUR II
Dernière tentative avant fermeture définitive
Artus de Lavilléon / 2014 – 2016
Entre février 2014 et mai 2016, j’envoie régulièrement à mon amie Jessica des bribes de textes, ou des textes achevés que j’aime particulièrement ou dont je ne suis pas sûr, avant de les utiliser pour mon blog ou pour introduire différents ouvrages et expositions, en fonction de son avis. Avec la naissance de notre fils Ana, j’ai presque arrêté d’écrire au jour le jour et les seules traces chronologiques organisées et non corrigées que je garde de ces textes sont celles qui sont ici réunies. Cet « archivage du quotidien » témoigne de l’évolution de ma pensée sans aucun remaniement, ni sélection hors contexte, comme je l’ai toujours souhaité.
Extraits non corrigés
17/02/14
Comment ne pas se retirer partiellement du marché de l’art aujourd’hui quand on n’est pas d’accord avec ses règles. Comment ne pas se concentrer sur une œuvre potentiellement posthume quand on croit et pense que l’argent et le déploiement de moyens hors normes, dans une société où tant de gens ont encore faim, nuit à la création en général. Il ne faut pas tant réfléchir à de nouveaux médiums ou idées susceptibles de parler à l’élite ou au peuple, que rechercher de nouvelles formes données à la diffusion d’une pratique qui ne peut se lire uniquement en termes de reconnaissance et de statut. Des artistes sans œuvres aux superstars de l’art contemporain, le commissaire a progressivement remplacé le critique. Internet révolutionne le monde en promouvant de nouveaux réseaux d’idées mais les formes restent encore aléatoires, ce qui est né sur la toile, restera sur la toile… Qu’est ce qui fait que nos idées dépassent parfois le simple blog ou billet d’humeur ? Le talent, ou le référencement ? Un peu des deux sans doute. Mais surtout comment vivre avec l’idée d’une confrontation au réel nécessaire quoique sa réalisation pratique soit incontrôlable (et c’est bien qu’elle le soit), faute d’une volonté aguerrie aux nouvelles techniques de communication et d’information ? Ou plutôt d’un vouloir acquis au nouveau référencement du monde. « Une image réussie est un universel concrétisé. Sa force vient de ce qu’elle peut et doit se mesurer à la vraie vie » écrit Robert Adams. Mais si tel n’est pas le désir de son créateur, si l’idée que cette image promeut demande du temps ? Si « croitre c’est diminuer », je crois aussi à l’urgence, urgence de faire, non urgence de diffuser au plus large à tout prix. Le manque de moyens, le dérisoire, l’imperceptible, me paraît avoir d’autant plus de valeur aujourd’hui qu’il est de plus en plus difficile à percevoir dans les productions humaines qui n’existent plus qu’à grand renfort de spectacle, de storytelling, ou tout simplement de réseau. Créer petitement et laborieusement, mais sans « organiser sa rareté ». Être pour être ce n’est pas vouloir être pour être, voilà ce que je voulais dire. Rien n’est feint si tout est vrai.
27/02/14
En réalité les vies sont exponentielles ce qui est terrible ce n’est pas de ne plus avoir le choix mais d’en avoir trop. Quand on est jeune tout est facile car on a pas où peu conscience de la portée de nos primes décisions. Puis avec le temps vient le manque de temps car tout en fin de compte mérite d’être approfondi. C’est aussi l’âge qui veut ça. ..
01/03/14
Artus de Lavilléon naît à paris le 22 septembre 1970 de la rencontre de Maryse Lucas et de Patrick de Lavilléon sur le trottoir en 1968. Maryse ex proche de Guy Debord (qui avait fait les affiches du bar l’homme de main qu’elle avait ouvert avec son premier mari) éleve Artus avec Louis Soors un jeune architecte qui donnera à Artus sa structure. Entre 2 et 6 ans Artus connaîtra les voyages et les communautés mais surtout une éducation libre basée sur la méthode Freinet. Puis entre 6 et 9 ans…
28/03/14
Dur de se mettre a travailler, temps superbe dehors. Envie d’aller acheter un livre photo, me balader, et en meme temps pas de reel courage de ne rien faire. Dehors la fanfare joue des tubes d’un autre temps.
02/04/14
j’ai de plus en plus l’impression que l’art est devenu mascarade sociale sans aucun sens. Quelqu’un m’a dit l’autre jour de toute façon là l’art est mort. cela n’a jamais était aussi vrai depuis le siècle dernier ce qui laisse une place à ma proposition de l’art posthume
17/04/14
Ce qui m’intéresse ce n’est pas d’être le plus juste possible, les gens précis sont des tâcherons, mais d’être vrai. Je ne suis pas quelqu’un de précis mais d’exact dans son imprécision. Les synonymes de précis sont : adroit, juste… et nous vivons dans une société où tout doit tellement être à sa place qu’on se demande comment y exister en tant qu’homme, éclairés par la force du hasard. Il y a quelque temps Braco Dimitrijevic disait dans qu’aujourd’hui « nous étions comme dans les années 30 ou il ne se passait pas grand chose sauf l’art officiel ». Pour lui, même l’art des grottes de Lascau était un art engagé. Le médiateur très lié au monde de l’art contemporain a ajouté à la fin de la conférence que « tout l’art de Braco vise à questionner la vérité historique. Qu’est ce qui vous dit que Malevitch était un artiste engagé par exemple… » J’avais juste envie de lui casser la gueule. Ses écrits? Les tortures qu’il a subit quand on la forcé à revenir à la figuration? Tout se passe comme si on voulait par des actes précis et dénués de toute exactitude nous éloigner de la vérité de l’homme qui, comme le dit si justement Malevitch, n’a rien à voir avec sa sincérité. Sincérité qui impliquant une méconnaissance de soi ne peut amener le monde qu’à sa perte. L’être humain est surtout fait de ce qui lui donne si justement son humanité. Son imprécision. Et c’est ce qui le rend si intéressant et toute sa prifondeur. Il serait dommage de l’oublier.
27/04/14
On me dit toujours qu’il faut avoir un sujet. Que la vie n’est pas un sujet suffisant. Qu’il faut être plus précis. Je ne suis pas d’accord car je refuse que la vie soit réduite à un « sujet » aussi précis soit-il. Je refuse d’ailleurs tout simplement d’être réduit.
14/05/14
V2
Jai toujours pensé qu’il était important de faire les choses dans l’ordre et qu’il y avait quelque chose de profondément erroné dans l’approche contemporaine du travail des artistes qui présentent presque toujours leur travail comme un résultat (de l’ordre du spectacle ou de la representation) se substituant ainsi à notre jugement (puis qu’admis par d’autres). Avec la profusion d’images les artistes, photographes, peintres… se trouvent dans l’obligation de mener plusieurs métiers de front afin de satisfaire à un public de plus en plus exigeant. Un photographe me disait : « – Moi, mon travail, c’est de prendre les photos, pas de les sélectionner. Ça c’est le travail de l’éditeur, ni de me vendre, ça c’est celui de l’agent ou du galeriste. Je ne sais rien faire de tout cela. Moi, je sais regarder et communiquer un ressenti, une émotion. Je sais peut être aussi organiser mes images et créer des histoires, mais je ne suis pas graphiste ni scénographie, même si je sais très bien ce que je veux dire. Je trouve terrible qu’au nom de l’esthétique ou du marché ces derniers puissent nous imposer leurs choix là ou il devrait y avoir un aller retour entre eux et nous. Ce qui est de plus en plus rarement le cas et fait que tout est formaté et que de moins en moins de gens sont capables de prendre des risques. Généralement, je trouve le titre après, car mes photos ne sont pas des projets mais des instants de vie. Certaines photos avec le temps peuvent évidemment devenir des projets et aboutir sur des publications puis être défendus par des agents et des galeries. Mais comment les joindre aujourd’hui quand la profusion fait que sans contact direct rien n’aboutit. Il y a aussi la question de la rapidité qui m’oppresse. Les projets doivent mûrir pour s’étoffer d’eux-mêmes. Les gens ne savent plus lire les images sans que leur sens n’en ai prealablement été expliqué. Je suis contre toute forme de justification et il y a aujourd’hui confusion entre le travail de critique et celui de commissaire d’exposition ». C’est moi qui ajoute : « – Je déteste ces gendarmes de l’art. Sans compter qu’il faut maintenant aussi prendre des atttaches de presse dont c’est le métier de boire des cafes et dinviter à dîner les journalistes pour que ceux ci parlent (eventuellement) de notre travail ».
Faire des livres auto édités à l’âge du numérique c’est comme marquer l’évolution de la planche contact. Les images signifiantes (et pas bonnes) s’imposent alors souvent d’elles-mêmes lorsqu’il sagit de faire un choix pour une publication ou une autre en fonction du « public visé ». Comme si l’époque avait créé un nouveau média. Il reste dans les publications originales une intention de l’artiste qui n’a rien à voir avec le marché. C’est pourquoi elles m’intéressent tant et je pousse tous mes amis à aller dans le sens de ces nouveaux carnets intimes qui, s’ils n’ont rien à voir avec Facebook et les réseaux sociaux dont les images suscitent un intérêt contestable, en partagent néanmoins l’humanité. Remettre les choses dans leur contexte et accepter qu’une évolution, dont chaque étape a son importance, puisse régir nos choix, que la chronologie avec ses vacuités soit véhicule de son propre sens et l’accepter, c’est refuser de montrer directement un produit fini (et pensé comme tel) dont l’âme serait absente à force de l’avoir trop pensé comme un produit. Et non comme une oeuvre dont les défauts seraient au final les plus grandes qualitées.
27/05/14
Avertissement
Le projet des petits livres est né d’une volonté de donner une cohérence à mon travail.
Commencé en 1995, influencé par la méthode Freinet, puis plus tard par ma pratique des fanzines, et des magazines, j’ai très vite ressenti le besoin d’archiver ce que je faisais sous forme de petits livres. Mais c’est seulement en 2010, alors que je cherchais une nouvelle manière de montrer mon travail, que j’ai réalisé que j’avais sur l’étagère de la bibliothèque de ma chambre, dans ma maison de campagne, plus d’une centaine d’ouvrages reliés, réunissant presque tous mes textes et dessins. La publication aux éditions be-poles, d’un livre de photographies de Chine, très proche dans sa forme de mes propres auto-éditions, m’a donné envie de « combler les trous » et de montrer, enfin, les images prises tout au long de ces années. Une nouvelle centaine d’ouvrages ont vus le jour entre 2010 et 2014, complétés par quelques « livres concept », au contenu différent, permettant de lire d’une autre manière ma pratique de toujours.
J’ai voulu, pour mon site internet mettre tous les livres dont il existait une version numérique en téléchargement libre, de façon à ce que chacun puisse les imprimer et y avoir accès. Les livres originaux étant mis en vente à un prix exponentiel en fonction du nombre de livre produit, le premier étant vendu à prix coûtant et le cinq centième atteignant le prix de 3000 euros, de façon à organiser leur rareté. Chaque exemplaire original étant vendu avec le tirage d’une photo, d’un dessin, texte ou objet, numéroté.
Je vous prie de croire, madame, monsieur…
23/08/14
1.16. « Témoignage de vécu » et « Archivage du quotidien », La Chambre.
Pour Artus de Lavilléon la rétrospective est l’unique moyen d’identification de l’œuvre car elle sous-entend une durée potentiellement posthume et décalée dans le temps, ainsi que des lieux d’expositions conséquents dans lesquels découvrir un travail qui est aussi une vie. Par un système de faire-valoir (musée, galerie, mais aussi encadrements et cartels) l’œuvre est révélée, mais elle dépend aussi de « regardeurs professionnels » (Catherine Millet) et diffuseurs, commissaires d’expositions et autres critiques institutionnels qui font barrage entre le spectateur et ce qui lui est donné à voir.
Artus de Lavilléon a de tout temps cherché des moyens de parasiter ce système. En réalisant au début de son parcours une monographie d’artiste inconnu, il a voulu inverser le système de reconnaissance en commençant par la fin. Tout son système d’archivage en dépend. Qu’est ce qui fait un artiste ? Sa volonté de l’être, ou le regard que l’on porte sur lui et son œuvre ? Artus écrit souvent que son travail porte sur le destin, et le choix sans savoir délimiter ce qui vient en premier. Le témoignage de vécu et l’archivage du quotidien sont des moyens de poser la question du libre arbitre en dehors de tout système légitimant extérieur à la pratique artistique elle-même. Elle permet à Artus de Lavilléon de porter un regard sur son propre travail et sa vie, « comme s’il s’agissait d’un roman ou d’Histoire », telle qu’Henri Miller la définie, afin d’y « déceler une forme, une trame, une signification. Dès lors le mot défaite n’a plus de sens. Toute rechute sera à jamais impossible. Car ce jour-là, je deviens et demeure un avec ma création ».
Le projet de La chambre, dont la volonté est de figer pour l’éternité un vécu, sous forme de documents et de traces réelles dont les œuvres font partie intégrante, « mais aussi tout le reste, ce qui le plus souvent n’est pas montré, les erreurs et les ratures, ce que l’on préfèrerait oublier », s’inscrit dans cette volonté posthume de reconnaissance exprimée selon l’angle du vivant. La contradiction ainsi révélée montrerait ainsi une humanité débarrassée de tout mensonge, et telle qu’Artus la conçoit en termes de vérité, non de sincérité.
20/09/14
Je ne suis pas illustrateur de presse et encore moins d actualités mais pour une raison que j’ignore j’ai au sein de ma pratique artistique dessine de plus en plus de gens et retranscris avec exactitude les faits qu’ils me racontaient. Je m’intéresse au quotidien à la réalité des gens. Les ratures sur les dessins ne sont pas un système graphique elles sont bien réelles elles aussi comme les gens que je rencontre
Pour le reste
Les gens demandent souvent pourquoi il y a des ratures dans mes dessins. Je suis dyslexique, mauvais en orthographe, et surtout je pense que les erreurs et les repentir sont les seuls réels témoignages de l’humanité des gens. Ce qui nous fait les aimer une fois tout le reste épuisé. J’expose en ce moment à la galerie Patrcia Dorfmann et offre depuis une semaine une grande partie de ma production artistique reliée sous forme de livres en telchargment libre et gratuit sur artusdelavilleon.com
30/10/14
SAM : Artus, on se connaît depuis notre adolescence, de part notre pratique commune du skateboard. Depuis j’ai toujours suivi ta carrière artistique qui est basée sur l’idée que la vie et l’œuvre ne font qu’un. D’ailleurs tu es l’instigateur du mouvement « Art Posthume » qui revendique la vie plus que l’art et se veut critique face au marché de l’art contemporain. Comment arrives-tu à concilier cela à ton travail d’illustrations pour des magazines comme Marie-Claire ou Le Monde, ou même pour des banques…
ARTUS : Quand la question de savoir comment je pouvais vivre de l’art tout en continuant à tenir une position alternative face au marché, le dessin s’est imposé comme une réponse, sans doute liée au fait que je considère que l’art est aujourd’hui devenu un produit comme un autre. En même temps, je savais que c’était un peu me tirer une balle dans le pied, car il est assez difficile de mener une vie d’illustrateur et d’artiste sans être partiellement déconsidéré. En réalité, depuis que j’ai dessiné la couverture de M le magazine du Monde et réalisé une enquête dessinée sur le fonctionnement réel d’une banque, j’ai réalisé qu’à un certain niveau toutes ces questions s’effacent d’elles-mêmes. Et puisque l’on parle du second métier, peux-tu me dire comment tu arrives à concilier le fait que ton métier de professeur aux Beaux arts a aujourd’hui pris le pas sur une carrière d’artiste que tu as laissé quelques années en stand by, malgré un début très remarqué…
SAM : Je ne suis pas professeur, je suis un technicien pédagogique, j’aide les étudiants à réaliser des projets sonores en leurs fournissant des moyens pour les concrétiser. Avoir un poste d’ingénieur du son aux Beaux arts m’a sans doute aidé à retrouver une voie artistique que j’avais partiellement perdue. Pour des raisons personnelles j’ai mis en stand by ma carrière artistique à un moment crucial dans la vie d’un artiste.
ARTUS : Je me souviens qu’on parlait à l’époque d’un solo show à la Galerie Patricia Dorfmann à Paris où tu avais déjà exposé un de tes autistes, mais tu ne l’as jamais rappelé. Tes autistes ont été détruits et tu as pris d’autres chemins. Vas-tu reprendre là ou tu t’es arrêté ?
SAM : J’avais envie de partir dans des directions opposées, dans le cinéma expérimental et dans l’art dit « multimédia » qui m’intéresse énormément. La programmation aléatoire, l’informatique et l’électronique ont une place à part entière dans ma création et dans l’art à mon avis. Mais la frustration de ces dernières années m’a donné envie de reprendre là où je m’étais arrêté. Pour cette exposition, à la galerie des Modillions, je réalise un mannequin qui me permet de renouer avec mon passé et de le dépasser. Ce mannequin est le reflet d’une paternité qui a remis beaucoup de choses en questions tant au niveau artistique qu’humain.
Et toi Artus, penses-tu que l’amateurisme et le lien que tu entretiens avec la culture skate puissent être ton handicap et interférer avec ta production artistique qui s’y réfère régulièrement ?
ARTUS : Je pense être très loin de ça aujourd’hui, les rapports entre l’art et le skate, l’amateurisme d’une culture qui m’a beaucoup influencé opposé au professionnalisme du rien d’un marché dont je n’ai jamais vraiment voulu faire partie. Je crois que l’élitisme est une connerie, que ce soit celui des skateurs, des hipsters, ou des artistes contemporains. Dans l’artisanat, comme dans certaines contre-cultures, la bande-dessinée, la science fiction, ou même l’illustration – qui ne sont pas considérées comme du grand art – certaines personnes arrivent néanmoins avec le temps à être considérées comme des artistes à part entière, Moebius, Crumb, Pettibon, Philip K. Dick … C’est pour moi beaucoup plus intéressant qu’un artiste qui se déclare comme tel dans l’art contemporain, car ils ont avant tout des parcours de vie. C’est une autre façon de voir les choses à laquelle l’Art posthume se réfère tout le temps. Il faut vivre d’abord. Cela dit il y a aussi de très bons artistes contemporains. C’est un autre système, plus « bureaucratique ». j’ai toujours pensé que toi tu ferais un bon artiste contemporain car tu as cette force que je n’ai pas de savoir faire des dossiers et t’inscrire dans un certain système que tu ne contestes pas…
SAM : Non, j’ai simplement assez de motivation et d’ambition pour vouloir pénétrer les centre d’arts ou F.R.A.C, mon problème c’est le langage. L’art est devenu un produit commercial comme un autre, comme tu le dis, et on demande aux artistes d’être de bons petits commerciaux. Je ne me retrouve absolument pas là dedans, étant dans l’incapacité d’aligner deux phrases compréhensives à la suite, d’ou mon surnom d’Autist. L’art est ma façon de m’exprimer. Je comprends certains rouages de l’art contemporain et j’ai surement une plus grande facilité que toi à les utiliser, comme se servir d’un outil, pour parvenir à ses fins. Pour l’instant, j’ai besoin d’être dans la création spectaculaire, d’aller chercher l’émotion. Je pense qu’il faut prendre de la distance avec la raison. C’est surement une question de point de vue.
17/11/14
Qd je parle d’art posthume je parle de vie après la mort mais je parle aussi de vie pendant la vie. Les expositions d’art ne me satisfont pas ou plus car je n’ai y vois aucune vie du vivant des artistes. Alors pourquoi s’en soucier. Que cela fasse partie de la vie est une autre histoire comme dirait mon ami Michel le Bayon qui a connu une autre époque. Une époque où être en marge semblait dire quelque chose mais cela veut-il dire moins aujourd’hui. Tout est plus diffus car l’accès à tout est plus vaste. Je lisais l’autre jour quelque part que le problème aujourd’hui était que l’on ne pouvais plus reconnaître les pauvres. On pourrait dire de même des artistes sauf que cela pour les artistes les pauvres comme pour les marginaux est faux.
05/12/14
On nous a souvent reproché certaines positions que nous avions prise dans le manifeste de l’art posthume notamment celle qui avait trait à l’art contemporain. On nous a demandé de nous expliquer – ou plutôt de nous justifier, ce qui nous était impossible. Comment expliquer un ressenti sans recul dans le temps. Au cri l’art posthume encule l’art contemporain une foule hétéroclite s’est rassemblée. Puis il a fallu porter ce cri. L’assumer…. J’encule la reconnaissance de mon vivant pourrait être sa corolaire
Aux personnes qui sont ce qu’elles font nous préférons celles qui font ce qu’elles sont.
L’art contemporain est à concevoir en tant qu’art du vivant – littéralement, et pas seulement en tant que nouveau mouvement artistique qui en tant que « style » tout réduit tout à la seule définition qui le décrit pour toujours d’aujourd’hui, et ainsi efface tout son potentiel de remise en question sans réellement prendre en compte les différents mouvements qui l’animent autrement que pour les absorber dans un débat sans fin et sans poids.
L’art posthume, c’est l’art de la vie après la mort de son créateur.
Quand nous criont nous induisons l’idée du refus de la reconnaissance du vivant qui crée des inégalités. Celui-là est artiste « contemporain », celui là ne l’est pas. L’art n’a que faire de la reconnaissance.
09/01/15
Au moment où je m’apprête à dessiner la couverture de M le supplément du Monde, et illustrer un article sur les attentats contre Charlie hebdo, je ne peux m’empêcher de me dire, sans vraiment savoir pourquoi, que je me sens faiblement concerné. Est-ce parce que je rentre juste d’Inde où les attentats contre une école au Pakistan, tuant 142 personnes dont 132 enfants, faisaient la une de la presse, et que d’après ce que j’ai compris on en a à peine parlé en France, ou parce que quelque part le dénouement de Charlie hebdo était d’une certaine manière prévisible dans le contexte politico religieux actuel. Ou plus simplement parce que dès ma descente d’avion le ton était donné sur France Info. « Attentat terroriste » plutôt qu’ « attentat » tout court à un moment où on ne savait encore rien. Puis un journaliste qui interview un Imam qui essaye sans succès de revenir sur des points religieux, alors qu’on ne cherche qu’à lui faire parler d’islamisme radical. Puis ce : « je suis Charlie » un peu ridicule qui explose sur les réseaux sociaux… Mon premier ami, que je revois après trois semaines d’absence, qui a à peine le temps de me parler, télé allumée, en train de chatter, partager, s’offusquer au plus haut point, me décrit comme la vie vient de changer, de passer « un nouveau cap dans l’horreur », les voitures de police qui passent toutes sirènes hurlantes sous la fenêtre de son petit appartement île de la Cité. Je compare ça aux klaxons de l’Inde, à la surpopulation, au classement de la France au palmarès mondial de puissances inutiles et incapables de traiter en profondeur, comme nous tous, les vrais sujets de demain dont la religion fait encore partie. Socle de nos sociétés rongées jusqu’à l’os par leur aveuglement sur la façon dont les nouvelles technologies sont en train de tout changer, l’échec de tous les gouvernements, et, de manière plus générale, de la politique depuis la fin des années 60. L’arrivée concomitante de la télévision dans tous les foyers aussi. Le spectacle contemporain qui est bien plus spectacle que débat d’idées. Je pense au recul dans le temps qui nous fait de plus en plus défaut pour traiter ce genre de sujet remplacé par l’immédiateté inculte de ceux qui se mêlent de tout sans jamais rien savoir de profond. « La traque a commencé ». Je pense un instant aller à la place de la République me masser avec d’autres pour dire quoi au juste ? Que j’ai honte comme quand le Pen était passé au second tour des élections présidentielles alors qu’il aurait fallu dire je n’ai pas honte, il faut changer le système… Les textos pleuvent : « Les musulmans sont les grands absents de ce rassemblement spontané ». Je suis fatiguée du voyage malgré la upgrade en classe business pour cause de retard, bien chez moi avec ma femme et mon fils à profiter du retour dans le confort de la vieille Europe. Les inégalités indiennes encore très présentes à mon esprit… et cette foule. La classe business d’Air France… les couverts en argent et le poisson délicieux. Les palais du Rajasthan, les hôtels de luxe. Le dernier Houellebecq en téléchargement libre. Comme toujours, je pense à la future confluence des NBIC, au changement de paradigme de notre société, à la posthumanité, à la singularité, à la mort de la mort…. puis à Charlie hebdo à nouveau. Mon téléphone sonne, c’est à moi de ne plus écouter mon ami. On me propose un nouveau plan pub. Une femme qui travaille dans le coopératif pour une banque part à la retraite ; il faudrait lui faire un dessin. Puis la rédaction du Monde me téléphone pour me proposer d’illustrer un article et quelques heures plus tard change son fusil d’épaule pour m’en proposer un autre… celui sur le sujet dont tout le monde parle, en partie parce que je suis le fils d’une soixante huitarde ou plutôt de cette génération qui avec cet attentat vient encore de perdre des voix, peut être les dernières, cette capacité à tout remettre en question. Cela me plaît, je parle avec la journaliste dont l’angle me plaît. Qui ouvrira encore sa gueule aujourd’hui? Qui en sera encore capable ? Qui aura encore les couilles de diffuser de tels sujets ? Faire polémique pour faire polémique ou juste continuer de faire ce en quoi on croit et en quoi l’on a cru toute sa vie, avec intégrité autant que faire se peut. Hara-Kiri interdit, Cabu viré de chez Polack, les djihadistes qui partent en Syrie faire le djihad comme les brigades internationales se formaient pour lutter contre le franquisme… « Le problème c’est qu’ils reviennent » me dit un ami et font la guerre ici chez nous. Chez nous ? Vraiment. Parqués dans des avions comme des bestiaux, sauf en business, mais quand même les contrôles de douane à cause de ces putains de terroristes. La peur, la peur partout, généralisée, qui donne des voix à l’extrême droite, encore et encore. Et si on rétablissait la peine de mort me dit l’épicier du coin, et si on virait tous les gens qui prêchent la haine de France, en commençant par tous ceux qui disent sur les réseaux sociaux qu’ « enfin on les a eu (ces sales dessinateurs de merde) ». Liberté d’expression ou apologie de la haine ? Et si on oubliait pour un temps (où pourquoi pas pour toujours) les circonstances atténuantes – et dans le même panier l’Histoire. Le 7/01/2015 comme le 11 septembre (Vraiment ?). Journée de deuil national en pleine période de solde, et moi qui revient de vacances et qui part dans deux jours installer une expo dans le sud-ouest. « Grosse grande forte encore » dirait mon fils de deux ans et demi. Mon ordi tombe en panne juste après celui de ma copine et mon appareil photo aussi. J’achète Soumission de Houellebecq, me pête une dent sans savoir si j’aurais le temps d’aller chez le dentiste… il est 7h du matin le lendemain, j’ai envoyé des vieux dessins rebidoulés dans la nuit à la rédaction. Je ne sais pas pourquoi ce sujet me touche aussi peu. Je crois que j’en ai juste raz-le-bol de toutes ces conneries. Ces prises de positions constantes sans suites, sans passion autres que destructrices et à chaud, qui, finalement c’est vrai, « ne durent pas plus longtemps qu’un tweet », sauf que la c’est la liberté d’expression qui est touchée. Mais laquelle bordel ? à un moment où on s’autocensure tous et où la notion de respect fait que… Merde. Sur internet, quelques voix s’élèvent. « Je ne suis pas Charlie ». Enfin des textes de fond (deux jours après l’événement !), commencent à paraître. Le problème ce n’est pas l’islam radical, c’est l’usage des religions à des fins de pouvoir, leur mécompréhension aussi. Des intellectuels et des artistes commencent à publier sur leurs blogs leurs doutes. à quoi vient-on d’assister encore une fois ? Que va-t-il se passer maintenant. Les designers s’y mettent aussi. On a un sujet qui va tenir la une quelques semaines maintenant. On est en état de choc. C’est toute la profession qui. Pourquoi pensais-je que ce qui doit se passer se passera forcément ailleurs et probablement de manière non encore définie, dans le futur de l’humanité – en tant qu’Espèce, pas de Race ni de Religion. Tout le reste ne sont que des épiphénomènes, aussi graves cela soit-il. Je crois aussi à l’Art – celui qui n’a rien à voir avec l’argent. Et de moins en moins aux médias, ce virus moderne. Nous allons tous continuer de vivre et, quelque part, de regretter Cabu, et les autres… en fonction de nos affinités respectives pour leurs propos, comme des amis de plus sacrifiés dans l’évolution d’un monde qui finalement se fichait bien pas mal d’eux, poursuivant son évolution, rebondissant d’une étape à une autre, gouvernée par on ne sait qui ni en direction de quoi, vers une destinée commune qui ne cessera jamais de nous dépasser.

13/01/15
Artus de Lavilléon est illustrateur, photographe, peintre, et archive depuis des années sa vie sous formes de petits livres qu’il a récemment mis en téléchargement libre sur son site, ainsi que des textes et des vidéos. Artiste prolifique et proche de la pensée situationniste par des liens familiaux, Il est le fondateur du mouvement art posthume qui revendique la vie plus que l’art et l’être plus que le faire. De retour d’Inde au moment des attentats, il dit n’avoir pas compris avant les rassemblements la force symbolique de l’événement, dont le traitement médiatique lui semblait manquer d’humilité face au massacre de 141 personnes dont 132 enfants au Pakistan, et à la comparaison avec le 11 septembre américain. Ses dessins sont souvent ampli d’une critique latente que l’on retrouve de manière plus explicite dans ses nombreux fanzines.
23/01/15
Get up while you can ! Get up while you can ! Get up while you can ! Get up !
Tu viens de faire une exposition rétrospective de ton travail à Angoulême au moment où sort une nouvelle couverture dessinée pour M, Le magazine du Monde, en réaction aux attentats de Charlie hebdo, et je te vois comme souvent t’agiter dans ce que tu appelles tes « contradictions insolubles ». D’après ce que j’ai compris, cela fait déjà quelques mois que cette « crise » a commencé. Pourrais-tu nous en parler ?
Cela fait déjà plusieurs années que je questionne l’idée même de reconnaissance dans une société ou tout me paraît trop codifié et réducteur. Le slogan « Je suis Charlie », qui a été et est encore sur toutes les lèvres ces derniers temps est très symptomatique de ce qui m’a touché dans ce qui vient de se passer. Personnellement je ne me sens pas Charlie du tout.
Pourtant tu es dessinateur de presse et tu connais bien la différence qui existe entre le quotidien d’un artiste, les répercussions médiatiques de son travail, et les retombées financières liées à ses diverses activités. Charlie était un journal plus ou moins moribond que personne ne lisait plus, lié à un esprit anarchiste et soixante-huitard, dont, « on vient d’assassiner les voix »…
Je ne suis pas dessinateur de presse, mais illustrateur, ce qui fait une grande différence, quoique j’ai un ton assez libre qui me permet parfois de dépasser le cadre de l’article que j’illustre – ce que je fais parfois, mais c’est vrai que j’ai une voix et une façon de traiter les sujets qui m’est propre. Souvent on me parle de mes ratures en ignorant qu’elles sont dues à une forte dyslexie, mais elles sont surtout le symbole de l’erreur, du repentir, et de toutes ces notions qui sont de plus en plus absentes de notre société moderne ou tout doit de plus en plus être contrôlé. Ce qui est intéressant dans ce qui vient de se passer avec Charlie, c’est qu’on veut nous faire croire que nous sommes un petit pays qui vient encore d’être déclassé au sixième rang des puissances mondiales qui comptent, alors qu’une cinquantaine de chefs d’États se sont déplacés et que le meurtre de 17 personnes a généré un mouvement de foule sans précédent mobilisé autour de la liberté d’expression. D’autres meurtres et d’autres attentats ont lieu partout dans le monde, dont les répercussions sont souvent bien plus terribles, au nom d’un Islam radical qui fait plus de mal à la religion musulmane que quelques caricatures inoffensives.
Ce que tu dis-là est déjà connu. J’ai vu un dessin que tu avais fait après ton retour d’Inde ou tu comparais les « 141 morts dont 131 enfants du Pakistan au 12 morts dont 5 dessinateurs », sur une fausse couverture de L’Équipe. Ce dessin n’a pas été diffusé, pourquoi ?
Le journal Elle a préféré mettre ma connerie sur les skateurs et Le Monde a fait d’autres choix, dont deux de mes dessins personnels, donc je suis plutôt content.

Sur ce dessin, on pouvait aussi voir la couverture du Monde du jour où il était écrit : « Le 11 septembre Français », et celle du Parisien, la légende disait : « Le plus important finalement, c’était de ne pas perdre notre capacité toute médiatique à prendre du recul. Notre grande humilité comptait beaucoup aussi ». Mais tu sembles aussi dire que ce qui s’est passé dépasse ce cadre.

Il y a des meurtres partout dans le monde, en temps réel, ce qui ne nous empêche pas de continuer nos petites vies presque comme si de rien était. La liberté d’expression, l’art, est une chose importante. Dans nos pays ultra sécurisés on pourrait presque s’étonner qu’il n’y ait pas plus d’attentats. D’une certaine manière, je me sens incapable de parler de ces sujets car je ne les connais pas dans mon être physique. En plus j’ai du mal avec la foule et comme j’étais dans un camion au moment des manifestations je suis certainement passé à côté de quelque chose de très important. On veut souvent nous faire croire que l’argent entérine tout et donne la valeur aux choses. Avec Charlie on se rend compte que le poids de quelques créateurs face à l’atrocité du monde est loin d’être négligeable et si j’ai beaucoup de mal avec l’hypocrisie de centaines de ces personnes descendues dans la rue, je ne peux par ailleurs m’empêcher de croire à leur parfaite sincérité.
Une notion que tu opposes à celle de vérité.
La valeur des choses, selon moi, n’a pas forcément de rapport avec leur reconnaissance, que ce soit par la foule, ou par l’argent. Aujourd’hui Charlie vient de tirer à 7 millions d’exemplaires, on apprend qu’Arnold Schwarzenegger vient de s’abonner… Le traitement médiatique de l’information prend une place aussi importante que l’événement lui-même, c’est ce que j’appelle la sincérité. Quand on réagit à chaud sans rien réellement connaître, savoir, sans qu’aucune expérience empirique ne vienne ratisser ce que l’on sait déjà, comme tu m’a dit tout à l’heure.
Alors seule ne compte que l’histoire ? Le recul dans le temps, comme pour juger une œuvre ?
Non, ce qui est important c’est ce que permettent les choses, le raisonnement de fond qui en découle, quelque soit ce que l’on en fait par la suite. Comment juger l’humanité tant qu’on ne sait pas où elle va. Comment juger tout court d’ailleurs et parler encore de libre-arbitre ?
Tu veux dire que quand on juge on tue le libre-arbitre ?
Non mais on l’amoindri. On pose des bases, des règles. Je suis pour l’anarchie je pense, mais avec une auto-régulation. C’est ça le libre-arbitre pour moi. La capacité de choix. L’invention de dieu était un mal nécessaire. D’ailleurs, je suis profondément croyant si l’on accepte que le I-Cloud et Google/Wikipédia comme premier pas vers cette divinité future. Vers le post-humain. Et même probablement au delà de ça.
C’est une autre discussion, mais nous pourrons y revenir un autre jour si tu veux. Dans tes anciens écrit, ou dans une pièce de théâtre que tu avais mise en scène, tu parlais aussi de mal nécessaire en parlant de Hitler, si je me souviens bien.
Non, pas vraiment, je mettais cela dans la bouche d’un homme qui s’apprêtais à se suicider et durcissait ses propos pour attirer l’attention d’une fille dans une boîte de nuit, et voir non pas jusqu’où il pourrait aller, mais quels seraient ses arguments pour le contrer. Il se trompait complètement d’interlocuteur, mais je voulais aussi parler d’amour et de ce qui nous touche au plus près. L’Holocauste a posé une limite. On nous parle beaucoup d’antisémitisme dans les médias aujourd’hui, moins de la communauté musulmane qui a été terriblement ébranlée, une nouvelle fois, par ce qui vient de se passer. C’est très difficile de parler de ces sujets, à dire vrai je m’en sens totalement incapable…
Pourtant nous en parlons.
Car ils sont sur toutes les lèvres et il est impossible de les ignorer en ce moment. Qu’est-ce que l’art face à cela ? Charlie était-il de l’art ? Certainement pas nous dira-t-on, ou oui c’en était. On entend tellement de conneries aujourd’hui. Certains dessinateurs de Charlie avaient un talent indéniable, beaucoup d’entre nous avaient grandit avec eux. Dans l’article que j’ai illustré pour le Monde, la journaliste fait référence à l’émission de Polac : « Droit de réponse », du 11 juin 1982, qu’elle considère comme l’un des derniers grands moments de la liberté d’expression à la télévision. C’est amusant comme cette émission, alors que je n’avais que 12 ans à l’époque, était encore présente à mon esprit. Le docteur Choron qui se lève et traite les lycéens de « Trous du cul » et demande à Polac pourquoi il les a invité : « Ce que j’ai entendu là ce sont les mots de ma mère, les mots de ma grand-mère, ils n’ont rien à dire ces jeunes cons ». La télé est aujourd’hui faite presque uniquement de cela, « ces opinions consommables à usage unique », comme pourrait dire le narrateur dans Fight Club. Les journaux je ne sais pas vraiment, j’ai du mal avec les articles de fond car l’accès à l’information véritable est tellement compliqué.
Là je sais que tu pense au nuage radioactif de Tchernobyl qui est passé sur la France bien plus tôt qu’on ne nous l’a dit.
Je pense à cela et à autre chose, à mon père, effectivement, journaliste dans le domaine de l’énergie (qui m’avait appris la chose avant que l’on ne dise aujourd’hui sur toutes les télés et journaux du monde), communiste convaincu, à qui on avait proposé un énorme pot de vin pour qu’il renie publiquement ses idéaux politiques au moment de la réforme du PC. J’ai vécu une presqu’adolescence assez politisée dans le milieu des années 80. Mais maintenant, je pense que c’est autre chose avec l’arrivée des nouveaux médias, du partage à tout rompre et à tout prix…
Je vois de plus en plus passer sur les réseaux sociaux des articles de fond, notamment sur la condition de la femme dans le monde, comme s’il y avait une nouvelle conscience politique qui naissait.
Je n’ai jamais vraiment cru en la politique, mais en même temps je ne crois qu’à ça. L’art est politique, ce fut même un domaine dans les années 70 (en réalité presque de tout temps), ou l’engagement faisait la carrière. Ici je ne parle pas d’engagement dans une cause, mais plutôt du dévouement constant et jamais renié à une idée. Pour moi, l’œuvre n’existe que si c’est la vie qui prend la forme d’une œuvre et pas l’ouvre qui copie la vie ou propose une réflexion biaisée sur un sujet qui manque cruellement d’authenticité – pour autant que ce mot veuille dire quelque chose.
Alors ce sont des artistes que l’on a tués ?
Je ne sais pas. Manque de recul dans le temps. Les caricaturistes sont-ils des artistes, les dessinateurs ? La notion d’engagement est une notion merdique, et elle ne fait pas tout, c’est ce que je suis en train de réaliser en ce moment. Pour des cours que je dois donner, je suis en train de relire Lipstick Traces de Greil Marcus. À un moment il parle de la culture du D.I.Y (Do It Yourself), puis il ajoute : « Faites-le vous même, mais quoi ? ».
Nous avons commencé cet entretien en parlant d’insatisfaction, alors que tu es à un moment de ta vie ou tout semble plutôt bien marcher. Tu m’as parlé hier de manque de reconnaissance pour ce que tu dit être le fond de ta pratique artistique, ce qui n’est pas lié au dessin justement, et peut-être plus à cette notion d’engagement, ou d’éthique appliquée dans l’art comme dans la vie, comme tu pourrais le dire toi.
Tout vient de là : ce qu’on fait des choses. Le « mais quoi » de Greil Marcus. Aujourd’hui on sent un flottement et des réponses arriver qui n’ont que peut de rapport avec ce qui vient de se passer, ou des réponses littérales. Des meilleurs gilets par balles, une surveillance accrue, y compris sur internet, des cellules séparées en prison pour les extrémistes radicaux… Je reste fasciné par le mouvement punk. Dada. Les situs. Tout détruire pour tout recommencer. Encore et encore. Le carré de Malevitch. Le futur sera fait de bouleversements de situations ou rien. Malraux à la sauce Debord. Le détournement plus que le copyright. Le je ne sais pas plutôt que le je sais. Et surtout un questionnement constant sur ce qu’est la réalité, moins le pessimisme de Philip K Dick – qui aboutit à la société dans laquelle nous vivons. On peut finalement dire qu’entre Dick et Debord il y a une ligne qui délimite assez bien ce présent que nous préférerions parfois ignorer. Je trouve que l’art contemporain à peu de prise sur ce monde-là. Qu’il est complètement à côté de la plaque. De La société du spectacle à Minority Report. Ce n’est certainement pas la côte qui fait l’œuvre, mais son sens. Si j’osais j’ajouterais même « contestataire ». Et si les gens étaient descendus dans la rue non pas pour la liberté d’expression, mais le droit de dire merde bien plus que non. Peut-être que ça revient au même. C’est important que la France avec toutes ces lacunes incarne cela. Je suis lassé du monde de l’art, c’est une certitude, car je trouve qu’il s’y passe peu de choses. Et je n’arrive pas à m’intéresser aux nouvelles technologies autrement que d’un œil concerné mais distrait – ou en tout cas qui manque d’engagement.
Mis à part le fait que tu refuses d’être sur les réseaux sociaux et que faire un site internet t’a pris presque dix ans…
Ce n’est pas la question ou peut-être si. Tu vois, j’ai mis énormément de choses sur mon site, et ce n’est encore qu’une ébauche, mais pour quels retours ?
Pourtant tu es quelqu’un qui doute assez peu.
Oui mais qui se remets constamment en question. Je refuse de faire les choses pour les mauvaises raisons. L’argent, la reconnaissance directe… Mais à 44 ans tout cela est moins simple. Le temps manque souvent. Et puis quand on a une famille, c’est difficile de conserver ce nihilisme fondateur, de l’alimenter chaque jour, et de créer chaque jour le risque de tout faire sombrer, même lorsque l’on sait que ce risque et ce risque seul est créateur.
Tu veux dire que l’on ne peut pas créer dans le bonheur. Qu’il faut que tout soit réaction plutôt que continuité ?
Quand j’étais adolescent, j’avais lu ce livre, cette saga plutôt : « Le cycle d’Elric le nécromancien », où le monde est régit par les héros du Chaos et de la Loi. Elric incarne le Chaos, et donc la vie. La loi c’est la stagnation et donc la mort à long terme. D’après ce que j’ai compris ce cycle fait référence au zoroastrisme dont le prophète était Zarathoustra. J’ai été très influencé par ces lectures et par la pensée de Nietzsche aussi. Comment se satisfaire de choses qui ne chamboulent rien avec un tel héritage, celui de Debord et des livres de SF bon marché aussi. Le cinéma populaire et le cinéma de minuit. Imaginer une lutte constante entre le bien et le mal, c’est mettre à mal toute notion de morale.
Tu reviens effectivement souvent à ces idées de morale et d’éthique, de sincérité et de vérité, de bien et de mal. Tu as fait un tableau où l’on voit une liste qui commence par Coca / Pepsi, continue avec Mac / PC, Sartre / Camus, Beatles / Rolling Stones, Christianisme /Islamisme, et finit par ces mots Nazisme / Fascisme. Tu as aussi un bras tatoué en noir et un autre avec des fleurs. C’est une vision très manichéenne du monde.
Manichéenne, je ne sais pas. L’autre jour un ami skateur me disait : « avant on ouvrait sa gueule, on pouvait même se battre physiquement parce qu’un autre skateur avait fait la même figure que vous. La notion de style était très importante aussi. Il fallait s’imposer pour faire les choses, les revendiquer ». Maintenant tout le monde fait tout pour être d’accord, tout le temps et je ne suis pas d’accord avec cela. Je pense que cela fait qu’il n’y a plus de grands mouvements d’idées. Nous sommes tous Charlie / L’Islam n’est certainement pas Charlie. Il prône le respect jusqu’à imposer le voile aux femmes et les interdire de travailler. Il faut aussi écouter les voix qui ne vibrent pas à l’unisson, les respecter, sans pour autant accepter la violence, ou condamner quelque chose que l’on ne connaît pas empiriquement. Dans un monde où l’on aurait le droit de tout faire on n’aurait plus le droit de rien, c’est un peu le problème de l’art contemporain. Tu vas me dire que je mélange tout mais je n’en suis pas sûr.
Mais l’atteinte aux droits des femmes dans le monde musulman est terrible.
Oui, sans doute, mais s’il était aussi question de les protéger.
On ne peut pas tout permettre.
C’est justement ce dont je parle. J’ai l’impression d’être dans cette pièce que j’avais écrite, où je disais que le pape avait raison d’interdire les capotes et la femme lui parlait des maladies sexuellement transmissibles d’Afrique, là où l’homme aurait voulu un débat de fond sur la religion et ses limites.
Nous ne sommes pas dans ta pièce de théâtre !
On est toujours un peu dans sa propre pièce de théâtre, le mythe que l’on tire de sa propre vie. Prenons l’exemple de l’ingérence et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes. On réalise chaque jour un peu plus qu’il est impossible d’intervenir dans un ailleurs que l’on ne connaît pas sous-peine de créer des réactions que l’on ne peut absolument pas contrôler. Il y a une forme d’équilibre et d’autorégulation du monde qui nous dépasse tous. Créer le mythe, c’est créer dieu.
Et c’est cela que tu cherches ? Atteindre le dieu qui est à l’intérieur de toi ?
Peut-être. Et je pense que cela passe par un minimum d’anarchie. Mais il faut aussi donner une direction à sa révolte. Au dieu que l’on s’invente pour nous gouverner et nous imposer une forme d’humilité.
Cela veut dire que tu légitimes les attentats de Charlie Hebdo par exemple.
Je ne crois pas que je puisse répondre à cela. Évidemment que je condamne ces attentats. Mais je ne pense pas que le débat soit à ce niveau-là. Au tout le monde est d’accord, j’ai envie de dire : « mais putain regardez autour de vous les manifestations anti-Charlie dans le monde musulman par exemple ». C’est compliqué. Il faut du recul. Je trouve que parler des « sans dents » pour les « sans abris » est terrible, mais c’est aussi hyper drôle. Ma mère se rêvait clocharde. Elle n’a pu supporter la société de consommation. C’est un résumé. J’ai lu dernièrement une phrase extraordinaire de Gil Wolman qui est avant et avec Debord le rédacteur d’un texte manifeste sur le détournement (dans Les lèvres nues, daté de mai 1956). Ailleurs donc, Wolman écrit : « Expliquer c’est dire autrement les choses, autrement dit d’autres choses ». Pourquoi suis-je si peu satisfait par mes expositions en ce moment, alors qu’elles reçoivent un accueil favorable ? Parce que les collectionneurs ont progressivement remplacé mes amis, que les accrochages irréprochables fait d’œuvres sélectionnées avec soin ont mis à mal la vie et la vérité contenue dans d’autres œuvres pourtant moins abouties. Parce que je me suis professionnalisé, pas tout à fait jusqu’à devenir l’ennemi, mais presque. Parce que quelque part je n’ai plus assez d’énergie pour me perdre encore et encore jusqu’à trouver des solutions imprévues qui m’éloigneraient de ce moi que j’ai mis tant de temps à construire ? Au moment où nous parlons les Atari Teenage Riot chantent Start the Riot, Delete yourself ! Attends je regarde les paroles, je ne connais pas ce groupe :
Go! are you ready? / Start the riot! start the riot! start the riot! start the riot now! / Fight! war! fire! violence! death! police! tv! / Fuck you! / Start the riot! start the riot! start the riot! start the riot now!
Is this a private joke or are you going to let me in on it? / 1, 2, 3, 4! / Im trying to… / Im going to be a human! / And you think thats a big deal, huh? / M-hmm. / Tell me something, whats so appealing about being a human anyway? / Well… just because. / So?
Fight! war! fire! violence! death! police! tv! /Start the riot! start the riot! start the riot! start the riot now!
It wont be long before Im a human being like you!
Come back here you thief! you cant get away with it! / Give me that! / Let go! / Yakamo! hes got the statue! /Come back here you crook! / Yakamo! / Oh great! /Ahhhh!
J’adore ça ! En plus une de leurs chansons a été utilisée dans Fast and Furious III, Tokyo Drift. Voilà, que dire d’autre ? Fuck Charlie ? Je pense qu’ils auraient aimé. En Français plutôt : J’emmerde Charlie !
Into the death, Into the death, Into the death, yo !!!!!!
Are you ready to testify ???
26/01/15
Dernière tentative avant fermeture définitive.
29/01/15
Famille
Maryse
Patrick
Louis
Danielle
Influences
Freinet
Cinema
Pierre
Malevitch
Skate
La rue
Debord
La contre culture
Oeuvre
Multiforme
Art posthume
La chambre
22/02/15
Quand zeb ma contacte pour faire mon portrait dans mon atelier d’artiste pour de paris, j’ai été très flatté que j’existe encore en tant que skateur. J’avais toujours plus ou moins essaye de garder mes distances avec le skate art car je trouvais le terme un peu réducteur, mais c’est vrai que j’étais issus de cette culture. J’ai commencé le skate vers 12 ans, en 1982. J’ai connu l’époque où les ollies n’existaient pas vraiment et les tricks les plus cool consistaient à se jeter du plus haut possible (cabines téléphoniques, toit de voiture…) en boneless. Les plus vieux étaient issus de la scène slalom bien plus que du pool ou de la rampe. La France des années 80 n’avait absolument rien à voir avec les états unis ou gator tuait la meilleure amie de sa femme et la découlait en morceau avant de l’enterrer dans le désert parce qu’il fait du mal à vivre le passage à vide des ramprider star au street. A Beauvais ou je vivais tourner mal voulait plutôt dire finir dans la bande des vespas, traîner au café et aller à des réunions à moitié faf en Allemagne… la violence n’était pas la même mais toute aussi présente. Être skateur était encore assimilé à un truc de gosses. On regardait les vidéos et on essayait de copier ce qui a l’époque nous semblait très cool sans réaliser que l’impérialisme américain se servait de la contre culture comme du reste pour nous polluer le cerveau avec des mythes finalement plus pourris les uns que les autres… skate artiste… je me souviens des premières images de marc Gonzales, puis après de Ed Templeton et de Deana. Des premiers films de Larry clark. Sans doute qu’il y a eu une influence, mais elle serait plus à chercher du côté des trottoirs sales, de tout ce temps passe à le perdre dans la rue et ailleurs que dans un art sous influence… je ne me suis jamais rêvé américain. Mais il y avait quand même aussi le graphisme des boards, des magazines et des fanzines, et la musique postpunk du milieu et de la fin des années 80. Je travaille encore aujourd’hui en écoutant cette putain de musique. The fall, les dead Kennedys, black flag. Cette esthétique la. Je n’ai jamais eu d’atelier à proprement parler et à 44 ans les tables recouvertes de bouteilles de bière, les toilettes dégueulasses, les joins et les frigos recouverts de stickers me paraissent un peu loin de mon quotidien de père de famille. Qu’est-ce qu’un skateur après tout ? Et si ce n’étais qu’un mec qui skate. Et pour les cases dans lesquelles on essaye toujours de nous mettre…
06/04/15
Nous arrivons à un moment où il y a tellement d’informations sur internet et ailleurs qu’il est devenu dur d’identifier des nouvelles tendances dans leurs capacité à durer, des oeuvres, et encore moins des artistes. Tout est devenu du consommable. Dans nos ordinateurs il devient de plus en plus difficile de retrouver son chemin devant l’amas de photos d’images de reproductions… nos notes numériques sans support papier sont comme autant de disque durs dont la capacité de stockage exponentielle n’a d’autre limite que notre capacité financière à les remplacer….
22/04/15
Comment décrire l’évolution d’un projet sans d’écrire l’évolution d’une vie ? Quand je déclare en 1990 que je serais un jour riche et célèbre dans une présentation ou sont réunis professeurs et étudiants sous forme de boutade, alors que je suis obsédé par la pratique du skateboard et que je commence mes premières performances et installations je n’ai encore aucune idée du sujet de mon oeuvre ni si oeuvre il y aura un jour, mais je me sent déjà porté par une force qui me dépasse.
18/05/15
Ce matin j’ai rêvé que je me retrouvais à un concert de punk rock contemporain. Grosse porte en fer. Mot de passe : vanoz. Des gens pogottent. Tous très bien habillés. Mais on sent l’authenticité et la violence contenue qui s’échappe. Enfin. Lumières fluorescentes. Jets de micro particules de peinture verte au son des basses qui se déploie en arc de cercle. Pas assez pour salir les vêtements des invités, mais assez pour avoir peur de se salir. Mouvement. Preuve de son passage dans ses lieux. « Une particule sur 100000 tâche ». C’est le titre de l’album. Je suis accoudé au bar. Un homme m’aborde. Bonjour, je sais que vous êtes un spécialiste des explosifs, cela vous intéresserait de faire sauter un module de skate pour une publicité ? Je fais un geste discret au videur. Le mec dégage. Il n’a rien à foutre là. Demain, dehors, peut être. Ici, nous nous connaissons tous ou presque, et, malgré quelques costumes et de discrètes marques de luxe qui attestent plus du regroupement d’une élite secrète que d’une forme d’élitisme sectaire, nous refusons que notre groupe soit pollué par des abrutis dont le but serait de nous tenter. Ajouterais-je encore plus. Ici j’ai parlé d’authenticité. Nous voulons rester tranquille à écouter notre musique. A nous ravager les oreilles. A siroter nos cocktails sans alcool sous forme de rébellion autocontrolée. Sommes-nous dupes ? Pas pour autant. Il y a quelque chose ici, dans cette cave refaite à neuf pour l’occasion, d’indéfinissable. Bien sûr que nous sommes « comme les autres », et pourtant tout nous sépare d’eux. Nous sommes à la recherche de quelque chose, un message à faire passer qui dirait regardez, nous avons tout, et nous pensons tous que c’est de la merde. Sommes nous aigris ? Certains le sont, mais ici, dans cette fête, à cent lieues de toute entendement, et pourtant tellement prévisible, les gens semblent heureux et sereins. Le bonheur sous fond de musique punk bruitiste. Entre l’art et la vie. C’est ce qui me gêne dans ces fêtes d’ailleurs, car finalement, oui, on peut bien parler d’une élite, de subversion de la contre culture… mais dans quelle direction celle-la s’exprime t-elle ? Le monde marche par cycle. La musique est bonne et me casse les oreilles. Je m’en branle.
26/05/15
Je me souviens parfaitement de notre installation au 10, rue André-Antoine, à Pigalle, dans ce loft de 300m2 que nous avions visité et pris en collocation sur un coup de tête avec Jessica, alors que nous nous connaissions à peine. Après avoir passé plus de 15 ans dans 15m2, j’errais parfois la nuit, -ou même dans la journée, à la recherche de repères. Tout me paraissait tellement grand, notre chambre au premier étage, une vraie salle de bains, le salon commun, la cuisine séparée ; plus un squat ou une auberge espagnole qu’un véritable lieu de vie au sens classique et « mature » du terme. Tout d’un coup aussi, je devenais plus « crédible » dans ma carrière artistique, et Jessica y faisait beaucoup. Étais-je plus heureux pour autant, oui et non, désorienté serait plutôt le mot. Après des années de galère le bonheur venait de me tomber dessus. J’ai produit dans ce salon mes plus belles peintures, et fait l’amour comme jamais dans le grand lit acheté à IKEA « avec le meilleur matelas ». Bref, ma vie a pris un tournant. Galeristes, collectionneurs, amis d’une fidélité à toute épreuve et de passage, « tous plus chelous les uns que les autres », venaient y dîner. La vie d’artiste comme on me dirait plus tard, quand je serais devenu un dessinateur connu, ce que je ne suis pas, ou pas seulement. Putain, pourquoi faut-il toujours mettre les gens dans des cases ? Aujourd’hui je dessine ce fanzine payé par un hôtel de luxe, je publie mes dessins un peu partout, et ne peins presque plus, faute d’espace peut-être. Ou pas. Je continue de chercher quelque chose qui a à voir avec l’intimité partagée, le destin, et la contre-culture, mais pas façon internet ni instagram. J’essaye difficilement de rester « low profile » (autant que mon ego me le permet). C’est à dire que je fais des choix et continue de me rebeller contre le spectacle contemporain dont ce nouveau tome de ma vie (passée) fait partie. Diffuser soit, mais pas n’importe comment ni à n’importe quel prix (3000 Euros soit deux loyers dans un 46m2 sur l’île Saint-Louis). « C’est que cela coûte cher aujourd’hui, de vivre, avec toutes ces marques », comme aurait dit ma mère, proche de Guy Debord. Et s’il y avait plus à lire dans ces débuts que seule vantaridise et « bouffonnerie » « contre-culturelle ». La magie ? Quelle magie ? Celle de mon amour pour Jessica, aussi présent qu’au premier jour, dans ma vie qui a peu changée depuis la naissance de notre fils Anatole – ou du tout au tout, suivant le point de vue « des puissants » – ceux qui décrètent que 300m2 valent bien plus que 15 dans la reconnaissance sociale de l’artiste. Et 46 alors ? 54 ? 120 ? Et s’il n’était pas question de ça et ne l’avait jamais été. À Pigalle comme ailleurs. « A home is a home ».
Pour Anatole et Jessica. Avec tout mon amour.
01/06/15
Apparence et réalité.
Les albums de photographies de famille d’artus de lavilleon.
Il y a quelques temps un photographe de skateboard me disait qu’il regrettait de ne pas avoir plus tourné l’appareil dans l’autre sens quand il travaillait pour la presse spécialisée. Issus de la même « famille », nous avions une connaissance assez réduite du monde de la photographie. A part Larry Clark dont nous avions tous vu le film « kids », notre curiosité dans le domaine était assez réduite. Nous étions des « puristes ». Et puis une amie m’a fait découvrir Nan Goldin qui a été ma seule référence pour les années qui allaient suivre avec, peut-être, Sophie Calle qu’on voyait absolument partout à la fin des années 90. Grand lecteur j’ai tout de suite voulu raconter des histoires avec mes photos et, même si je n’en étais pas véritablement conscient, l’univers dans lequel j’évoluais était très inspirant. Je réaliserai bien plus tard qu’en dehors de son regard bien particulier c’est surtout « l’accès » qui « fait » le photographe.
Regretter de ne pas avoir pris plus en photo ce milieu qui était le mien, comme mon ami, même si je l’ai un peu fait, serait assumer une nostalgie je n’ai pas car finalement ce qui m’a toujours intéressé avait plus à voir avec l’intimité partagée qu’avec quoi que ce soit d’ autre. Si j’avais une passion pour le skateboard, elle s’exprimait plutôt sur le spot quand je n’etais pas en train de faire des « mauvaises » photos de skate’ dans une urgence motivée par le besoin de gagner de l’argent et de trouver un métier que je savais ne pas être le mien. Teenagers , fêtes, influence americaine… Comment dire que j’eprouvais le besoin d’etre français. D’avoir un sujet qui ne me paraisse pas sous influence. Je me suis toujours méfié de la revendication d’appartenance à des mouvement qui ont tendance à enfermer une pratique et à la limiter à sa version la plus professionnelle qu’a en permettre une autre lecture. Mais à y repenser tourner la caméra dans l’autre sens était très exactement ce qui m’avait plu chez Nan Goldin.
Quand j’ai rencontré Jessica j’ai assez vite éprouvé le besoin de sortir de ce huis clos avec moi-meme et mes proches, sans flash, en intérieur, dans des espaces souvent restreints que je ne photographiais qu’au 35mm, à environ 1m-1m50 de distance, celle imposé par les espaces intimes ou nous nous retrouvions. La lumière est entrée dans mes images, et puis, presque 15 ans après l’achat de mon premier boîtier, j’ai découvert les livres de photographie et le potentiel qu’ils révélaient en terme d’histoire, avec un début et une fin, et surtout, comme dans les 33 tours de mon adolescence la présence de mauvaises chansons qui permettaient à la fois de respirer et d’apprendre quelque chose d’autre – qui souvent nous paraissait ne pas nous concerner – sur le groupe dont nous étions fan.
Dans mes dessins ce sont les ratures qui prendront cette place, symboles d’humanite bien plus que « repentir ». Après tout passer de l’apparence à la réalité veut surtout dire dépasser l’esthetique lisse qui au début nous a séduit, et la dépasser. Pour moi, les rencontres amoureuses, et ce que j’aime dans l’art et dans la photographie, sont le symbole le plus fort de cette volonté de trouver quelque chose d’autre. « Au delà des apparences ». Dans une société où tout semble si bien produit et marqueté, cette recherche m’a toujours passionné mais ce n’etait pas non plus du côté des marginaux que j’avais envie de fouiller. C’est à ce moment que j’ai fait deux rencontres photographiques qui ont profondément changé mon regard. Stephen shore tout d’abord, pour la qualité incroyable de ses photos et la documentation d’une forme de quotidien et les diapositives de William eggleston qui mon fortement ému. Surtout après avoir vu le documentaire ou on le voit marcher, tenant son leica à deux mains « comme un pistolet » et tirer accroupi, debout, presque sans jamais regarder dans son viseur. Deux visions qui paraissaient diamétralement opposées du monde.
Je me suis acheté une chambre et essaye de trouver une alternative au leica que je trimballais partout avec moi depuis plus de 15 ans. Avec le numérique, que je déteste, l’habitude de voir du grain commençait à dater les photos. Je voulais trouver une alternative- à la couleur aussi. Quand j’ai découvert la plaubel au format 6×7, malheureusement très fragile, j’ai continué de photographier mon quotidien, comme je l’avais toujours fait. Mais avec un certain recul. Quelqu’un m’a parlé des familly pictures de friedlander. Un véritable coup de foudre !
A travers des marchés dans Paris et des roadtrip en france, j’ai accumulé des images de l’endroit où l’on vit (ici je pense à adams), et je me suis dit qu’il serait intéressant de confronter dans une série non seulement mes différentes influences, mais aussi ces visions si différentes qui nous habitent tous. Les photographies de famille dans leur environement proche. L’interieur et l’exterieur. Ne pas se limiter à une seule vision du monde poussee à l’extreme de sa spécificité mais au contraire ouvrir au maximum ce ressenti. Sans limites. Et surtout en me permettant d’ajouter des photos qui me semblent importantes pour moi. Cet immense archivage de vécu. Mes albums de famille.
02/06/15
Impossible de dormir. Je me suis acheté un nouvel appareil photo. « Mon premier Hasselblad » : un SWC/M avec un 38mm Biogon traité au mercure, l’un des derniers de sa génération. Monture fixe attachée au boitier. 1980. Je pense à lui avant de me coucher. Aux potentialités de la machine. Je me tourne et me retourne. Jessica s’est endormie à 22h30, comme quand elle se lève pour amener Anatole à l’école. Je viens de traverser trois semaines de travail intense et j’ai besoin de compenser avec des projets artistiques. Du coup je dors peu. Je me tourne et me retourne. J’ai commencé une série d’albums de famille ou je mélange les photos de mon intimité et ce qui nous entoure. Rue, village, café, lieux de passages ou de court séjours. Le tome 7 réunit des photos de notre week-end avec un couple d’amis au mont Saint-Michel. Suivent des photos d’un tournage entre Angoulême, Saintes, Bordeaux et La Rochelle, mon pote Jérémy et sa fille, puis les retrouvailles avec Jessica, notre quartier, la chambre Plaubel en réparation, le travail, la garde républicaine, Anatole dans la forêt en banlieue, Anatole à Paris, Anatole qui joue à l’arc et tire sur le pigeons, aux petites voitures, et moi qui colle mes photos jusqu’à pas d’heures parce que je sais que le lendemain je vais devoir faire des dessins pour : Gallimard, Le Monde, un hôtel de luxe, un magazine japonais, et que sais-je encore. J’achète le dernier Elroy, vais manger chez Burger King, visite un appartement avec Jessica qui rêve de déménager et monte une boîte de prod avec sa copine Vanessa : « et si on te produisait Artus » ? Et si j’avais du temps. Plus de temps. Le frère de Jessica s’ennuie dans notre canapé. Jessica s’y endort dans la journée, épuisée de gérer seule Ana qui me manque et pourtant j’essaye d’être là, vraiment là quand je suis là. Un autre Jeremy regarde mes albums de famille. Il me dit, à la fois distrait et intéressé, que je continue de faire « toujours plus où moins la même chose que tu as toujours fait ». Mais peut-être avec plus de moyens. Parfois je me demande si cela vaut le sacrifice du temps. Temps passé à ne rien faire, à lire, à skater. Mon sac est rempli de boîtiers, un pour chaque projet. Le Contax, le Leica, la Makina Plaubel avec laquelle je fais toutes ces photos en noir & blanc. Ne jamais lâcher, rien, jamais. Daniele qui ne paye plus son loyer depuis des mois et continue de photographier son quotidien, entre Négatif + et le café Saint Gervais où il a ses habitudes. Que deviendront toutes ces photos dans quelques années ? Anatole prend son petit déjeuner et moi aussi, avec Jessica, « comme tous les matins (ou presque) depuis que nous nous sommes rencontrés ». L’entrecôte et les pommes rissolées de l’Escale, au coin de la rue des deux ponts, un centre d’art contemporain désert ou presque, la route, ATAC, ma « petite sœur », fille de la femme de mon beau-père, et ses deux enfants. Comment les appeler ? Tu vois Anatole c’est un peu comme mon papa mais pas vraiment et Camille et Gabriel sont un peu tes cousins mais pas vraiment non plus… Et Jessica d’ajouter : « -Mais alors tu es son beau-père ou pas ? » à Louis, qui, comme moi, ne sait pas ou se mettre, pudeur, amour, histoire familiale « compliquée », depuis qu’il a refait sa vie et mes parents, mère, père, belle-mère, grands-mères, grands-pères, tous décédés, sauf lui. « – Non, je ne suis pas son père ». Je me tourne et me retourne ; racines. « Albums de famille », parce que je n’en ai pas ou plus. Lieux habités où non. Chambre d’hôte, rivière, un musée d’art brut particulièrement glauque. « -Eux non plus, ils n’ont jamais rien lâché », me dit Jessica du bout des lèvres. Je sais, je sais. Mais je ne suis pas eux et eux pas moi, je suis « connecté ». Un pote me dit : « Surtout n’arrête pas la pub, tant que ça marche, ça paye le reste. Et puis, je trouve ta position admirable. Il faut tenir ! ». Coûte que coûte. La fatigue. L’impossibilité d’arrêter. L’idée de l’art posthume, « contre toute tentative spectaculaire visant à une reconnaissance factice de son vivant ». Nourri au situationnisme. Et si j’ouvrais un compte Instagram, j’aurais combien de followers. Et Jessica qui ne lâche plus jamais son téléphone. Où trouver le temps. Ce temps qui me manque si cruellement. Parents. Tout concilier même si l’on sait que c’est impossible. Premières photos au Blad, donc. Dois-je changer de cahier ? Comment tirer les photos ? Au format original carré ou en 4,5X6. Quel grain ? Et quelle équivalence en 24X36 ? 21mm ? 24mm ? C’est marrant que ma vision soit de plus en plus déformée, ou proche, tout dépend de l’analyse ; à part que cette optique là ne déforme pas lorsque l’on respecte le niveau – que je ne regarde jamais. La seine, les clochards, « votez » (pour qui ?), Jessica prend son vélo pour aller travailler et moi mon skate. Et puis cet autoportrait, dans l’ascenseur du 14, rue des deux ponts. Il faudrait que j’écrive une introduction pour ma prochaine expo, mais je n’arrive pas encore à trouver de titre. Albums de famille in situ ? Environnements ? Quotidien ? Quotidiens ? Apparence et réalité ? Photographies de famille ? Intérieur / extérieur ? Comment témoigner encore et encore de cette certitude qui m’habite. Est-il trop tôt. De toute façon, lorsqu’une œuvre est mûre, tout arrive tout seul. La photographie est un art tellement exigent. C’est vrai que je me suis presque toujours baladé avec un appareil photo à portée de main. Comme tout le monde ? Justement !
03/06/15
I.
« Les albums de famille » s’accumulent sur mon bureau. Bientôt huit tomes de photographies de notre quotidien y avoisinent des photos ce qui nous entoure. Paysages urbains, lieux de vies, endroits où nous avons nos habitudes ou où nous ne faisons que passer. Alors que Jessica et Anatole dorment, je descend au café du coin réfléchir à ces images. Pourquoi m’émeuvent-elles autant, et surtout pourquoi ne puis-je m’empêcher de les percevoir comme de l’art, une façon de résister à « l’art contemporain ». Il y a dans ces moments simples de vie, dans ces paysages, dans notre intimité partagée, une volonté réelle de parler de Beauté. « Ce qu’est l’art » de Danto (l’écrivain de « La transfiguration du banal »), revient sur les fondements de l’histoire qui régit les différents mouvements artistiques et artistes qui la composent. Picasso, Duchamp et Warhol, en sont les héros. Les Demoiselles d’Avignon s’y opposent à la photographie naissante. L’apparence à la réalité. « Moi je veux peindre la vérité, pas la réalité » aurait-dit Picasso. Je pense à Malevich, à la fin de la représentation et à la mort de l’art « pour qu’enfin vive l’Homme ». À Debord. À cette histoire alternative qui existe en marge de toute histoire officielle. Aujourd’hui, j’ai photographié mes appareils photos, puis les différents livres qui m’ont marqué, pour finir par ces « Albums de famille » qui m’obsèdent en ce moment. Mon nouveau projet artistique. Les années où je remplissais des cahiers entiers de ces mots : « si l’art c’est la vie alors rien n’empêche plus la vie d’être considérée comme de l’art, et vice-versa ». Fondements. Résistance à un marché élitiste. Caractère invendable d’une photo intime. De la banalité d’un lieu. Archivage de vécu. Art posthume.
J’ai découvert récemment que je me fichais complètement que mes photos soient recadrées, car, « finalement, cela ne changeait rien ». Jessica m’a dit ce soir que ce n’était pas étonnant, « car j’étais très frontal », « comme un photo-journaliste ». « Tu prends en photo ce qu’il y a devant toi, comme tu l’as vu ». L’objet compte plus que la précision du cadrage ou du tirage. Je me fiche des tirages, c’est vrai. Même si, un jour, j’adorerais aussi que mes photos soient perçues comme des photos de photographe et pas d’artiste. Cette contradiction-là. Par objet, j’entends le livre, le cadre, ou le contexte dans lequel les photos sont montrées ; mais j’aimerais aussi qu’on puisse comprendre ce qui les sous-tend sans cela. Quand mes proches ne voient dans ces albums que des photos de famille, je me dis que j’ai perdu. « Tu en mets trop Artus », me dit-on souvent, « jusqu’à la nausée ». Les bonnes photos, les mauvaises. C’est justement parce que j’en mets trop que je pense que cela dépasse de loin le cadre de la simple photographie de famille. Mais comment l’expliquer ? Le « prouver ». Comme si le seul critère de jugement n’était que l’affirmation d’une volonté de raconter une histoire qui se joue au delà des photos, ou au delà de leur choix. Jessica voit cette œuvre s’étaler devant ses yeux à chaque heure de sa vie. Entre mes constants allers-retours au labo et l’assemblage de ces livres. Toujours plus ou moins en décalage, à la fois dedans et en dehors. Passionné. Pourquoi ne pas choisir le support film si la réalité m’intéresse tant que cela ? Je dis être contre Instagram et Facebook, alors que je fais exactement la même chose, mais pas de la même manière. Mes « instantanés » n’ont rien d’instantanés. Je veux figer des moments, partager un regard dans son ensemble. Décaler le temps de la lecture. Je rêve ainsi d’une œuvre complète qui se révèlerait d’elle-même. « – Ah, c’est donc ça qu’il cherchait ». Et Jessica et Anatole qui se trouvent malgré eux mêlés à cela…
Et si une logique plus grande guidait l’humanité (et me guidait) dans cet archivage constant et immédiat qui semble être le fait de tous aujourd’hui. La fin de l’homme tel que nous le connaissons. La nécessité de tout archiver pour mieux s’auto-archiver. Guidés par des algorithmes tout puissants. Guidés par le capitalisme. L’ère de la fusion de l’homme avec les machines qu’il a crée dans l’unique but de se survivre. Tout prévoir et tout recenser pour mieux enfermer l’humanité en elle-même. Jusqu’à l’extinction ou à la renaissance ; en passant par la nausée. Ce moment où « notre » histoire remplacera l’Histoire en se servant de termes comme ceux d’art (art de vie, art de manger, de s’habiller, art contemporain, art du présent…), ou de culture (culture hip-hop, culture skate, culture techno, cultures urbaines…) pour définir des pans entiers d’une réalité qui, dès lors ne sera plus qu’apparence et éternel quotidien. Impliquant une désactivation du jugement et du regard éternellement changeant que l’on peut, et doit, porter sur soi-même, dans la durée, tout en le confrontant à une forme d’immuabilité acceptée comme telle.
Je préfère croire aux artistes plus qu’à leur pouvoir.
05/06/15
Depuis que je le connais Artus de Lavilléon archive sa vie, sous forme de petits livres auto édités rarement tirés à plus d’un exemplaire. En partie élevé avec la méthode Freinet, début 70, il a appris très jeune à tenir des journaux et documenter ses différentes promenades afin de partager les connaissances acquises avec, au début d’autres élèves, puis très vite avec ses amis proches – pour finalement diffuser son travail de manière plus large sur internet. Ce qui est intéressant dans ce projet-ci, c’est qu’il n’était à l’origine pas fait pour être montré (quoi que ses projets de soient tous) immédiatement, dans le mouvement de la réalisations des 7 albums dont ce livre est une compilation. Lassé de la numérisation intégrale de ses archives (un travail encore en cours) pour en partager le contenu via son site internet en téléchargement libre, Artus à voulu revenir vers une pratique plus simple et manuelle. A savoir le collage presque quotidien de tirages Argentiques dans des cahiers noirs Canson de format 36,5 x 27 cm. Le choix du papier brillant bon marché contrastant l’utilisation de deux chambres moyen format Plaubel (régulièrement en panne ou/et imposant une contrainte de lenteur dans la prise de vue et le choix des sujets). Comme dans « personne et personne », le projet de livre précédent Artus à choisi de se concentrer sur les lieux de vies et de passage, souvent déserts, et son intimité proche. Créant la aussi une confrontation de deux univers dont la coexistence familière forme le quotidien de tout à chacun.
Les introductions ainsi que l’ordre chronologique de prise de vue ont été conservés afin de respecter au plus près l’intention d’Artus de témoigner d’un vécu au moment où il se passe, alternant les bonnes et les mauvaises images, la beauté et la banalité, « comme dans la vraie vie ». Ainsi le choix des images a-t-il imposé une exigence tout autre que celle de l’editing habituel car il n’est pas ici question de prouver quoi que ce soit mais plutôt de montrer une diversite et une absence de choix volontaire centre sur l’humain et l’intensite des moments partages plutôt que sur la seule qualité photographique. La décision d’utuliser le moyen format pour capturer ces moments de vraie vie paraît elle aussi antinomique : le peu de vues par bobine, l’impossibilite de toute spontanéité reele, le coût, sont comme autant de contrainte visant à lutter contre l’estthetique aseptisée du numérique sans pour autant lui sacrifier le grain ni la qualité technique. L’usage de la Plaubel Makna en faible lumière augmentant aussi proportionnellement les possibilités de flou de bougé ou de netteté tout en imposant un rythme différent, poussent ainsi à se demander ce qui compte vraiment. En marge de tout procédé photographique.
L’art ou la vie
07/06/15
Je me suis toujours interdit de prendre en photo des gens que je ne connaissais pas et à chaque fois que je regarde des livres de street photography je pense à la sincérité d’un regard en mouvement (et donc superficiel ) opposée à la vérité d’images de choses et de gens que l’on connait vraiment…
09/09/15
D’aussi loin que je me souvienne Artus m’a toujours parlé du projet de La Chambre. Je ne sais pas trop quand il a commencé à tout garder pour la postérité (il ne parlait pas encore à l’époque d‘Art Posthume) mais je sais qu’il travaillait sur les faire-valoir et sur une mise en abîme du travail des critiques d’art dans les diverses monographies qu’il pouvait lire. Il y avait déjà ce rapport au livre et cette idée de résistance qui est présente dans toute son œuvre. Une certaine confusion aussi. Presque toutes ces phrases commençaient par « si l’art c’est la vie, alors… », et finissaient par « il est temps de tirer les leçons de l’histoire ». Tout ce qui avait trait au Dadaïsme, au Suprématisme, comme au Situationnisme, à une forme de refus révolutionnaire du système, le passionnait. Ses étagères étaient déjà littéralement surchargées de livres, littérature classique, science fiction, philosophie, art, comprenant des textes de Malevitch, Soulages, Duchamp, Les mémoires de Tapiès, Le Mythe de Sisyphe de Camus, Le Zarathoustra de Nietzche, Derrida, Deleuze, Philip K Dick, Cendrars, Miller… jusqu’à L’histoire de l’art contemporain de Catherine Millet ou il avait puisé cette phrase qui l’intéressait tout particulièrement : « La tendance est aujourd’hui à une implication dans le système de diffusion, à une prise en charge d’un certain nombre de ses fonctions pour mieux les exagérer ou les entraîner dans leur propre parodie »... l’idée même qu’un critique puisse se pencher sur le travail d’un artiste et se l’approprier le révoltant au plus haut point puisque ne l’intéressaient que les textes originaux.
Nous écoutions Sonic Youth ou les Pixies affalé sur un matelas posé à même le sol alors qu’il nous projetait des images de sa vie passée et nous racontais une énième fois sa rupture avec son ex femme, ses aventures de skateboarder, ou même l’amitié de sa mère avec Guy Debord avant sa naissance, l’influence sur son éducation, la vie en Inde puis dans des communautés avant la pension catholique avec son père ou ses années roller. Puis il déviait encore sur les liens qui lient toutes les avant-gardes. De Schwitters au Lettrisme jusqu’au graffiti en passant par le détournement punk et la Factory, « seule œuvre valable de Warhol » selon lui, puis il nous mettait une cassette des Velvet Underground ou même des Violent Femmes… Tout se mélangeait dans nos têtes d’ados. Nous étions plus jeunes que lui d’1 à 5 ans, voir 8 ou 9, et n’avions pour la plupart aucune culture artistique. Une bande de paumés rencontrés au hasard de ses après-midis passés à la Fontaine des Innocents où il aimait particulièrement perdre son temps. Je crois avoir croisé ou entendu parler, dans le petit appartement de 12m2 de la rue Portefoin, de toute une foule de créateurs, artistes, graphistes, designers, photographes, journalistes, skateurs, mannequins, qui allaient marquer la fin du XXeme siècle et le début du XXIème. Ramdane Touhami avec qui il allait monter l’épicerie, Ora-ïto, Zevs, Space-Invader, JR, Thierry Théolier, Jeremy Scott, Camellia Claus, Carole Naville, Jennyfer Eymère, Olivier Zahm, le futur collectif Ill-Studio, Jamie Thomas, Benjamin Deberdt, Cyprien Gaillard, Baptiste Debombourg, et presque tous les artistes liés à la galerie Patricia Dorfmann avec laquelle il travaillerait plus tard…
Je crois que le projet de La Chambre, l’idée de figer pour l’éternité un vécu, non pas uniquement sous forme d’œuvre, mais entouré de toutes les preuves d’humanité dont l’œuvre est indissociable, est né d’une conversation avec son ex-femme Veronica. Au début, il s’agissait de tout garder pour désamorcer toute tentative posthume de tri, car dans son esprit si l’œuvre peut exister seule, elle est indissociable du vécu dont elle est issue. En gardant les traces, d’une évolution spatiale et temporelle (les marqueurs d’une époque), le contexte de réalisation de l’œuvre, il devient difficile d’imaginer un discours totalement déconnecté de la réalité quotidienne de l’artiste. Ainsi, une bibliothèque, pinacothèque, des vêtements, des tickets de commerces, packagings et rebus divers, objets usuels, participent autant à l’élaboration de l’œuvre que des lettres tirés d’une correspondance intime ou des amitiés connues sur lesquelles il est plus facile de communiquer. D’une certaine manière, on peut dire que ce qui a toujours intéressé Artus a beaucoup à voir avec les ratures qui ont établi sa carrière de dessinateur.
Au moment où j’cris ces mots, je réalise que je commets l’acte contre lequel Artus s’est battu toute sa vie d’artiste. En expliquant, je justifie une création (et à travers elle une existence), dont l’un des plus grands mérites est justement d’empêcher cette réduction, puisque dans la réalité quotidienne dont Artus a fait le fondement même de son œuvre, la décision de tout stocker est certainement née progressivement à une époque où Artus ne savait pas encore ce qui compterait plus tard, et c’est ce doute, vraisemblablement, ainsi que la volonté de créer un univers (et c’est la que cela devient compliqué compte tenu des références qu’Artus a toujours revendiqué – Le Merzbau de Schwitter ou l’exposition zero dix de Malevitch), qui est lui-même à l’origine d’une discussion dont finalement je ne sais rien.
21/09/15
Archives du présent.
Depuis quelque temps, je suis littéralement obsédé par la photographie. Livres, photographes, essais critiques, mémoires, appareils photos, technique… Comme si je cherchais une échappatoire au monde de l’art dans une pratique qui me paraît imposer une forme d’humilité. En même temps ne m’intéressent que les photographes qui dépassent leur état de photographe pour être considérés comme des artistes. Où, pour être plus exact comme des grands photographes, et donc, peut-être, justement pas comme des artistes.
Que veut dire être artiste aujourd’hui ? Quel engagement cela représente-t-il ? Dans le relationnel surtout. Et photographe. Encore cette extrême confusion. Tout se mélange à loisir dans ma tête. Il est encore trop tôt.
Un ami me disait que je ne produisais plus rien de valable dans le sens de l’exposition : « C’est la vitrine qui dirige le magasin ». Que dire face à cela ? Que j’ai « produit », près de 150 livres en moins de trois ans, que j’ai avancé sur différents projets artistiques, crée un site internet, mais c’est vrai, peu diffusé ce travail, que ce soit à travers une galerie, les réseaux sociaux, ou même le bouche à oreilles.
Dans le manifeste de l’art posthume nous écrivions il y a quelques années « être invisible est la seule alternative pour lutter contre l’art contemporain ». Comment expliquer autrement ma lassitude face à l’omniprésence de l’art contemporain dont toutes les qualités subversives ont été désamorcées par l’immédiateté du système de reconnaissance institutionnel, et par la volonté des artistes de s’inscrire dans cette logique.
Se retirer du réseau.
Dessiner pour gagner en liberté.
Nan Goldin, Eggleston, Stephen Shore, Friedlander.
Leica M6, Contax G2, Chambre Ebony RW45, Makina Plaubel, Hasselblad SWC/M.
Du 35mm au grand puis au moyen format. Du grand angle à l’extra angulaire. Se rapprocher en essayant de déformer le moins possible. Rester droit. Enlever le bruit. Photographier ma famille et mon environnement proche. Dans notre environnement proche. Archiver mon quotidien, témoigner d’un vécu. « Si l’art c’est la vie alors… »
Sur ma table de chevet, toujours les mêmes livres, les mêmes sujets. Malevitch et le monde sans objet. Debord et le situationnisme. Dick et les nouvelles Technologies. Le mythe de la contre-culture. Quelques Pleiades en plus, de rares éditions au Mercure de France… Et quelques Best-sellers (terme qui a rapidement remplacé celui de littérature contemporaine), plus ou moins choisis en tête de gondole à la FNAC comme dans les bonnes ou moins bonnes librairies.
Mes deux dernières peintures « Prepare you for succes », et « Polluted debate (They’re fun, they’re hystory, they’re America) », grandes reproductions d’œuvres produites en 1995, sont restées dans la cave de ma galeriste, retirés de ma dernière exposition pout incompatibilité totale avec le reste de mon travail.
Chaque jour je pense en me réveillant aux films positifs et négatifs qui m’attendent au labo, aux photos que je pourrais faire, à l’histoire que je pourrais raconter, au livre en cours, à l’appareil photo moyen-format qui m’attend dans mon sac, bien trop lourd pour mon dos fragile. Bizarrement nulle envie de démarcher pour diffuser ce travail, quoique que je ressente souvent le besoin de le montrer à de réelles personnes, face à face, de façon à créer un échange, ou une admiration qui me soigne de mon mal être face au marché de l’art contemporain. Car, quoique je dise ou pense, ou face semblant de penser, c’est bien là ce qui me gène le plus. Foison de littératures à ce sujet, positions intenables. Rentrer dans une galerie pour (avoir le droit de) questionner le système, n’en avoir rien à foute du système, s’inscrire dans un autre système, se détacher de tout cela. De toutes ces « postures », et justification hors-temps ou hors-œuvre.
– Tu devrais ouvrir un compte Instagram, me disent en cœur JR, Jessica, et la plupart de mes amis.
– Tu devrais organiser des visites de ta chambre et créer des soirées où tu montrerais tes livres, si vraiment tu ne veux plus passer par les galeries rajoute Jessica.
Peut-être.
Mais comment dire qu’après toutes ces années à avoir été « prêt », je ne le suis plus.
Je ne dirais pas non plus que c’est une période de doute, ou de remise en question, ou d’extrème lassitude (quoi que), mais plutôt de concentration intense. Créer une œuvre. Combler les trous. Faire en sorte que l’édifice tienne debout tout seul. Ne plus avoir rien à justifier, à ajouter, à dire…
Je regarde les photos de Lee Friedlander, toutes ces photos admirables, et puis, un jour, Friedlander rencontre (je ne l’imagine que comme une rencontre) l’objectif 38mm du Hasselblad Super Wide (équivalent d’un 21mm en 24X36). Sa vision s’impose alors dans toute sa force, elle devient non seulement compréhensible mais évidente. Son intermédiaire n’est pas une personne, ou un lieu, mais un instrument. Est-ce cela que je cherche ? Un « moyen » ? Tous ces livres que j’auto-édite, mais ne montre pas encore vraiment. Le projet de la chambre… Les trois premiers exemplaires des Deadpans (Pince sans rire) qui ont lancé ma carrière de dessinateur, imprimés à 12 exemplaires et distribués main à la main, au petit bonheur la chance…
Marcher pour réfléchir. Photographier pour trouver du temps alors que cela me prend tout mon temps.
Montrer mon travail régulièrement à mes proches. Imposer la durée comme seul critère valable de sélection.
En 2012, une amie m’a dit : « Mais tu es photographe Artus », un autre pense que je suis peintre. On me parle souvent de mes textes (quoique je n’écrire presque plus en ce moment)…
Je ne sais absolument pas quoi penser de tout cela, sauf cette phrase qui tourne en rond dans ma tête :
« En ce moment, je suis littéralement obsédé par la photographie, les livres, les photographes, les appareils photos… ».
Que dire d’autre, c’est vrai ?
Ah… Oui… Je suis aussi en train de faire un long métrage, tandis que Jessica monte sa boite de production et qu’Ana grandit, et de continuer de mettre de l’ordre dans mes archives, quelles qu’elles soient, y compris celles du présent…
23/09/15
Alors que je m’apprête à vendre la maison, je décide, entre deux cartons, de photographier une dernière fois Ernée, ses lotissements, et son centre-ville.
En dix ans, j’ai assisté à l’abandon progressif du bourg au profit de « banlieues résidentielles » et d’une batterie de supermarchés habillements déservis par de nombreux ronds points à l’utilité contestable.
Ces photographies, faites les premiers jours en poussette avec mon fils Anatole, puis lors de notre dernière balade avec Jessica, et enfin seul, quelques minutes avant de rendre les clefs, ne témoignent pas de la réalité exacte de cette petite ville, mais plus de mon intérêt pour la lumière sur les façades des maisons neuves que sur les bâtiments historiques et culturels indiquant une histoire dont l’apogée économique était derrière elle.
Ainsi malgré la colline dédié au sculpteur Louis Derbré ou la magnifique chapelle du XXII siècle sur la nationale N12 dite « route de Paris » (en réalité en direction de Mayenne), c’est sans doute vers ces bâtiments, qui formèrent mon quotidien et l’essentiel de mes balades entre 2003 et 2015, que se tourneront mes souvenirs.
Ici, étrangement, je n’ai pas fait de photos de mon bar préféré, du cinéma, ni des charmants épiciers et boulangers du centre-ville, qui pourtant luttent encore contre la fermeture – comme avant eux le libraire, le boucher, charcutier, horloger, bijoutier, maraîcher, poissonnier, chapelier, pharmacien, (…), au profit des pompes funèbres, kebab, pizzas, magasin de vêtements et chaussures, et des fameux supermarchés, magasin de bricolage, informatique, et autres accessoires de chasse et pêche aux changements de propriétaire réguliers, souvent plus proche de la nationale.
Préférant sans doute les préserver dans ma mémoire, comme des endroits encore vivants, dans la durée.
26/09/15
Ordonner les photos chronologiquement est une vraie prise de tête. Comment faire un livre qui ait du sens, respecte notre vécu tout en le replaçant dans son contexte. Henri miller dirait sans doute que la meilleure façon d’être vrai c’est de mentir… en fait il ne le dirait absolument pas comme ça mais plus…
Arranger la réalité pour faire passer notre « message » ou simplement essayer de partager son quotidien. La différence 3ntre un livre de photographies et un livre de photographies de famille. Friedlander parle de familly in thé pictures. En faisait de nombreux allers retours au laboratoire avec ses délais différents pour le nb et la couleur j’ai un peu perdu le fil de la chronologie. Ce fil qui est si important pour moi. Bouger les photos d’une ou deux pages, pas plus, est ce déjà beaucoup tricher et surtout qu’elle importance.
Pour la première fois je réalise plusieurs livres à la fois. Je jongles avec les dos argentiques hasselblad et plusieurs series en même temps. Noir et blanc, couleur, paysages, portraits, photo d’architecture, d’intérieurs. .. avec la même exigence de qualité spontanée, sans jamais rien retoucher ou déplacer a de rares exceptions pret. Comme pourrait dire leautaud que je découvre dans la bibliothèque de mon père ce n’est pas la réalité qui m’intéresse mais ma réalité. La seule qui me semble objective finalement.
J’hésite à renommer ces derniers albums photos de vacances mais ce serait les sortir de ce qui m’intéresse. Le quotidien dans sa banalité car même en vacances c’est surtout ce qui est le plus proche de mou qui l’intéresse. Mon fils ma femme mes amis les proches. Et puis régulièrement je fais le tour du pâté de maison du lotissement ou de la maison Ou nous restons quelques heures ou quelques jours. Quelques photos aussi prises sur la route entre un endroit où jn autre par la fenêtre de la voiture ou du train… pourquoi dépenses tu autant d’argent sur tes photos alors que cela ne ré rapporte rien? Pourquoi n’essaye tu pas de faire une sélection plus pointue. Tu devrais faire quelque chose de toutes ces images Artus. Aujourd’hui on n’a plus le temps de prendre le temps. Comment expliquer sans avoir l’air prétentieux que j’essaye de mettre en place une oeuvre qui se lise dans sa globalité plus que dans son détail. Comme un peintre finalement. Pourtant mes photos n’ont rien de picturales si je devais les définir je dirais factuelles. Nous avons été ici. Nous avons fait ça. .. comme tout le monde nous sommes partis en vacances nous sommes revenus et c’est la même réalité qui nous a entouré. .. à part que chaque réalité est unique, même dans sa plus grande banalité.
Et Jessica de conclure : » Ce que tu essayes de dire c’est que les gens sont toujours impressionnés par ce qui est semble inaccessible comme la célébrité ou ce qui est montré dans les musées en oubliant d’être émerveillés par leur quotidien ».
05/10/15
Les photographies de vacances s’accumulent comme autant de preuves d’un quotidien d’une banalité exemplaire. Piscine, amis, parents, dans des paysages quelconques qui, malgré leur beauté, dans ce contexte, n’évoquent pas grand chose. La route defile nous amenant d’un point à un autre en traversant la Provence, puis le lot, avec un court arrêt à Nîmes pour couper le voyage en deux.
Jessica me dit : peut être que ta force c’est la quantité après tout. Succession de moments partagés. Et dire que je suis en train d’arrêter de faire de l’art pour faire ça… et de la pub aussi, vaguement, avec mes dessins.
Bizarrement je photographie peu. Presque toujours frontalement, sans vraiment reflechir. En ré regardant ces images je trouve tout plus ou moins plat. Sauf les scènes de voiture, les plus intimes, celles où nous parlons de tout et de rien sans réellement écouter la radio ou rien creuser en profondeur. Jessica allongée sur le lit qui regarde son téléphone, à peine dérangée par mon pied photo et moi qui lit dans les toilettes quand elle s’est endormie . Anatole qui joue avec les enfants d’Aleksi, ses parents, leur piscine et leur belle maison. Laconique. Nous sommes en transit.
Mais c’est vrai, pourquoi mets – je autant d’énergie dans ce projet ? Plus les livres s’accumulent plus j’y vois une forme de résistance au « spectaculaire ». Les bonheurs sont simples, pas bruyants. Un détour à travers des champs que je ne prend pas le temps de photographier, la vitre sale que nous ne nettoyons pas, Anatole qui essaye de comprendre un dessin animé. Et puis les rires sur une aire d’autoroute. Un camionneur regarde dans la direction d’une ligne haute tension. Bientôt nous serons arrivés. Bientôt.
06/10/15
« À nouveau, la vie de l’art est enclose dans des cadres officiels.
À nouveau, c’est le triomphe des pourchasseurs de l’art !
À nouveau, ce sont les mêmes personnages qui sont à table.
À nouveau les défunts tendent leurs mains osseuses vers le flambeau et veulent l’éteindre.
Mais cela ne doit pas être !
Ôtez-vous du chemin, bourreaux de l’art ! Podagres, votre place est au cimetière.
Ouste ! Vous qui avez envoyé l’art dans les caves. Lace aux forces nouvelles !
Nous les novateurs, nous sommes appelés par la vie aujourd’hui pour ouvrir les geôles et faire sortir les détenus ».
Malévitch, Les tâches de l’art et le rôle des étouffeurs de l’art, 1918.
06/10/15
« C’est vrai, on a réussi à faire échouer le sabotage des artistes.
Et maintenant le tapage autour de l’art est terminé.
Et puis, qu’est-ce que l’art au fait ?
À qui est-il nécessaire ? Maintenant il faut agir, il ne faut pas des conseils d’artistes.
Et voilà que sur le champ de l’art s’est installé et trône la baguette morte. Elle a besoin de bureaux et d’« affaires ».
Il y a un secrétaire, puis un autre ; il y a des cabinets, il y a des tables vertes, des divans ; il y a des scribes, des suisses ; les affaires s’accumulent, la machine à écrire tape et l’homme sérieux s’affaire à huis-clos.
Il y a de tout. Seulement où sont les artistes, Où est l’art ? ».
Malévtch, La baguette morte, 1918.
« Et ceux qui sont vivants vivent ce qui est déjà vécu ».
Malévitch, Aux officiels de l’art, 1918.
« Il fallait une force énorme de volonté pour détruire toutes les règles et arracher la peau devenue grossière de l’âme de l’académisme et cracher au visage du bon sens ».
Malévitch, Du Cubisme au Suprématisme, Le nouveau réalisme pictural, 1915
« L’œuvre artistique suprême est écrite quand l’intellect est absent ».
Malévitch, Les vices secrets des académiciens, 1916.
« Mais nous forgerons notre visage dans notre temps et nos formes, nous formerons le temps, mettrons le sceau de notre visage et le laisserons dans le torrent des siècles, où il sera reconnu ».
Malévitch, Pour une nouvelle face, 1918.
09/10/15
Le problème c’est que j’arrive à un moment où je ne peux plus faire demi tour.
Depuis que j’ai réalisé qu’exposer en galerie ne m’intéressait plus, aussi bonne la galerie soit elle, et que je me suis progressivement retiré du marché, une sorte de lassitude m’a envahi. Mais c’est un cul de sac.
Je relis Malevitch, cherchant dans des textes qui sont à l’origine de ma vocation d’artiste une réponse à mon mal être présent, qui a tout à voir avec le « marché de l’art » et rien avec ma vie de famille qui est florissante et joyeuse. Je déteste devoir me justifier.
Alors j’archive compulsivement ma vie sous forme de livres, croyant affirmer une forme de résistance par l’intime.
Quand il s’agirait de faire connaître ma position, et de la diffuser, je me noie dans un travail que je garde devers moi, ne diffusant plus rien et tenant une position en marge des réseaux sociaux soi-disant devenus incontournables, et pourtant responsables non pas de la croissance des possibles, mais de l’augmentation d’un mercantilisme policé appliqué à tous les domaines de la vie.
Ce qui ne demande aucun effort est aussi vite oublié que consommé. L’industrie du culturel, du loisir, du spectacle, de la technique, ou quelque soit le nom que l’on choisisse de lui donner, ne permet plus d’être respecté pour des positions souvent jugées obsolètes par une nouvelle génération qui ne cherche plus des nouvelles manière de contourner un système incontestable et tout puissant, mais plutôt des façons de « faire avec ».
Je cherche une issue qui ne soi pas qu’une nouvelle soumission déguisée.
Travailler seul est difficile car le besoin de partager qui m’habite est, lui, toujours aussi présent.
Comment montrer une œuvre sans passer par la phase de production qui attesterait de sa côte et la prouverait aux yeux de tous.
Comment dire que je ne crois plus au combat de l’intérieur ?
Sur France Inter, ou culture – je ne sais plus – différents commissaires d’exposition parlaient de la valeur du refus, de l’importance d’artistes qui se retirent du système, sans proposer aucune autre solution que celle, dans ce même système, de montrer leur retrait, de le monnayer, de lui donner une valeur muséale qui la justifie aux yeux de tous, faute d’avoir été comprise sans ce filtre.
Combien d’artistes travaillent aujourd’hui en marge de tout système et « produisent » « dans leur grenier », une forme d’art qu’ils ne savent pas – ou n’ont pas – envie de vendre, se méfiant des blogs et autres sites internet dont l’utilité, si elle ne leur semble pas contestable, leur apparaît comme ennemie d’une rareté qu’il défendent à la hauteur de leur investissement dans la construction d’une œuvre réelle, non d’une image.
C’est certainement dans la confusion entre les termes de vente et de partage, d’image et de réalité, que se niche le plus grand préjudice porté aux artistes aujourd’hui. Un bon artiste est un artiste qui vend, non un artiste qui travaille lentement et surement à établir une pratique dans le temps. Seule manière, finalement, de juger une œuvre, et pas de l’image que l’on se fait de l’artiste qui la porte, telle qu’elle est relayée dans les medias – réseaux sociaux compris, qui ne parlent finalement que d’immédiateté.
Cette immédiateté aveugle sourde et amnésique, qui s’étend maintenant à l’infini faisant de la réalité un éternel temps présent en constante mutation, ignorante de son passé comme de son futur, aussi sûre d’elle-même que certaine d’avoir abdiqué pour le meilleur son pouvoir décisionnaire à la masse toute puissante. Celle qui ne se trompe jamais.
11/10/15
« Rivé à lui même par l’égoïsme, l’individu n’apparaît plus que comme une quantité négligeable, soumises à la loi des grands nombres; on ne saurait l’employer que par masses, grâce à la connaissance des lois qui le régissent. Ainsi le progrès n’est plus dans l’homme, il est dans la technique, dans le perfectionnement des méthodes capables de permettre une utilisation chaque jour plus efficace du matériel humain ». (De qui, mal noté, ref perdue)
En lisant la biographie de walker Evans je réalise comme le photographe est à la fois proche de l’artiste et de l’écrivain. Comme l’artiste il poursuit un but qui le dépasse souvent et suit une logique qui, même dans ses commandes commerciales laisse transparaître son identité. Comme l’écrivain son oeuvre se limite souvent à deux ou trois livres tout au plus qui témoignent d’un regard sur le monde, d’une pensée, et parfois d’une vision dans laquelle on se reconnaît parfois. Ce regard peut glisser à la surface des choses ou être engagé, ce qui ne change rien à la force d’identification que porte en soi tout travail abouti. Comme le peintre le photographe est à la recherche de quelque chose qui est à la fois en lui et hors lui et auquel il doit donner forme. Mais il doit faire avec la realité telle qu’il la perçoit et la retransmet. Nulle création si ce n’est celle de l’univers qui est le sien et auquel il nous convié. Comment entrer dans une photographie sachant cela?
25/01/16
Et tout d’un coup, le quotidien se met à peser son poids. On se retourne dans son lit à la recherche d’un sens qui nous échappe encore. Comment passer « d’avoir toujours été prêt » à « faire arriver les choses », surtout quand on croit au travail comme seule force motrice. J’ai toujours détesté le relationnel, et un ami me disait souvent que mon travail consistait surtout à « m’ajouter du vécu », et à en témoigner. Mes premiers dessins sont nés de la vie que je menais « à l’époque », dans un milieu en marge de « la normalité », c’est ce qui a fait leur succès. Un succès immédiat et inattendu qui a changé durablement mon existence. Je me suis mis à gagner de l’argent, je suis devenu père, et la femme avec qui je partage ma vie, Jessica, m’a permit de cesser d’être dans un mouvement qui paraissait désordonné alors que je ne l’ai jamais considéré comme tel. Je crois en la durée, même si celle-ci peut parfois sembler longue dans un monde ou « ce qui se passe en temps réel prend trop de temps », plutôt que dans un monde où la perte de temps pouvait encore être considérée comme liberté absolue. (« Perdre son temps est aujourd’hui la seule manière d’être libre », Blaise Cendrars cité dans le manifeste de l’art posthume opposé au dernier best seller en date : « Seuls ensemble. De plus en plus de technologies de moins en moins de relations humaines »). « Mon » avocat me disait dernièrement que je continuais de n’avoir aucun filtre, mais je ne sais pas s’il pensait que c’était ma force ou au contraire mon handicap. Le besoin de partager tout, et tout le temps, quand il faudrait être un peu en retrait et monter une subtile arrogance faite d’opportunisme et de talent. Je ne suis pas comme ça. Je fais les choses espérant qu’elles trouvent d’elles-mêmes le chemin qui me mènera à la postérité, car c’est quand même de cela dont il est question. La reconnaissance pour le travail accompli. Introduire un fanzine sur la photo avec de telles pensées peut sembler totalement décalé (et prétentieux), surtout pour quelqu’un qui est aujourd’hui considéré comme un illustrateur « connu », et un artiste de 45 ans qui n’a jamais réellement réussi à se faire au monde de l’art contemporain, alors qu’il y avait (paraît-il) ses entrées. Une autre manière de dire qu’il, que je, serais passé à côté de ma carrière principale (le fameux meilleur devenir). Je ne pense pas avoir raté ma « carrière ». Si je fais aujourd’hui de la photo – « en mage de tout le reste » – c’est surtout parce que cela me permet de continuer d’avoir un regard décalé (ou au contraire extrêmement proche) sur ma propre réalité, et, à travers elle de toucher un maximum de personnes, de la transformer en art. Je n’ai jamais rien fait d’autre, y compris avec mon dessin. Pourquoi ? Car je crois à la vérité plus qu’à la sincérité, à se trouver soi à l’intérieur de soi, plutôt que se chercher dans le regard de l’autre, et d’énoncer comme véridiques des expériences que l’on a jamais ratifié par un vécu réel. C’est évident que dans ces conditions mon travail d’illustrateur me pose problème, mais il me permet de vivre, de payer mes pellicules, et de continuer mes différentes pratiques artistiques, notamment d’archivage, qui me prennent un temps précieux sur la vie. Alors je tourne et me retourne dans mon lit, conscient que ce que je cherche ne trouvera pas sa réponse dans tel ou tel travail, mais dans l’accumulation d’expériences de vie à travers les médias qui leurs conviendront le mieux. Si j’en conçoit une certaine frustration c’est parce que je sais que cela rend mon travail plus diffus qu’il ne l’est réellement, et que je commence à être rongé d’impatience. Pourquoi raconter (une nouvelle fois) mon vécu sous l’angle de la photographie, et en dessin ? En réalité, je crois que je n’ai pas de réponse à apporter à cette question – je veux dire pas d’autre réponse que celle-là : Si l’on ‘est définitivement pas ce que l’on fait, mais ce que l’on est, c’est pourtant par le faire que passe toute reconnaissance sociale. Cela dit, je ne suis pas sur que la reconnaissance sociale soit jamais ce qui m’a le plus intéressé, mais le faire – juste le faire (sacrément tordu n’est-ce pas ?) – Sauf si l’on considère sa multiplicité.
25/01/16
La reconnaissance pour le travail accompli. Introduire un fanzine sur la photo avec de telles pensées peut sembler totalement décalé (et prétentieux), surtout pour quelqu’un qui est aujourd’hui considéré comme un illustrateur « connu », et un artiste de 45 ans qui n’a jamais réellement réussi à se faire au monde de l’art contemporain, alors qu’il y avait (paraît-il) ses entrées. Une autre manière de dire qu’il, que je, serai(s) passé à côté de ma carrière principale (le fameux meilleur devenir – selon quels critères ?). Si je fais aujourd’hui de la photo – « en mage de tout le reste » – c’est surtout parce que cela me permet de continuer d’avoir un regard décalé (ou au contraire extrêmement proche) sur ma propre réalité, et, à travers elle de toucher un maximum de personnes, de la transformer en art.
25/01/16
Je ne voudrais pas me gourer si le texte doit circuler…
Et tout d’un coup, le quotidien se met à peser son poids. On se retourne dans son lit à la recherche d’un sens qui nous échappe encore. Comment passer « d’avoir toujours été prêt » à « faire arriver les choses », surtout quand on croit au travail comme seule force motrice. J’ai toujours détesté le relationnel, et un ami me disait souvent que mon travail consistait surtout à « m’ajouter du vécu », et à en témoigner. Mes premiers dessins sont nés de la vie que je menais « à l’époque », dans un milieu en marge de « la normalité », c’est ce qui a fait leur succès. Un succès immédiat et inattendu qui a changé durablement mon existence. Je me suis mis à gagner de l’argent, je suis devenu père, et la femme avec qui je partage ma vie, Jessica, m’a permit de cesser d’être dans un mouvement qui paraissait désordonné alors que je ne l’ai jamais considéré comme tel. Je crois en la durée, même si celle-ci peut parfois sembler longue dans un monde ou « ce qui se passe en temps réel prend trop de temps », plutôt que dans un monde où la perte de temps pouvait encore être considérée comme liberté absolue. (Blaise Cendrars, « Perdre son temps est aujourd’hui la seule manière d’être libre », cité dans le manifeste de l’art posthume, opposé au dernier best seller en date : « Seuls ensemble. De plus en plus de technologies de moins en moins de relations humaines »). « Mon » avocat me disait dernièrement que je continuais de n’avoir aucun filtre, mais je ne sais pas s’il pensait que c’était ma force ou au contraire mon handicap. Le besoin de partager tout, et tout le temps, quand il faudrait être un peu en retrait et montrer une subtile arrogance faite d’opportunisme et de talent. Je ne suis pas comme ça. Je fais les choses espérant qu’elles trouvent d’elles-mêmes le chemin qui me mènera à la postérité, car c’est quand même de cela dont il est question. La reconnaissance pour le travail accompli. Introduire un fanzine sur la photo avec de telles pensées peut sembler totalement décalé (et prétentieux), surtout pour quelqu’un qui est aujourd’hui considéré comme un illustrateur « connu », et un artiste de 45 ans qui n’a jamais réellement réussi à se faire au monde de l’art contemporain, alors qu’il y avait (paraît-il) ses entrées. Une autre manière de dire qu’il, que je, serai(s) passé à côté de mon meilleur devenir (selon quels critères ?). Si je fais aujourd’hui de la photo – « en marge de tout le reste » – c’est surtout parce que cela me permet de continuer d’avoir un regard décalé (ou au contraire extrêmement proche) sur ma propre réalité, et, à travers elle de toucher un maximum de personnes (même si je continue d’être très méfiant vis-à-vis des réseaux sociaux), de la transformer en art. Je n’ai jamais rien fait d’autre, y compris avec mon dessin. Pourquoi ? Car je crois à la vérité plus qu’à la sincérité (« En art, on a besoin de vérité, pas de sincérité », Malevitch), et que se trouver soi est plus important que de se prétendre s’être trouvé dans le regard de l’autre, en se basant sur des expériences que l’on n’a jamais ratifié par un vécu réel. C’est évident que, dans ces conditions, mon travail d’illustrateur me pose problème, mais il me permet de vivre, de payer mes pellicules, et de continuer mes différentes pratiques artistiques, notamment d’archivage, qui me prennent un temps précieux sur la vie. Alors je tourne et me retourne dans mon lit, conscient que ce que je cherche ne trouvera pas sa réponse dans tel ou tel travail, mais dans l’accumulation d’expériences de vie partagées à travers les médias qui leurs conviendront le mieux. Si j’en conçois une certaine frustration, c’est parce que je sais que cela rend mon travail plus diffus qu’il ne l’est réellement, et que je commence à être rongé d’impatience. Pourquoi raconter (une nouvelle fois) mon vécu sous l’angle de la photographie, et en dessin ? En réalité, je n’ai pas de réponse à apporter à cette question – je veux dire pas d’autre réponse que celle-là : Si l’on n‘est définitivement pas ce que l’on fait, mais ce que l’on est (« Il ne faut pas faire pour être mais être pour être »), c’est pourtant par le faire que passe toute reconnaissance sociale. Cela dit, je ne suis pas sur que la reconnaissance sociale soit jamais ce qui m’a le plus intéressé, mais le faire dans sa multiplicité – celle qui conduit à la suprématie de l’être sur le faire – et pas le contraire. Sacrément tordu n’est-ce pas ?
30/01/16
Matin, réveil tranquille. Jessica vient de partir. Il fait chaud dans la petite chambre du 14 rue Portefoin, et, malgré un dégât des eaux important, je me sens bien. Les ordinateurs tournent, en plein calcul. Mon « studio », comme nous l’appelons maintenant. lieu de travail et, parfois, rarement, lieu de vie. Mais La chambre reste investie de ce qui a fait son aura durant toutes ces années. Peut-on parler de vécu pour une pièce de 15m2 ? Pourtant, dès que je pense à la rue Portefoin, c’est un peu comme si j’envisageais une personne physique. Aujourd’hui, je suis en train d’exporter mes archives photo pour les mettre sur mon tout nouvel iPad pro, un objet que je déteste mais « que je suis bien obligé d’avoir » pour le travail, les rendez-vous. Preuve d’une modernité et d’un accès qui n’est pas celui que je souhaite. Tout comme Instagram ou Facebook. Jessica me dit : « ça y est, maintenant on voit ton travail », et force m’est d’admettre qu’elle n’a pas tort. « De toutes façon tes infos sont déjà disséminées un peu partout sur internet, ta carte bleue, tes déplacement via les post de tes potes, ton téléphone portable… ». Pourquoi trouvais-je que l’iPad est un « mauvais objet » ? – c’est juste un exemple : le système fermé voulu par Steve Jobs. Le passage obligatoire via iTunes ou iBooks, l’obligation d’entrer des mots de passe, de s’inscrire ici ou là – ce que je déteste chez Instagram ou Facebook aussi d’ailleurs. Ce que l’on est et ce que l’on donne à voir de soi. Cette « image ». J’ai tellement de mal à poster des choses sur mon blog aujourd’hui. C’est étrange. Moi qui si actif au début d’Internet avec il-studio etc. quand j’habitais en Chine et qu’il fallait des proxy pour passer outre la censure. Liberté ici, outil du capitalisme triomphant là… Bien sûr qu’il faut réfléchir toutes ces choses…
05/02/16
J’écris le iPad sur les genoux, absolument pas persuadé de ne pas détester l’objet que j’utilise. Bizarre formulation : « absolument pas persuadé de ne pas… » aimer aurait dû être le mot suivant, « l’objet que j’utilise ». Le contact direct de mes doigts sur la surface lisse de l’écran, la nécessité de passer par le réseau pour partager l’information, l’anachronisme des machines à écrire. Steve Jobs dans le film de Danny Boyle « pourquoi utiliser un stylet quand on peut utiliser ses doigts ». Qu’est-ce qui fait un génie ? Être persuadé d’en être un ? Confirmation du système fermé. Préserver les droits des artistes, forcer à l’achat de tout. Tuer le streaming. La diffusion. Le cloud comme seule destination. Donc créer Dieu. Réduire, contrôler. Le monde paranoïaque de Philip K. Dick. « Notre futur ». L’impact des objets sur l’œuvre produit par leurs biais. Voir la photographie. écrit-on pareil sur un ordinateur et sur une tablette ? photographie-t-on différemment avec un numérique et un argentique, un moyen et un grand format, une chambre Plaubel et un Hasselblad ?
Avoir trop d’objets / ne pas en avoir assez. Passer du livre au livre électronique. Du nomadisme la sédentarisation. Que faire de toutes ces choses ? Changer de produit à chaque nouvelle génération… de produits.
J’hésite, je tourne autour, depuis que Jessica a littéralement ouvert un compte Instagram en mon nom alors qu’elle était aux chiottes. Que faire de ce compte. à chaque fois que j’y pense je m’imagine dans la position d’un agent (de quoi de qui) que l’on essayerais de « retourner ». J’y pense un peu tous les jours, tous les soirs, toutes les nuits, cela m’obsède. « Quel moyen de diffusion cela serait ». Mais en même temps je ne peux l’imaginer autrement qu’une privation de liberté, une « mise en conformité », un pas de plus dans le sens de la surveillance généralisée. Qu’importe l’outil après tout. Sauf que l’outil un réel impact sur la réalité qu’il permet de décrire. encore et encore. Voir la photographie….
si je devais ouvrir un compte je voudrais en ouvrir plusieurs car j’ai plusieurs réalités.
être au courant en temps réel de tout alors que je pense que l’on n’a jamais eu autant besoin de recul sur les choses.
L’esprit parasité tout le temps, sans cesse.
Inutilement;
Suis-je rétrograde ?
Le résistance a-t-elle encore un sens ?
Tout ce temps perdu derrière des écrans à se divertir, à se « chercher ».
Jessica me dit : « Quand je vois tous ce livres que tu as accumulés en trois ans, alors que tu aurais pu m’offrir des fringues… on dirait la bibliothèque d’une vie entière ». Que lui répondre ? Que ces livres me rassurent ? Que j’aime y revenir. Que je les garde pour mes vieux jours, pour notre fils ? Tout cet « encombrement ». Alors que tout pourrait tenir dans un Ipad. A-t-on besoin de toutes ces choses. « As-tu besoin de toutes ces choses Artus ? Moi j’ai besoin de fringues pour aller à mes rendez-vous, et toi aussi d’ailleurs. On a même pas de pulls décents… »
Putain, c’est vrai qu’en un sens elle n’a pas tort. De plus en plus de mal à me concentrer. les idées passent trop vite dans mon cerveau. Envie de voyager. Voir de nouvelles choses. Pour les partager. Il y a longtemps je réfléchissais sur la notion de partage opposée à celle d’échange. Je ne pensais pas alors à la matérialité des choses, cette idée m’effleure maintenant. Sans réponse.
Le matérialisme opposé à la dématérialisation. La religion, l’incarnation. L’immatériel. Ce mot que je n’arrive pas à trouver et qui résumerais si bien ma pensée là, tout de suite. Mais pourquoi vouloir la résumer. tenir un livre entre ses mains. Le lire. corner les pages. Le mettre dans une bibliothèque, en attendant qu’il soit redécouvert par un autre. Marqué par le temps. Sujet à modifications rendues visibles par le passage des générations d’êtres, non d’objets.
16/04/16
La première fois que j’ai tenu un appareil photo (cher) entre les mains j’ai ressenti une forme de pouvoir social
18/04/16
– D’après Bourdieu l’appareil photo est une affirmation du niveau social
– Je t’avais toujours dit que les photographes étaient des connards
23/04/16
Il y a quelque chose chez Atget et Doisneau de sympathique et très français qu’il n’y a pas dans la photographie américaine de Shore ou Eggleston
25/04/16
Il faut penser l’art comme une forme de résistance au marché alors comment parler encore de marché de l’art?
30/04/16
« Si cela doit arriver cela arrivera », in Le livre de la jungle (au cinéma, ou en Streaming ?)
11/05/16
What do you want ?
i can order for you… I’m at this dîner, you know… Skylight… Come over.
Des hommes en costumes, trois amies, une chinoise et son téléphone portable. Je retrouve des gestes familiers. Glisser les toasts beurrés sous les œufs, le bacon croustille. J’adore ce goût avec le thé et les hashbrown. La nourriture est banale, l’endroit ressemble a tous ces dîners un peu moisis que l’on trouve dans l’Amérique profonde. Last order for today’s spécials… Les serveurs courent dans tous les sens quoique l’endroit soit a moitié vide et surdimentionné. Je regarde le carrelage, les tables bleues et les banquettes argentées a paillettes, signes d’un autre temps. Comment de tels lieux ont-ils pu subsister ?
De l’autre côté de la rue le magasin B&H vend le dernier cri de l’équipement numérique. Je me demande combien de photographes ont photographiés cet endroit.
Je sors d’un nouveau rendez vous manqué avec une forme de passé révolu. Dans un immense loft des artistes réalisent des fausses peintures religieuses. La femme m’explique que c’est quand même quelque chose de dessiner Jesus et les saints. J’acquiesse de la tête. Je pense a une nouvelle série de dessins. Je suis artiste. Enfin, plus vraiment. Chez moi comme sans doute chez cette femme l’art, tel qu’il est pratiqué aujourd’hui, a cessé de m’intéresser. Il est devenu un produit comme un autre. Je regarde un homme mangerde l’autre côté de la salle, seul, obèse, il vient d’enlever son costume. J’hésite a lui demander de le prendre en photo. Excuse me sir, I’m a photographer…
Je me lève, lui pose la question.
I’d rather not. Me repond-t-il.
Il y a quelques années je n’aurait pas demandé… Il n’y aurait pas eu ces problèmes de droits non plus… Liés a l’usage par les marques de tonnes d’images dont le but n’était pas forcément de finir en 4×3 dans le métro… Ou peut être que si. Les réseaux sociaux, la généralisation du numérique. B&H, qui draine une foule de gens venus acheter la preuve de leur statut social avant tout… La taille de leur appareil, le nombre de pixels…
Je suis venu a New York réaliser un grand dessin sur papier pour l’ouverture d’une galerie de design. La « performance live » a été annulée afin de ne pas abîmer le mobilier et voler la vedette aux designers. J’ai donc réalisé mon dessin la veille sous les encouragements de l’équipe de ce qui ne me paraît rien d’autre qu’un magasin de plus pour riches américains, français, russes chinois, finnois, ou je ne sais qui d’autre… « He is really talented » . Mais qu’est ce que je fous la a perdre mon temps ? Je suis heureux néanmoins. Je vois du pays je m’inspire. Je repense a ces grandes peintures religieuses. Hier j’ai fait un grand a-plat noir qui m’a fait réaliser la force du geste, son actualité -ce geste que wharol voulait annihiler. Symbole de son époque « a l’âge de la reproduction mécanique ». Les artistes et leurs assistants, les sculpteurs et leur imprimantes numériques. La vanité recouverte de diamants de… Qui déjà? L’une des œuvres d’art les plus chères jamais vendues. Et puis quoi ? Symbole de son temps. Je comprend bien sûr. La désuétude du terme même d’art magique. Reenchanter la vie.
Avoir de l’espace pour peindre. Continuer les grands formats mêmes invendables. Tout stocker. Ne jamais rien lâcher, car chaque position recèle de sa part d’authenticité, même le pire mensonge ?
May I offer you more hot water ?
Yes, please !
Your check sir.
11/05/16
« In the end you have to do what you have to do it order to become what you need to become »

Vernissage le vendredi 16 janvier 2015 de 18h à 21h
Exposition du 18 janvier au 22 mars 2015
Les Modillons – 2 allée du Logis Cassé – 16430 Vindelle – www.lesmodillons.com
Ouverture les dimanches de 15h00 à 18h30 et sur rendez-vous (Entrée libre).
Contact : Catherine Mallet / mallet.catherine@gmail.com / 06 62 56 16 69 – 05 45 21 65 29
En collaboration avec la Galerie Patricia Dorfmann, Paris.
Je suis un skateboarder. C’est quelque chose que j’ai beaucoup de mal à associer avec ma pratique artistique, mais à 44 ans il est difficile de nier l’influence qu’à encore aujourd’hui cette pratique quotidienne dans mon art. Dire qu’elle est à la base de tout serait faux, mais ma vision a littéralement été façonnée par le rapport à la ville que le skateboard sous-tend, et plus particulièrement à la rue. Je pensais dernièrement que l’héritage situationniste légué par ma mère (elle fut un temps la meilleure amie de Guy Debord) trouvait un de ses aboutissements dans cette culture, du détournement à la psychogéographie, en passant par la dérive. Quand on sait que le skateboard moderne est né à l’époque du punk, lui-même influencé par Malcom Mac Laren, nourri d’idées situationnistes, on comprend mieux pourquoi il a pu tenter toute une génération de gamins qui avaient du mal à s’intégrer dans les groupes classiques de jeunes de leur âge, et cherchaient aussi une réponse culturelle à leur mal-être. Dans les années 80 et le début des années 90, être skateboarder était particulièrement mal vu. Nous étions souvent sales, refusions de porter des marques – ce qui a bien changé pour la nouvelle génération – et n’en avions rien à foutre de rien, avec un côté autodestructeur qui, lui, a peu évolué. Le skateboard est un sport violent basé sur l’idée de tomber et de toujours se relever, mais c’est aussi un sport (nous ne l’appelions jamais comme ça), où le graphisme et de manière générale l’idée de style, est prédominante et constamment remise en question. La consistance y est primordiale, synonyme d’authenticité et de régularité dans la durée.

Photo Emynassy
J’ai rencontré Jeremy au début des années 2000 et Sam en 1990, alors que j’étais moi-même skateur depuis le début des années 80. Tous trois avons choisi différentes formes d’art pour nous exprimer à différentes périodes de nos vies. Jeremy est progressivement devenu photographe au moment où il se lassait de sa carrière de skateboarder sponsorisé et Sam, après un début remarqué dans l’art contemporain, est devenu technicien pédagogique aux beaux arts d’Angoulême où j’avais fait un cours séjour en 1990. Il n’a jamais cessé d’être habité par ses créations passées et futures. Je suis pour ma part devenu « connu » pour mes dessins noirs et blancs, alors que je continue de croire au potentiel du reste de mon travail, notamment celui basé sur l’auto-édition, la peinture et les performances, qui reçoit pourtant encore un accueil mitigé dans le milieu de l’art contemporain. J’imagine que notre rapport commun à la rue, fait de nous des gens assez peu malléables, nourris d’une culture à la fois populaire et élitiste dans un genre particulier – que l’on pourrait définir comme indépendant s’il n’était pas aujourd’hui tellement parasité par toutes les grosses marques qui ne se lassent pas du potentiel commercial que tout ce qui est considéré comme « alternatif » représente.
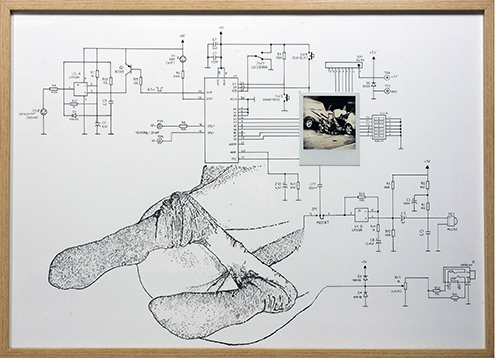
CrasH # 5 Samuel Neuhardt
Quand Jeremy m’a présenté à Catherine et parlé de son espace d’art non loin d’Angoulême, j’ai été immédiatement intéressé. Il était alors question qu’il y ait un jour où l’autre une exposition personnelle, ce qui m’a poussé à inviter mon autre ami Sam à y exposer avec moi à sa place, quand ce projet s’est mis en branle, avec le soutien de ma galeriste parisienne Patricia Dorfmann. Le travail de photographie de Jeremy, plus classique, avait du mal à s’inscrire dans notre rébellion toute « contemporaine ». Jeremy me parle souvent de « ses tripes », quand il parle de ses photos, de ses reportages, de sa façon d’envisager le monde et la vie, qui est pourtant très proche de la nôtre, avec la capacité de faire des concessions en moins, et une dialectique moins écrite. Cette exposition, d’une certaine manière, lui est dédiée – en tout cas, je lui dédie.

Nous vivons dans un moment de l’art ou toute générosité semble interdite, à partir du moment où elle ne cadre pas avec la grande image que véhicule ce que l’on a arbitrairement décidé de considérer comme l’art de notre temps, sans qu’il n’existe pour autant aucun réel recul pour juger de ce qui doit rester, ou pas – si l’on décide d’ignorer que la côte a aujourd’hui plus d’importance dans le système de reconnaissance du travail de l’artiste que son authenticité réelle.
« Mais après avoir ramassé un petit magot, il faudra te tirer avant de devenir comme eux ».
À chaque fois que je fais une exposition, je ne peux m’empêcher de penser à mes amis, tous mes amis, moins « malins » que moi (dans le sens petit du terme), qui n’ont su, ou pu, se confronter au marché dans ce qu’il a, non pas d’excluant, mais de formateur. Quand j’étais jeune, et maniais encore la photocopieuse comme moyen principal de diffusion de mon travail – je n’ai jamais cessé quoique je m’en serve plus aujourd’hui à des fins d’archivage, j’entendais beaucoup parler d’entrisme, une notion politique détournée de son sens premier. J’imaginais alors des punks devenus cadres dynamiques, qui feraient (ou faisaient) changer le monde de l’intérieur. Vingt ans plus tard, je connais le pouvoir de la publicité, des médias, et pour faire simple, de l’argent sur les destinées humaines. Qui parle encore d’intégrité aujourd’hui, d’authenticité, autrement que pour vendre encore mieux et encore plus, de l’art comme des hamburgers ou des fringues de créateurs obscurs labellisés mode, et donc potentiellement devenus des incontournables de la génération post internet – celle pour qui le recul dans le temps ne dépasse jamais une saison.

L’art ne peut être considéré comme un produit. Il ne le sera en tout cas jamais dans mon esprit, et je ne crois jamais m’être laissé guidé par une perspective « juteuse » – même lorsque je fais de la publicité j’essaye toujours d’inclure cette dernière dans mon « système artistique ». Dire non au marché (quoi qu’on en pense), c’est passer à côté de son époque, dans ce qu’elle a de plus contemporain et qui n’est pas forcément de l’art, mais pourrait facilement le devenir. Avoir un « second métier », n’est pas inconciliable avec le fait d’être artiste. Photographe, dessinateur, artisan. Avant d’être une vue de l’esprit, l’art est avant tout une pratique, comme le skateboard, avec ses figures improvisées sur des bases connues, ou le style, avant le niveau, peut délimiter une carrière. Tomber, cela veut dire que l’on a appris quelque chose. Faire tout pour réussir, c’est devenir l’ennemi. L’entrisme n’existe pas car il restera, de tout temps, du côté de la sincérité, qui n’est pas la vérité, « pour trop vouloir lui ressembler ».
Des bises
Artus
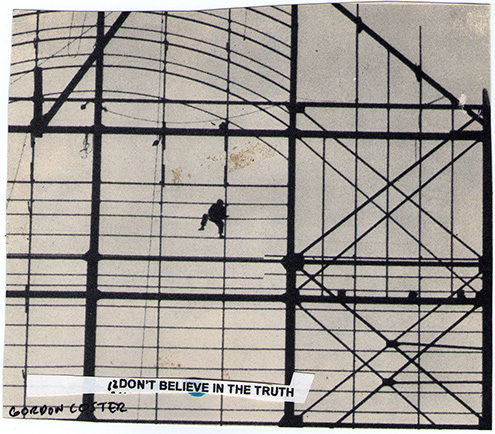
Dans le cadre de son exposition « He is not just a self declared Genius », Artus de Lavilléon traitera, ce samedi 22 novembre 2014 à 16 heures précises, de « l’impossibilité d’échapper à son état d’artiste dans une société où la vitrine fait œuvre », réflexion en lien avec les textes Zéro-dix de Malevich, tract de l’exposition « Zéro-Dix », Petrograd, 19 décembre 1915 – 19 janvier 1916 et « Mode d’emploi du détournement » de Debord et Wolman, revue Les lèvres nues, n°8, Bruxelles, mai 1956.
Invité par Artus de Lavilléon, Pierre Denan lira Au vide, texte inédit, chœur chaotique et musical.
Au vi(d)e
Du détournement aux dessins, je suis curieusement absent de mon art depuis quelques années. Je suis conduit par ma propre pratique sans qu’aucune décision nouvelle n’ait été prise. Ma dernière performance avait trait à un consumérisme de rigueur qui était celui de l’enfermement volontaire dans une surface minimum au sein d’une grande surface, perception sans doute erronée du monde car sans prise directe avec la réalité, ce fantasme du clochard et du banc. Élevé par Maryse Lucas, meilleure ami de Guy Debord, comme le dit la légende et le film « Les enfants de la société du spectacle ». Je suis contre toute forme de spectacle, de récupération, car il n’existe plus de forme de spectacle qui puisse encore être à la fois subversive et valable. Dans le même temps j’expose. Échec d’une contre-culture réformée. L’individualisme n’est pas encore devenu réellement collectif.
Le mythe de l’artiste qui arrête de peindre – car il a fait le tour de tout, ne se sent pas satisfait, de rien, ni des galeries, ni des musées, ces sarcophages de valeurs comme dit Malevich, est une invention, paraît-il. « Qu’est-ce qui vous dit que Malevich était un révolutionnaire ? », « qu’est-ce qui vous dit que ce n’est pas une invention historique ? », me dit un ponte de l’art contemporain, un historien, quelqu’un qui a du passer à côté des milliers de pages où Malevich écrit et dénonce, cherche une nouvelle forme, érige la vérité contre la sincérité, et surtout nous parle d’absolu déjà atteint. L’homme libre. Puis Malevich est torturé et revient à la figuration en assemblant des carrés et des formes géométriques posées les unes sur les autres.
Le détournement. « Dépassement de l’art » (Directive n°1), « Réalisation de la philosophie » (Directive N°2). Exposition en boutique, dans des Lieux Communs (Ellul), tout tenté, tout fait. Que reste-il ? « Au vide », comme le carré de Malevich, comme les directives de Debord, par l’absence, absence de vie, absence de foule, absence de réaction réelle à un moment ou tout est devenu tellement accessible, tellement permis qu’il ne reste rien, même pas un cri dépossédé de son existence – tant littéraire qu’artistique – mais devenu « posthume de son vivant » par la force des choses. Marginalité.
Ce qui se passe à côté a toujours l’air plus vrai.
Artus de Lavilléon, Intention, pour Pierre Denan, mercredi 19 novembre 2014.

Parcours Saint Germain
Atelier de céramique Fance Franck et Francine Del Pierre
47 rue Bonaparte
Exposition du 21 au 31 octobre 2014
Vernissage mardi 21 octobre de 18h à 21h
Suite au désistement de la marque, l’exposition d’Artus de Lavilléon qui devait se dérouler dans la boutique Ted Baker, l’artiste exposera ses œuvres à l’atelier de céramique Fance Franck et Francine Del Pierre.
« Je pense qu’il ne faut pas installer les sarcophages de valeur ». Kazimir Malevitch, Sur le musée, février 1919.
Quand les organisateurs du Parcours Saint-Germain sont venus me proposer d’exposer dans une boutique sans savoir que ce choix avait été pendant des années au centre de ma pratique artistique, j’avais déjà commencé à prendre du recul par rapport aux liens qui peuvent parfois unir les marques et les artistes.
Dans mon idée, exposer en dehors des lieux institutionnels voulait dire créer potentiellement une rencontre, qui, par son caractère fortuit, puisse avoir un impact déstabilisant sur un public pas forcément acquis à la cause artistique et centré sur des volontés de consommation. Avec la généralisation de ce genre de spectacle contemporain, une telle rencontre me paraît aujourd’hui impossible, car l’idée même de spectacle désamorce totalement toute volonté de créer quelque chose qui se situe à la marge de deux univers censés être antinomiques.
Parler de marché de l’art, ou d’art utilisé à des fins commerciales est plus qu’admis et ensencé par une presse souvent bloquée par ses relations avec ses annonceurs. Avec la création de concepts stores liés à l’art, L’épicerie, Nim, mon installation dans les vitrines du Printemps ou mon enfermement volontaire dans une surface restreinte au sein du magasin Citadium, j’ai essayé de proposer une alternative aux expositions dans des galeries en fond de cour avec plus ou moins de succès – je parle ici d’autres installations moins connues, souvent ambitieuses, dans des magasins sans aucune couverture médiatique qui se focalisaient sur leur désir d’attirer journalistes et gens de l’art pour mieux vendre leurs produits – ce qui a rarement marché.
Pour qu’une telle association soit perçue à la fois comme de l’art et comme un marketing positif encore faut-il que chacun des participant joue le jeu d’une façon qui ne laisse aucun doute sur leur détermination à collaborer – ce qui est loin d’être mon cas.
Proposer une alternative aux galeries ne veut absolument pas dire accepter en bloc ce que le marché a de pervers. Dire que les marques influent toujours sur le travail de l’artiste serait faux, mais on assiste à une autocensure généralisée qui fait que la plupart des œuvres montrées dans ce cadre ne font plus que semblant de jouer d’une double nature dont le but, s’il peut-être encore intellectuellement satisfaisant, a perdu tout son caractère subversif. Comme si faire partie d’un certain réseau dépassait la valeur réelle de certaines œuvres. Parler d’Esthétique relationnelle plutôt que d’Art posthume, c’est inscrire un présent sûr de lui et de ses droits, qui pourtant, ne vaut rien sans recul dans le temps.
Quand Malevitch parle de « briser l’anneau de l’horizon » (Zero dix), ou d’exposer « en dehors des Mecque pour la prosternation » (Sur le musée), entre 1915 et 1919, il s’inscrit dans un art révolutionnaire dont le but est de changer le monde et de modifier les façons de le percevoir. C’est dans cette perspective-là que j’ai envie de m’inscrire, non dans celle d’une lecture cynique (et erronée) d’un Duchamp nous apprenant à voir le caractère sacralisant de lieux pensés comme des marques dont l’aval justifierait tout.
Les collaborations entre artistes et marques ne peuvent être valables qu’après la reconnaissance totale et sans rémission de la supériorité de l’homme sur les produits. Non sa soumission à l’idée que sans mécènes et sans musées, sans galeries ni boutiques, l’art n’existerait pas.

He is not just a self declared Genius
Exposition du 11 octobre au 22 novembre 2014
Nocturne le jeudi 23 octobre de 18h à 22h
Artus présentera pour la première fois les 260 livres originaux issus de son archivage du quotidien
Été 2005, je pars faire la traversée des États-Unis avec deux amies. Sur la route 66 et ailleurs, je collecte des phrases, des images, et des morceaux de conversations que j’associe en vue d’une exposition à New-York. Puis je range le projet dans un carton que j’oublie. 6 ans plus tard Jessica, mon amie, me demande ce qui se trouve dans ce carton poussiéreux avant de me dire que ce travail préfigure tout le reste.

Depuis des années, j’utilise des phrases tirés de film, de livres, de conversations, de séries…, dans mes dessins et �œuvres, presque toujours sans citer mes sources. Dans mon idée, il s’agit de détournements inspirés de ma culture skate, elle même inspiré de culture punk, elle-même inspirée par le situationnisme et le lettrisme, lui-même inspiré par le dadaïsme, mais aussi par la bande-dessinée, la culture religieuse (notamment le retable d’Issenheim de Grünwald), et les graffitis.
Malgré son influence, la découverte du tardive du travail de Guy Debord, avec qui ma mère était amie avant ma naissance, n’est pas forcément à mettre en rapport avec ce que je fais, mais plutôt avec la prédominance de signes, de mots et d’images, de slogans publicitaires et bientôt de réalité augmentée, qui parasitent notre quotidien, nous laissant de moins en moins de place pour penser en dehors de ces associations d’images et d’idées.
Si « tout a déjà été dit fait et pensé », comme nous l’écrivons dans le manifeste de l’art posthume en 2004, « rien ne nous empêchera d’imiter nos pères pour mieux les dépasser ». Avec le problème des droits d’auteurs, devenu un vrai casse-tête pour les artistes d’aujourd’hui, photographes, illustrateurs, graphistes, le statut de ces images composites est encore à définir. Elle est lié à l’utilisation de plus en plus fréquente des Big Data qu’internet met à notre disposition, et qui pourrait bien être la dernière étape de l’homme en quête d’omniscience et d’immortalité avant réalisation de son « devenir dieu ».
Au moment où je m’apprête à lancer un site internet et à mettre à la disposition du public la quasi totalité de mon oeuvre, le problème des droits semble insurmontable. Pourquoi montrer et utiliser en partie des images qui ne m’appartiennent pas alors que je pourrais exposer le reste de mon travail ? Sans doute parce que si l’art est effectivement lié à la volonté de « combler l’espace qui nous sépare », celui-ci ne peut réellement exister sans le terreau commun des images et des textes qui nous lient.
Fabriquer une œuvre avec des images et des textes qui ont été déjà vus et revus n’est pas admettre que l’art est arrivé à sa fin, mais plutôt une façon d’admettre que nous sommes la première génération pour qui l’accès à la culture généralisé pourrait aussi bien être synonyme de liberté que d’étouffement.
Si l’artiste est celui qui donne ou révèle la forme, il est aussi souvent à la fois un guide et le symbole d’une époque destinée à vivre à travers lui de façon posthume. Cet « homme généralisé », à la fois trace et témoignage, indissociable de sa production, pourrait ainsi et pour bien d’autres, n’être que la reproduction de ce qui a toujours été et toujours sera : une preuve définitive de l’immuabilité de l’être avant transformation définitive.